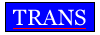 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
«Entre deux cultures: questions d’identité(s) chez Vassilis Alexakis,
écrivain contemporain de la diaspora grecque»
Olympia G. Antoniadou (Université Aristote de Thessaloniki) [BIO]
oantonia@frl.auth.gr
Vassiliki Lalagianni (Université de Péloponnèse) [BIO]
vlalag@uop.gr
«Toute création véritable, et cela est encore plus manifeste
dans la création poétique, est un exil,
car elle est le lieu d’une vision unique,
une quête de soi et des autres,
un espace où s’élabore la langue d’écriture,
langue où se meut la voix de chaque écrivain,
son souffle, son rythme, sa respiration, son corps, son être.»
Tahar Bekri, «Exils»(1)
Phénomène à plusieurs variables, la migration relève de l’essence humaine où la rencontre avec l’Autre, la (re)découverte de soi, l’insécurité identitaire constituent les paramètres d’une nouvelle socialité. Élaborant des espaces de médiation entre plusieurs langues, plusieurs histoires et plusieurs imaginaires, l’écriture immigrante – écriture migrante ou métisse d’après Pierre Nepveu(2) – peut être saisie comme une «écriture de l’entre-deux», une écriture qui opère un réaménagement des dispositifs identitaires permettant de fonder le sentiment d’appartenance à un territoire, un pays ou une nation. Nepveu précise qu’à travers l’imaginaire migrant «ce sont les catégories même du proche et du lointain, du familier, de l’étranger, du semblable et du différent qui se trouvent confondues».(3) À nos jours, dans l’ère de mondialisation et des mutations perpétuelles, les littératures de l’immigration recouvrent un phénomène mondial et les écrivains eux-mêmes revendiquent parfois explicitement l’étiquette.
Dans les romans de l’immigration, «le sens d’une identité attestée et vivace a été érodé par la dislocation résultant de la migration [...] ou détruit par un dénigrement culturel» quasi systématique.(4) Cette aliénation de l’image de soi peut conduire l’individu à une situation de crise pas seulement identitaire mais aussi ontologique. Entraînant une rupture avec son milieu et les modèles où l’individu a été socialisé, la migration constitue une situation de crise pour l’identité, un changement «d’une telle importance qu’elle ne met pas seulement en évidence mais en péril l’identité» comme le soulignent Léon et Rebeca Grinberg.(5) Des questions essentielles se référant au monde intérieur se posent alors au sein de la littérature migrante : avoir passé les frontières d’autres cultures, être rentré dans la toile d’une autre langue, ces expériences transforment-elles la vision que l’on garde de son enfance et de sa jeunesse, changent-elles la vision de cet «autrefois» qui paraît, déjà, très lointain ? Être en situation d’expatriation, cet état renforce-t-il le souvenir ou conduit-il à la condensation de la mémoire ? Contribue-t-il à l’assimilation ou provoque-t-il l’éclatement identitaire ? Au sein de cette problématique, comment se dessine le conflit intérieur du personnage émigré/immigré entre deux cultures différentes, deux mondes souvent opposés? Comment se réduit en même temps la distance entre le Moi et l’Autre ?
Toute sorte d’exil consiste en un déplacement spatial mais aussi en un trajet ontologique qui permet de prendre conscience de soi, de s’enrichir, de se transformer. Cette trajectoire complexe se porte tantôt sur le côté négatif, celui de l’individu désemparé devant le gouffre qui sépare de façon irréductible les deux univers désormais présents en lui, tantôt sur le côté positif de l’individu qui découvre une autre culture, le Soi et l’Autre. Il s’agit là de l’enracinement de l’exilé dans l’écriture, par laquelle il retrouve des racines et les moyens de se forger une nouvelle identité. Par l’écriture, l’exilé se trouve ou se retrouve. Tant qu’il semble contradictoire, «pourquoi n’y aurait-t-il pas d’exils heureux, positifs ? À commencer sans doute par l’exil imaginaire, dans et par l’écriture, différent de l’exil vécu réellement.»(6)
Écrire sur l’exil signifie surtout trouver une appartenance, un espace en dehors de frontières géographiques ou linguistiques. L’écriture est déplacement, elle «oblige à cerner sa fuite devant la souffrance, devant son exil multiforme, l’écriture […] rapproche de [soi]-même et devient alors rapatriement, un rapatriement intime et intérieur».(7) L’exil est déplacement tout comme l’écriture est mouvement. Abla Farhoud affirme que «toute écriture est un trajet vers l’inconnu donc toute vraie écriture est migrante»,(8) ce qui indique un constant va-et-vient d’un espace à l’autre, espace physique ou culturel, espace de croisement et de métissage entre identités différentes.(9) L’écriture «traverse des frontières, fait dériver des continents, survole des territoires, ne cesse de partir, de migrer, de s’exiler».(10)
Vassilis Alexakis, écrivain contemporain de la Diaspora hellénique, constitue sans doute un cas particulièrement significatif d’une littérature d’immigration fondée sur une situation d’exil et sur la construction identitaire qui vit, pense et écrit dans l’entre-deux. Si cet entre-deux est un reflet de contradictions, il reflète aussi une inépuisable richesse intérieure qui devient à son tour source de créativité d’une écriture nouvelle, d’une manière originale de transcrire le monde. Né à Athènes en 1943, il quitte le pays pour faire des études à Lille. Il regagne la France en 1967 après l’éclatement du coup d’état des Colonels en Grèce ; il y restera pour la vie, travaillant au début de sa carrière comme journaliste. Il devient très vite un romancier connu en France, ayant reçu de nombreux prix littéraires.(11) En écrivant ses romans tantôt en grec tantôt en français et en s’auto-traduisant dans l’une ou dans l’autre langue,(12) il incarne le type de l’écrivain de «l’entre-deux» dont parle Nancy Huston. Dans cet espace de l’entre-deux, l’écrivain «participe» à l’exil mais il effectue aussi un passage d’une langue à l’autre où il s’agit moins de faire le deuil de sa langue maternelle que de la faire résonner dans la langue française, la langue d’adoption, de lui donner un autre rythme ou même d’apprendre à écouter ses silences. L’exil hors langue et hors pays, malgré la douleur, devient alors lieu de création et d’affirmation. Huston parle de l’exil comme d’un moyen «de donner naissance à [soi]-même..., [de] se réinventer».(13) Alexakis communique dans ses textes largement autofictifs ainsi que dans ses entretiens, son expérience de déracinement géographique et linguistique ; il analyse les effets de l’exil ainsi que du bilinguisme qu’il entretient en traduisant ses propres romans d’une langue à l’autre.
Dans le pays d’accueil, les migrants découvrent différentes formes d’étrangeté(14) autour d’eux et en eux-mêmes. Le thème de l’étrangeté apparaît à différents niveaux et de diverses manières : traité comme hostilité xénophobe, il concerne les rapports sociaux des personnages dans le pays d’accueil ; traité comme aliénation psychique, il est examiné sous forme intérieure, voire psychologique. Le traitement de sentiments d’étrangeté semble associé à la présentation de quelques thèmes-clefs, tels que le départ, le retour, l’absence et la mort.(15) Pour Alexakis, si, au départ, le «retour au pays natal» était une certitude, à partir des années quatre-vingt il ne semble plus trop savoir quel est son lieu d’appartenance – « […] moi, je transporte le vide : je suis le chargé de mission du vide, l’ambassadeur du vide, l’envoyé spécial du vide : mon véritable pays est le vide», écrit-il dans Talgo (1983).(16) Une fois la prise de conscience de sa déculturation effectuée, il réalise qu’il n’est plus facile de quitter sa vie française pour revenir en Grèce : «J’ai envie de travailler en Grèce aussi, mais il est peut-être trop tard pour que je quitte la France».(17) «Au bout d’un certain temps, c’est déjà tard pour retourner[...]. Le retour au pays, c’est un nouvel exil»,écrit Mimika Kranaki.(18)Et dans Paris-Athènes (1989) Alexakis déclare :
Je suis pour ma part mon propre sosie. Ma fatigue est peut-être due aux efforts que j’ai consentis depuis longtemps pour conquérir une nouvelle identité sans perdre l’ancienne. […] Mes déplacements incessants m’ont empêché de m’habituer complètement aussi bien à Paris qu’à Athènes. Je ne souhaite pas me fixer.(19)
La littérature de l’immigration se présente souvent comme une «littérature de désappartenance». D’après son livre Talgo, dont la première version fut écrite en grec, l’écrivain commence à se sentir, à se présenter comme n’étant ni Grec ni Français ou comme étant et Français et Grec à la fois. L’absence d’ancrage identitaire dans un territoire produit un discours identitaire. Tout exilé vit un emboîtement spatio-temporel, dans un non-lieu, d’où l’absence de repères identitaires, hors des territoires ; ce n’est que par la ré-appropriation de l’espace, par l’en-patriement – prendre racines dans le pays d’accueil – qu’il se réapproprie son identité.(20) «[Talgo] m’a réconcilié avec la Grèce et avec moi-même. Il m’a rendu mon identité grecque. Je pouvais désormais me regarder sereinement dans la glace»,(21) souligne l’écrivain en se donnant une identité choisie et non subie. Et il ajoute dans un autre entretien:
J’appartiens en Grèce, c’est ici que je suis allé à l’école, ici se trouvent tous mes souvenirs, ma langue, mes expériences. […] Je ne suis pas un auteur français et je ne serais pas un auteur plus important si je serais resté seulement en Grèce. Je me sens comme les footballeurs […] Moi, je joue un peu en France.(22)
Pour autant, les écrivains exilés ne deviennent pas des apatrides culturels. Comme l’affirment Caceres et Le Roulicaut, «leur démarche, qui tend à rencontrer l’Universel, leur fait laisser en chemin nombre de références propres à leur culture d’origine, mais cet Universel a pour fondement l’humanisme».(23) Pour ces écrivains, communiquer à l’étranger leurs expériences culturelles signifie également élaborer des oeuvres à valeur universelle, tenter de faire découvrir d’autres cultures. La dialectique qui se cache derrière les multiples miroirs de ces œuvres contribue à renforcer le dialogue entre les différents groupes humains, allant même jusqu’à exprimer la pluralité culturelle présente au fond de chaque être humain fût-il exilé, apatride ou cosmopolite.
La notion d’appartenance, est une fiction, une imagination. Notre auteur en est persuadé. Il a le sentiment d’être étranger. Étranger par rapport à la société, par rapport aux goûts et aux habitudes des autres, par rapport à la vie. Il lui importe peu de faire partie d’un groupe social, car il préfère être à soi-même. Il en ressort un «être» dont l’identification se lie davantage aux comportements des gens que l’on retrouve dans la vie quotidienne qu’aux caractéristiques particulières d’une ethnicité. Son errance lui a permis de se construire une espèce d’identité reconnue par ses lecteurs. Son identité est celle d’un homme qui a le pouvoir de changer, de faire un incessant va-et-vient non seulement entre deux pays, deux cultures, deux langues mais aussi entre deux Moi qui cherchent à se définir, à se compléter et à cohabiter malgré leurs différences. Cette constatation est le résultat d’un long dialogue entre deux langues, deux mentalités, deux publics, deux moi enfin, c’est la conséquence d’une cohabitation du Soi avec l’Autre.
Dans ce contexte de crise, Alexakis s’interroge sur ce qu’il est par rapport à son passé et par rapport à l’espace nouveau qui diffère de celui du pays d’origine. Repérable à des degrés différents et sous des aspects diversifiés, s’engageant dans des directions différentes, ce questionnement se trouve à l’origine de la quête identitaire des personnages qui découvrent différentes formes d’étrangeté autour d’eux et en eux-mêmes.(24) L’exil devient un regard lucide sur soi-même, un parcours de redécouverte de soi qui, paradoxalement, oblige l’auteur «à vivre loin des autres, à l’écart de la majorité, mais aussi dans le rêve personnel».(25) Expérience et création s’engendrent comme des discours parallèles et fixent la typologie de la littérature de l’exil. La fiction devient le miroir de l’imaginaire de l’auteur, donne forme à l’écriture qui elle-même devient prétexte de la vie.(26) Exil fécond, déchirement et désillusion deviennent synonymes de la parole poétique. Selon l’Argentin Juan José Saer l’exil offre des avantages aux écrivains dont
le plus important est sans conteste la relativisation de sa propre expérience, individuelle et collective. Narcissisme et nationalisme, grâce au décentrement et à la distance, sont sérieusement remis en question. Dans ce sens, nous pouvons considérer l’exil comme un nouvel avatar du principe de réalité. (27)
«L’interrogation sur l’identité est, souvent, la source ou du moins le corollaire d’un changement de langue, qui n’a pas pour seule vocation d’exprimer un refus, mais bien de répondre à un désir de reconstruction. Se définir par rapport à l’Autre, n’est-ce pas encore tenter de se définir, sous un jour renouvelé, par rapport à Soi et à ses Origines ?»(28) Afin de prendre conscience de soi-même, l’Autre est indispensable. On a besoin du regard d’Autrui : «[...] l’acte le plus personnel même, la prise de conscience de soi, implique toujours déjà un interlocuteur, un regard d’Autrui qui se pose sur nous», écrit M. Bachtine.(29)
Question multidimensionnelle et dynamique à travers laquelle s’exprime par excellence l’identité, le choix de la langue prend aussi une place importante dans ce phénomène de l’Autre ou de la double identité de l’écriture qui reflètent la situation de l’entre-deux. «L’entre-deux-langues est le partage même de la langue, dans sa dimension poétique, sa prétention au dialogue, son champ de miroirs où chacun s’identifie et se désidentifie ; recharge et décharge d’identité».(30) Le «polyglottisme», ce métissage linguistique, tend à incarner une écriture voulant traduire les réalités d’une identité contemporaine multiple et polymorphe. «Alexakis fait du français sa langue d’écriture ; il écrit d’abord en français avant de s’exprimer en grec ; ce qui le fait aussi éprouver des doutes à propos de son choix.»(31) Dans Paris-Athènes il déclare :
J’avais décidé d’assumer mes deux identités, d’utiliser à tour de rôle les deux langues, de partager ma vie entre Paris et Athènes. La vie solitaire me convenait pour cette raison supplémentaire qu’elle me permettait d’échapper à l’influence permanente du français. Je ne disais plus “Bonjour” en me réveillant. C’était à moi de décider dans quelle langue je vivrais ma journée.(32)
Alexakis se lance à un re-apprentissage de sa langue maternelle à travers la langue de l’Autre, le français, tout en inaugurant une nouvelle approche de sa langue maternelle, vue à travers le prisme d’un autre code linguistique.(33)
Je me suis rendu compte que j’avais pas mal oublié ma langue maternelle. Je cherchais souvent mes mots et, souvent, le premier mot qui me venait à l’esprit était français. Le génitif pluriel me posait de sérieux problèmes. [...] Mon grec s’était sclérosé, rouillé. […] Il a donc fallu que je réapprenne, en quelque sorte, ma langue maternelle : ça n’a pas été facile, ça m’a pris des années, mais enfin, j’y suis arrivé. (34)
La période de la fin du XXe et du début du XXIe siècle est celle de l’émergence des termes, souvent ambigus, du multiculturalisme, de l’universalité et de l’ «État multiculturel», où les demandes d’accommodement et de reconnaissance des différences forment la base du dialogue démocratique entre minorités et majorités. Une telle discussion doit permettre l’actualisation permanente et pacifique du code de vie commune de telle sorte que celui-ci soit susceptible de garantir aux différents styles de vie une place égale dans la société.(35) Selon Charles Taylor, les identités découlent toujours de relations dialogiques avec les autres, c’est-à-dire d’un système d’échanges entre les individus et un environnement donné, au long d’une dialectique du «donner» et du «recevoir».(36)
C’est juste à l’époque du «village global» et de l’ère de mondialisation qu’Alexakis écrit son roman, Les Mots étrangers, roman qui réussit la prouesse d’être rêvé en grec, écrit en français et vécu en sango. Après la disparition de sa mère, triste et désabusé, de moins en moins Grec mais, en même temps, si peu Français, las d’être condamné au bilinguisme, prisonnier de cette alternative, il éclate en sango, une langue qu’on parle en Centrafrique. Tandis que Talgo et Paris-Athènes tournent autour d’un «matricide» associé à l’abandon de la langue maternelle, ce roman ouvre des voies vers la connaissance d’une autre langue. Enfermé dans son appartement parisien, Nikolaїdès, le personnage principal du roman, au lieu d’écrire le roman promis à son éditeur, apprend le sango, une langue qu’il juge inutile. Mais il comprend peu à peu qu’elle sert d’exutoire au chagrin inattendu causé par la perte de son père. On y assiste alors à un voyage de deuil, où Nicolaïdès, alter ego de Vassilis Alexakis, prend la lubie d’apprendre cette langue africaine. S’absorber dans une telle tâche ressemble à une «cure de jouvence» et lui donne l’impression de repartir à zéro, d’être le prolongement du petit enfant qu’il était autrefois et qui, tout seul, a appris à lire en déchiffrant les pierres tombales du cimetière voisin de la maison familiale. En se lançant dans l’étude d’une langue africaine, Alexakis revient à la vie et se recrée un avenir, oscillant entre une nostalgie étouffée et une vague gaieté. Arrivé à sa maturité, après avoir longtemps vécu à cheval entre le grec, sa langue maternelle, et le français, langue adoptée, il finit par ajouter une troisième donnée à cet éprouvant exercice dichotomique, le sango, langue véhiculaire de la Centrafrique, qui «s’impose» à lui, presque à son insu. Alexakis écrivait déjà quelques années avant, dans son roman Je t’oublierai tous les jours (2005): «Un troisième pays après la Grèce et la France, qui ne figure sur aucune carte, occupe désormais mon esprit».(37)
L’écrivaine diasporique Angèle Bassolé se crée, de son côte, un pays sans frontières «immense où la liberté de dire, d’écrire, d’exister comme artiste, comme écrivaine, comme poète devient possible.»(38) Elle poursuit:
Mon expérience de l’exil m’apparaît être une puissance créatrice, un espace de liberté, de possibilité de rêver à demain [...]L’exil en lui-même finit par constituer pour moi un pays en soi. Mon écriture, ma poésie s’inscrivent alors dans ce pays sans frontières [...]. Et cet espace du possible d’être tout simplement ce que je suis sans avoir à me définir par rapport à un pays, me suffit.(39)
Alexakis, avec ses romans Les Mots étrangers et Après J.C. – le roman le plus «philosophique» de l’auteur où il pose la question de la quête de l’identité en termes d’initiation, que celle-ci soit intérieure ou oecuménique, embrassant une conscience sans frontière d’une humanité, Une et indivisible – a ouvert la porte de la parfaite illustration de la situation universelle de l’écrivain grec de la Diaspora. À travers ces ouvrages il contribue à la conception d’une identité humaine mondiale, qui se manifeste à travers la littérature qui «embrasse l’Autre, mais ce n’est pas à des fins de globalisation. Au contraire, elle embrasse l’Autre pour célébrer la spécificité […]. Pour s’y sourcer. […] C’est cela la visionnaire force d’irruption / interruption du poétique : non pas changer le globe […] mais changer de globe –inventer : d’ailleurs et autrement. Radicalement».(40)
Les écrivains et poètes francophones qui ont signé le Manifeste Pour une littérature-monde paru dans Le Monde le 16 mars 2007, expriment le projet suivant :
Le temps nous paraît venu d’une renaissance, d’un dialogue dans un vaste ensemble polyphonique, sans souci d’on ne sais quel combat pour ou contre la prééminence de telle ou telle langue, ou d’un quelconque «impérialisme culturelle.» (41)
Cette publication met en évidence l’ambiguїté qui recouvre le terme «Francophonie» – «le dernier avatar du colonialisme français» – lorsque son application dans la littérature renvoie à un concept de nature politique : celui-ci renvoyant à une dépendance de la production francophone de la littérature française. Ces écrivains ont décidé de lutter pour une langue française qui serait «libérée de son pacte exclusif avec la nation», libre de tout pouvoir autre que celui de l’imaginaire. Par le biais de la langue française, l’écriture voyage et des millions de lecteurs dans le monde découvrent des littératures de divers horizons ; et si mondialisation rime avec uniformisation, si elle n’est, comme l’indique Maalouf, qu’«un déguisement, un camouflage, un cheval de Troie, sous lequel se dissimulerait une entreprise de domination»(42), l’intelligentsia, appelle à une résistance à l’unification culturelle, à une hégémonie des cultures dites «dominantes». Vassilis Alexakis écrit dans Contrôle d’identité:
J’ai toujours eu cette attitude à l’égard des groupes, je me suis toujours arrangé pour ne pas en faire partie. Mon goût pour les aphorismes vient peut-être de là : je me reconnais probablement dans ces petites phrases qui n’acceptent pas d’être insérées dans un contexte, qui entendent tester seules.(43)
Alexakis refuse les catégories collectives, notamment nationales, qui lui paraissent très simplificatrices et «travaille» pour la diversité. Citoyen du monde,ildéveloppe une stratégie individuelle de «mobilité intérieure» – par un dépassement transnational et transethnique – afin de garder un pied dans chacun des mondes auxquels il a affaire. La mobilité intérieure devient donc une stratégie naturalisée, une deuxième nature en quelque sorte pour l’écrivain amené à naviguer entre des mondes divers.
Loin d’écarteler le Moi entre des entités multiples et indissolubles ou encore divisées, les «oppositions et les contradictions entre les continents, les cultures et les religions» sont presque imperceptiblement assimilées à la vie quotidienne : «Bien qu’on ne le veuille pas ou qu’on n’en ait même pas conscience, nous vivons tous d’une façon de plus en plus glocale.»(44) Le processus de réflexion de chaque individu fournit à lui seul la clef nécessaire à l’intégration des mondes différents auxquels il appartient. Toute idée de difficulté ou de souffrance associée à une vie partagée entre différents mondes est refoulée et devient le mythe de la «monogamie des lieux»(45). Vassilis Alexakis se présente dans son œuvre sous de multiples identités : du Grec et du Français, de l’écrivain et du narrateur, de l’observateur et du protagoniste. Il arrive à unir le niveau personnel (le fait de se rapporter sans cesse au personnel) à la mémoire collective (il parvient à présenter l’aspect social de tout élément personnel)(46) et à se faire renaître une identité nouvelle. Son écriture a enfin enjambé le risque de se perdre dans le labyrinthe identitaire et de miner son autodétermination au sein de la mosaïque multiculturelle. Bref, elle appelle à un partage des valeurs par-délà les nationalités, les frontières et les cultures qui invite à un respect total et mutuel d’autrui, en faveur de la diversité culturelle.(47) «Chacun d’entre nous », écrit Amin Maalouf, « devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule, érigée en appartenance suprême, et en instrument d’exclusion, parfois en instrument de guerre».(48)
Remarques:
1 Tahar Bekri, «Exils», in: Tahar Bekri, Littératures de Tunisie et du Maghreb, suivi de Réflexions et propos sur la poésie et la littérature, Paris, L’Harmattan, 1994, 179.
2 Pour Pierre Nepveu (L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, Montréal, Boréal, 1988), ce choix semble plus adéquat car il évoque la dérive de l’exil et présente les marques d’une pratique esthétique. Pour un historique de “la littérature de l’immigration” ou “littérature (im)migrante” dans les pays francophones, voir Charles Bonn, Littératures des immigrations, Paris, L’Harmattan, 1995, et Christiane Albert, L’immigration dans le roman francophone contemporain, Paris, Karthala, 2005.
4 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-Colonial Literature, New York, Routledge, 2002, 9.
5 Léon et Rebeca Grinberg, Psychanalyse du migrant et de l’exilé, Lyon, Césura Lyon Éditions, 1986, 42.
6 Jacques Mounier (éd.), Exil et littérature, Grenoble, E.L.L.U.G., 1986, 4.
7 Lucie Lequin, «D’exil et d’écriture», in: Gabrielle Pascal (dir.), Le roman québécois au féminin, Montréal, Triptyque, 1995, 29.
8 Abla Farhoud, «Immigrant un jour, immigrant toujours ou comment décoller de l’étiquette», in: Anne de Vaucher Gravili (dir.), D’autres rêves. Les écritures migrantes au Québec, Venise, Supernova, 2000, 54.
9 Elena Marchese, «Écrire en exil, écrire l’exil», in: Cahiers de l’échinox 11 (2006), 151.
10 Guy Scarpetta, Éloge au cosmopolitisme, Paris, Grasset, 1981, 108.
11 Il a publié, entre autres, les romans Le Sandwich, Paris, Julliard, 1974 ; Les Girls du City-boum-boum, Paris, Julliard, 1975 ; La Tête du chat, Paris, Le Seuil, 1978 ; Talgo, Paris, Le Seuil, 1983 ; Contrôle d’identité, Paris, Le Seuil, 1985 ; Paris-Athènes, Paris, Le Seuil, 1989 ; Avant, Paris, Le Seuil, 1992 (Prix Albert Camus 1993) ; Le cœur de Marguerite, Paris, Stock, 1999 ; La Langue maternelle, Paris, Fayard, 1995 (Prix Médicis 1995) ; Les Mots étrangers, Paris, Stock, 2002 ; Je t’oublierai tous les jours, Paris, Stock, 2005 ; Après J.C., Paris, Stock, 2007.
12 Sur ce sujet cf. Maria Orfanidou-Fréris, «Vassilis Alexakis : Écrire et se traduire», in: Francofoni 10 (1998), 117-127.
13 Nancy Huston, Entretiens, Montréal, Société Radio-Canada (SRC), 1996, 8, 43, cité par Valérie Roul, «L’autre langue fécondatrice : ‘l’étrangéité’ en soi dans Instruments des ténèbres de Nancy Huston et Possessions de Julia Kristeva», in : Lucie Lequin et Catherine Mavrikakis (éds.), La Francophonie sans frontière. Une nouvelle cartographie de l’imaginaire au féminin, Paris, L’Harmattan, 2001, 446.
14 Nous employons ici le terme «étranget» dans le sens que Julia Kristeva lui donne: «Étrangement, l’étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure, le temps où s’abîment l’entente et la sympathie» (Étrangers à nous mêmes, Paris, Gallimard, 1988, 9).
15 Dans les textes des littératures métisses se croisent «des départs-fantasmes avec des départs-réalité. Il n’est pas rare d’ailleurs qu’au moment de ce deuxième départ s’activent des souvenirs et s’établissent des analogies avec le premier départ, vécu en général de façon beaucoup plus douloureuse» (Venetia Balta, Problèmes d’identité dans la prose grecque contemporaine de la migration, Paris, L’Harmattan, 1998, 84).
16 Vassilis Alexakis, Talgo, Paris, Le Seuil, 1983, 87-88.
18 Mimika Kranaki, «Interview avec Kostas Dadinakis» (en grec), in : Diavazo 380 (1997), 119.
19 Vassilis Alexakis, Paris-Athènes, Paris, Le Seuil, 1989, 211-213. «Au bout de treize années passées en France, au cours desquelles j’ai écrit presque exclusivement en français, j’ai éprouvé le besoin de renouer avec ma langue maternelle», écrit l’auteur dans Talgo (Alexakis 1983, 84).
20 Ioanna-Christina Chilea, «Nancy Huston entre la perte du nord et la réconciliation avec soi»,in : Actes du colloque «Mythe et mondialisation. L’exil dans les littératures francophones» (9-10 septembre 2005), Suceava, Éditura Univ. Susceava, 2006, 26.
22 Vassilis Alexakis interviewé par Paris Spinou pour le journal Kyriakatiki Eleftherotypia, juillet 2003, 24. Notre traduction. Cf. aussi : http://www.rocsir.usv.ro/archiv/2002_2/4OlympiaAntoniadou2005.htm (23.04.2008).
23 Béatrice Caceres et Yannick Le Roulicaut, Les écrivains de l’exil : Cosmopolitisme ou ethnicité, Paris, L’Harmattan/Les Éditions de l’UCO, 2002, 10.
25 Claude Drevet, «L’exil intérieur», in : Alain Niderst (éd.), L’exil, Strasbourg, Klinchsieck, 1996, 215.
26 Efstratia Oktapoda-Lu et Vassiliki Lalagianni, «Le véritable exil est toujours intérieur. Imaginaire et métissage chez les écrivains francophones grecs», in : French Forum, 30, 3 (2005), 115.
27 Cf. Magazine littéraire 221 (1985), 47.
28 Robert Jouanny, Singularités francophones ou choisir d’écrire en français, Paris, PUF, 2000, 142.
29 Cité par Tzvetan Todorov, Michaïl Bachtine le principe dialogique suivi des Écrits du cercle de Bachtine, Paris, Seuil, 1981, 50.
30 Daniel Sibony, Entre-deux, l’origine en partage, Paris, Seuil, 1991, 31-32.
31 Oktapoda-Lu et Lalagianni 2005, 113.
32 Alexakis 1989, 195. Dans Les Mots étrangers, Paris, Stock, 2002, 253, l’écrivain avouera : «Quand je suis en Grèce je pense en grec. Lorsque j’écris en français je pense en français. Je ne saurais vous dire quelle langue aurait ma préférence si je devais rester longtemps sur une île déserte».
33 Sur ce sujet, voir Olympia G. Antoniadou, «Retournant à la langue maternelle à travers la langue de l’Autre : le cas de Vassilis Alexakis» (en grec), in : Inter-textes 8 (2006), 53-71.
35 Cf. la «théorie ou le modèle de Reconnaissance» : selon Charles Taylor, la reconnaissance des identités est une exigence démocratique, et ce en vertu de quatre arguments : 1. L’appartenance à une culture ou à une communauté structure fortement la personnalité d’un individu. 2. La diversité des cultures est une richesse qui doit être préservée, car aucune d’entre elles ne peut se prétendre supérieure et universelle. 3. Un code de vie commune doit tenir compte des conceptions du «bien» et du «juste» des groupes culturels qui constituent une collectivité donnée. 4. Dans une société pluriethnique, les cultures ne doivent pas simplement être tolérées et reléguées à la sphère du privée, elles exigent également d’être reconnues dans l’espace public, notamment sous la forme de l’octroi de droits collectifs spécifiques aux minorités. Cf. Charles Taylor et al. (éds.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition, Princeton/New Jersey, Princeton University Press, 1994. Cf. aussi Fred Constant, Le Multiculturalisme, Paris, Flammarion, 2000.
36 Cité par Constant 2000, 103.
37 Vassilis Alexakis, Je t’oublierai tous les jours, Paris, Stock, 2005, 228.
38 Angèle Bassolé, «Les sans-pays. Langue, écriture, exil», in : Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme 23, 2 (2004), 48.
40 Mireille Calle-Gruber, «Pour une analytique de la globalisation – Littératures de l’altérité : l’exemple d’Assia Djebar», in: Manfred Schmeling, Monika Schmitz-Emans, Kerrst Walstra (dir.), Literatur im Zeitalter der Globalisierung, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2000, 217 et 219.
41 http://www.lianes.org/Manifeste-pour-une-littérature-monde-en-francais_a128.html (22.04.2008).
42 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1999, 133.
43 Vassilis Alexakis, Contrôle d’identité, Paris, Seuil, 1985, 31.
44 Ulrich Beck, What is Globalization?, Cambridge, Polity, 2000, 73, notre traduction. L’amalgame que propose le terme de «glocalisation» offre, selon Beck, l’avantage méthodologique d’octroyer une analyse du concept prédominant de mondialisation au niveau de l’expérience individuelle. Pour ce néologisme cf. aussi Roland Robertson, «Globalization», in : Featherstone Mike, Lash Scott, Robertson Roland (éds.), Global Modernities, London, Sage, 1995. Le concept de «glocalisation» met en évidence l’importance des courants culturels du monde au sein d’un processus dialectique paradoxal. La nature contradictoire de ce dernier s’explique par le fait que des éléments dialectiques locaux et mondiaux coexistent (plutôt que de s’exclure mutuellement).
46 Georges Fréris, «Le double Autre. Le cas de Vassilis Alexakis», in Annales de l’Université Catholique de Dublin (sous presse).
47 Voir sur ce sujet, Olympia G.Antoniadou, «Mondialisation et identité: le cas de Vassilis Alexakis», Cahiers de l’echinox 11 (2006), 217-235.
For quotation purposes:
Olympia G. Antoniadou et Vassiliki Lalagianni: «Entre deux cultures : questions d’identité(s) chez Vassilis Alexakis, écrivain contemporain de la diaspora grecque» -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/4_antoniadou_lalgianni.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25