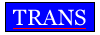 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Ecriture et émigration: les auteurs francophones subsahariens
Papa Samba Diop (Université Paris XII) [BIO]
Email: diop@univ-paris12.fr
Et voici que je suis venu! / De nouveau cette vie clopinante
devant moi, non pas cette vie, cette mort, cette mort sans sens ni piété,
cette mort où la grandeur piteusement échoue, l’éclatante petitesse de cette mort…
(Aimé Césaire : Cahier d’un retour au pays natal).
En 1961, lorsque paraît L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, l’émigration, de même que l’hybridité culturelle, sont présentées par le romancier comme néfastes à l’équilibre spirituel du protagoniste : Samba Diallo. Celui-ci appartient à une vieille famille aristocratique et musulmane. Il doit, après des études secondaires effectuées au Sénégal, aller à Paris, à la Sorbonne, pour y suivre des enseignements de philosophie. Et plus il avancera dans sa formation, mais aussi dans sa connaissance de la culture et de la civilisation françaises, plus il prendra de distance par rapport à l’Islam et à certains de ses principes, dont notamment les cinq prières quotidiennes. Ce doute lui sera fatal, car, de retour au pays des Diallobés (au nord du Sénégal), il cherchera à convaincre sa communauté d’origine de ce que, en matière de religion comme de culture, le relativisme est salutaire. Un membre de son village, devenu fou après un lointain séjour en Europe, n’admettra pas cette nouvelle philosophie, et assassinera le jeune étudiant.
Ainsi voit-on que pour la génération à laquelle appartient Cheikh Hamidou Kane, celle des écrivains des années 1930-1960, l’émigration est associée sinon à la perte irrémédiable d’identité, du moins au brouillage des repères religieux et culturels. Et pourtant, elle est le moteur le plus sûr de l’écriture, car celle-ci se nourrit des angoisses et des servitudes liées au choc culturel. Et parallèlement au malaise suscité par la plongée dans une culture étrangère, nombre de romanciers ont développé un corollaire: l’insécurité linguistique liée au maniement d’une langue perçue comme un legs colonial. D’où les nombreuses tentatives d’africanisation du français, dont Ahmadou Kourouma est l’un des chefs de file.
Toutefois, lorsqu’on parcourt le roman francophone subsaharien des années 2000, on est frappé par le fait qu’il reprend le thème de l’émigration, mais en le délestant de toute la charge négative dictée par l’orientation idéologique des temps précédant les indépendances africaines.
De nos jours, des écrivains comme Abdourahman Wabéri ou Alain Mabanckou, Calixthe Beyala, Sami Tchak ou Aminata Zaaria ne produisent plus une littérature préoccupée d’éthique. Et le sentiment qui se dégage de leur lecture est celui d’une très grande liberté prise par rapport aussi bien à la langue – le français – qu’aux deux cultures principales, l’africaine et la française. Leur situation de «migrants » semble être vécue comme un privilège leur offrant l’occasion de tenir, dans la plus grande impunité, des propos qu’il aurait été périlleux de défendre in situ.
D’où, dans les romans modernes, la jubilation des créateurs à bâtir une littérature «sans frontières », dans la mesure où elle exhibe son hypotexte – autre qu’africain – et proclame son émancipation des carcans traditionnels, grâce au nouvel espace de création, celui offert par l’Europe – ou d’autres terres d’accueil – et ses structures éditoriales, ses réseaux de diffusion et ses instances de consécration.(1)
L’origine inflexible
Discours contradictoire, celui provenant des écrivains et portant sur l’émigration est à la fois fait de moments d’exaltation, de vagues d’angoisse ou de longs rêves d’une origine immuable à partir de laquelle toute la vie doit être appréhendée. C’est ainsi que Koffi Kwahulé, dont le théâtre s’inspire souvent de l’ancien modèle grec, a pu déclarer : «Quoi que j’écrive mon africanité transparaîtra. Tout ce que j’écris s’origine dans le fait que je suis né en Côte-d’Ivoire et que j’y suis allé à l’école française.»(2)
En fait, Léopold Sédar Senghor avait donné la mesure un demi-siècle auparavant: le pays d’origine est, souvent, l’espace vital des œuvres littéraires en apparence les plus cosmopolites. Sa poésie, qui chante le peuple noir à New York et le Taj Mahâl, le Cap-Vert et l’Ethiopie, qui traverse Paris de Montparnasse à Saint-Denis, comme elle immortalise la prestance de la princesse de Belborg, est à la fois une poésie «du monde entier» et une célébration du terroir, son «Royaume d’enfance»: «quelques villages sérères perdus parmi les tanns, les bois, les bolongs et les champs». (Postface d’Ethiopiques, 1954). Et c’est sous cet angle que bon nombre d’œuvres littéraires africaines, parmi lesquelles celle de Massa Makan Diabaté – en particulier la trilogie du Lieutenant de Kouta, du Coiffeur de Kouta et du Boucher de Kouta -, peuvent être décrites comme profondément estampillées par un espace national ou villageois. Avant Massa Makan Diabaté, Félix Couchoro (L’Esclave,1929) ou Jean Malonga (La Légende de M’Pfoumou Ma Mazono,1954) avaient ainsi nourri leurs écrits du fonds légendaire togolais ou congolais.
Il convient par conséquent d’étudier les textes francophones, ceux des résidents comme des migrants, en considérant qu’ils se meuvent de part et d’autre d’une zone d’échanges entre le lieu d’origine et l’expérience internationale, une partie de l’itinéraire scriptural pouvant d’ailleurs souvent être commune entre les deux styles de littératures. Chez Tchicaya U Tam’si par exemple, aussi bien dans Les Cancrelats (1980) que dans Les Méduses (1982), Les Phalènes (1984) ou Ces fruits si doux de l’arbre à pain (1987), il est question à la fois de la société traditionnelle congolaise et des temps post-coloniaux. Et les tribulations des personnages, anciens ou modernes, dans le cadre villageois ou urbain, traduisent un malaise: celui lié à de profondes mutations sociales et économiques ayant engendré des ségrégations et forgé des «élites » issues du système administratif colonial. Le romancier vilipende ce beau monde pour son incurie.(3)
Les résidents et l’espace réel
A l’instar de Zamenga Batukezanga ou de Hampâté Bâ, d’Ousmane Sembène, de Cheikh Aliou Ndao ou de Boubacar Boris Diop, les résidents traitent volontiers, y compris dans leurs œuvres les plus réalistes, de sujets liés à leur environnement social (Nafissatou Diallo : De Tilène au Plateau, Abasse Ndione : La Vie en spirale, Mamadou Sow : Les cinq nuits de Gnilane, Ntyugwetondo Rawiri: G’amèrakano) ou politique immédiat (Ousmane Sembène : Le Dernier de l’Empire, Sony Labou Tansi : La Vie et demie, L’Etat honteux, L’Anté-peuple). Une attention permanente portée aux vicissitudes de la vie quotidienne (Ousmane Sembène : Le Manda, Hubert Freddy Ndong Mbeng: Les Matitis), la stigmatisation constante de la pesanteur de certaines coutumes familiales ou matrimoniales (Myriam Vieyra : Femmes échouées), la condamnation sans faille du dévoiement des règles anciennes de conduite (Cheikh Aliou Ndao : Excellence, vos épouses) quand ce n’est pas le refus de l’accaparement du pouvoir politique par des oligarchies (Mukala Kadima-Nzuji : La Chorale des mouches, J.-R. Essomba: Le Destin volé), mais aussi la peinture d’une condition féminine encore fragile (Justine Mintsa: Histoire d’Awu(4), Aminata Zaaria: La Nuit est tombée sur Dakar) ou la réprobation de la survivance de croyances superstitieuses rétrogrades (Aminata Sow Fall : La Grève des bàttu) – telle est, à travers ses tableaux les plus courants, la large palette critique des chroniqueurs que sont souvent les résidents. Leur espace de vie se confond avec leur espace de création.
En prise avec une réalité prenante, ils sont les témoins directs de faits et gestes bannissant le refuge total dans un monde imaginaire. De ce point de vue, Jeff, le personnage principal du Destin volé d’Essomba, est emblématique de l’écrivain parfois perdu dans les arcanes politiques de son propre pays, comme dans une épaisse forêt. Jeff, un Effala de la noblesse la plus authentique, est contraint, pour survivre, d’obtempérer aux injonctions fantaisistes des coteries et des puissants installés par les «indépendances »: les Ongola et leurs acolytes. Quant à Oré-Olé de La Chorale des mouches (Mukala Kadima-Nzuji), il n’est pas difficile de l’assimiler à un équivalent dans la vie réelle. Après Ya Kass (le Père de la Nation), il a pris le pouvoir dans la République du Kulâh, qui grouille de sectes, le long du fleuve Musulu. Et cette communauté que décrit le narrateur s’inspire quant à sa politique interne et internationale de celles de Mao Tse-tung. Aisément identifiable comme source d’inspiration littéraire, elle est soumise aux caprices d’Oré-Olé, qui a décrété que les Kulâhiens et les Kulâhiennes ne s’habillent plus à l’européenne.
L’auteur de la satire est d’autant plus en verve que les options de politique sociale et économique lui sont incompréhensibles. D’où, à la fin du livre, la création par le protagoniste – un ancien élève des Pères jésuites – d’un journal, Notre Pays, un bi-mensuel d’analyses économiques et politiques,qui s’en prend à l’organisation alambiquée de Kulâh, pays où la palabre prend toujours le dessus sur des mesures efficaces. Par ailleurs, la multiplication des «Conférences Nationales» où chacun prend la parole comme s’il tenait entre ses mains le destin de la collectivité nationale, achève de souligner le caractère rocambolesque de ces réunions en tous points comparables dans leur vacuité complète à des «chorales de mouches ».
Inaugurée par Amadou Kourouma qui, dans les Soleils des indépendances,s’est inspiré de modèles ayant réellement existé, la caricature des régimes politiques nés autour de l’année 1960, est par conséquent toujours en vigueur dans l’écriture francophone. Le roman Sous le pouvoir des bilakoros d’Amadou Koné avait en 1980 assuré le relais de Kourouma, et l’on pourrait affilier L’Assemblée des Djinns (1985) de Massa Makan Diabaté à cette veine de la chronique sociale en milieu mandingue: sur un mode dérisoire, le pays d’origine inspire nombre de créateurs impatients d’y éradiquer des pratiques politiques néfastes à son audience internationale.
L’œuvre littéraire des résidents peut aussi reposer sur des sous-entendus lorsqu’elle craint la censure politique locale. L’exemple de Sénouvo Zinsou est à cet égard d’une grande pertinence : l’écrivain, depuis qu’il vit en exil en Allemagne (1994), procède dans son théâtre à une réécriture des anciennes pièces. Akakpossa (1980) est une reprise des Bureaucrates (1969). Et en 1995 Chien de prince, chien de roi, joué à l’Institut Français de Brême, est une forme nouvelle donnée au Chien royal représenté à Lomé en 1985. Du reste, Chien de prince, chien de roi deviendra Le Prince de Wouya, plus explicite dans sa stigmatisation des servitudes imposées par la dictature.(5)
Mais les résidents peuvent aussi, tout en alimentant la veine du roman de la circonstance historique, faire porter l’essentiel de la narration sur la sauvegarde du patrimoine culturel national, reléguant ainsi au second plan les intrigues politiques et les personnages fébriles qui les ourdissent. L’œuvre d’Amadou Hampâté Bâ, né en 1900 à Bandiagara et mort en 1991 à Abidjan, est à cet égard une des illustrations les plus édifiantes d’un parcours littéraire – de Koumen en 1961 à Amkoullel, L’Enfant peul en 1991- visant à inscrire dans la mémoire universelle les structures anthropologiques d’un imaginaire peul en parfaite osmose avec l’Islam (Vie et enseignement de Tierno Bokar le sage de Bandiagara). Des écrivains d’une aire culturelle très proche, Amar Samb, Chérif Adramé Seck ou Alioune Badara Seck, avec Matraqué par le destin, ou la vie d’un talibé (1973), Njangaan (1975) et Le Monde des grands (1988), se sont investis de la même mission, leur source d’inspiration étant leur cadre de vie et les pratiques éducationnelles qui y ont cours.
De ce point de vue, Boubacar Boris Diop est l’auteur résident qui en 2003 s’est engagé le plus fermement dans l’écriture du pays d’origine, qu’il réalise dans sa langue maternelle: le wolof. Puisant dans le quotidien d’un quartier de Dakar (auquel il donne dans le roman le nom d’un faubourg de la ville de Bamako au Mali, Ñarelaa), Doomi Golo brosse une fresque de personnages emblématiques: vieillards ayant consigné toute la mémoire d’un lieu (Ngiraan, Aali Këbóoy), mères dont la présence est indispensable à l’équilibre et du récit et de la communauté (Biige Sàmb ou Yaasin Njaay), pères dont on juge de la conduite (Asan Taal), ou voisins aux ambitions politiques irrépressibles (Baay Ndeene), marabouts au rôle social ambigu (Sinkum Kamara), fous dont on rit mais qu’on écoute (Aali Këbóoy), lutteurs dont les exhibitions publiques marquent l’espace d’une estampille traditionnelle (Tafaa Géy, Mbay Géy, Manga, Tubaabu Joor, Bàlla Béey). En outre, des adolescents figurant dans la narration comme des comparses (Mbisaan et Mbisin), dont aucun détail, dans les traits physiques comme dans la complexion mentale, n’échappe à la sagacité parfois froidement cruelle de l’écrivain. Le fantastique et le réalisme se mêlent dans ces coups de crayon appliqués à saisir avec fidélité la vie observable de petites gens occupées à leurs querelles de ménage ou de parti politique, et dont les silhouettes, à la fin du roman, ne manquent pas de grandeur.
Dans Doomi Golo le pays d’origine a pour cœur le quartier de Ñarelaa autour duquel est bâtie toute la narration, que celle-ci ait trait à l’histoire des habitants du lieu ou à celle de la communauté nationale, voire à des événements survenus hors du pays. Centripète, cette vison du monde érige Ñarelaa en un observatoire: Badu, qui réside à l’étranger, doit impérativement revenir dans ce gox (espace réduit) afin que la médiation des énonciateurs principaux – Ngiraan et Aali Këbóog – soit accomplie. Yaasin Njaay, l’épouse d’Asan Taal, qui a longuement séjourné à Marseille, où ses frasques lui ont aliéné à jamais l’estime de ses compatriotes, y rentre (à Ňarelaa) pour découvrir sa véritable identité. Enfin, c’est à Ñarelaa que se ferme le roman, entourant ainsi ce lieu d’une auréole et affectant aux gestes et aux paroles de ses habitants les contours d’un cérémonial orchestré par le seul grand-père : Ngiraan.
Au-delà de Ňarelaa, c’est Dakar et ses quartiers – Rëbës, Plateau ou Ňaay-Cokkeer –, son aéroport Lewopool Sedaar Seŋoor et l’animation des rues (dont Tali Ngaala Jóob), qui constituent les décors du récit, alors conçu comme soumis à une volonté de direction de conscience: Ngiraan, un ancien élève de Ustaas Mbay Lóo, s’y adresse à un petit-fils dont il souhaiterait, à son tour, faire son disciple.
La focalisation du roman sur un espace africain servant ainsi de gage à son authenticité est cependant nuancée par des écrits récents. Fatou Diome, dans un roman «aquatique», Le Ventre de l’Atlantique(6), fait de l’espace sérère un lieu étouffant: Niodior, le village d’origine de l’héroïne, n’est pas un centre vers lequel converge tout le dispositif narratif, mais le prétexte d’un hymne entonné à la gloire de l’errance, un des motifs les plus récurrents dans la production littéraire des migrants. Niodior est peu ouvert au monde extérieur que l’instituteur Ndétare – affecté ici, et développant généralement «une rhétorique anti-émigration» (VA, 159) –, conseille à Salie d’aller découvrir.
Comme moi, tu resteras toujours une étrangère dans ce village, et tu ne pourras pas te battre chaque fois qu’on se moquera de ton nom […] Apprends tes leçons, avec un peu d’efforts, tu quitteras un jour ce panier de crabes»(VA, 89).
Niodior, avec son «nombre d’enfants impressionnant» (VA, 213), ses «polygames à cœur-quadrige» (VA, 213), est à ce point coupé des grands débats du monde contemporain qu’il est conçu par les autorités politiques du pays comme un lieu idéal pour bannir tous ceux qui contrarient leurs projets : «En envoyant Ndétare, ce syndicaliste gêneur, dans le ventre de l’Atlantique, le gouvernement espérait le voir sombrer avec ses idéaux.» (VA, 147) Le pays d’origine connote ici la réclusion et, de siècle en siècle, la perpétuation de traditions critiquables, mais que personne, sous peine d’ostracisme, n’ose publiquement dénoncer. Aux yeux de la romancière, l’attachement au pays d’origine, quoique naturel, est souvent signe de paresse, quand il n’est pas soumission totale à des règles communautaires hostiles à toute initiative individuelle. Dès lors, au nom de la liberté individuelle et du droit de chacun à user de sa liberté de conscience, elle entrevoit toutes les possibilités de se défaire de l’étau de la «coutume », toutes les sorties imaginables du piège de l’appartenance culturelle : «Si l’île est une prison, toute sa circonférence peut servir d’issue de secours.» (VA, 153)
Aux laminaires qui s’agrippent aux flancs de l’île comme pour conforter son immobilisme, Fatou Diome préfère les algues qui se laissent emporter par les flots. Elles sont plus accordées à son tempérament :
Alors, partout où je pose mes valises, je suis chez moi. Aucun filet ne saura empêcher les algues de l’Atlantique de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu’elles traversent (VA, 295).
Toutefois, en dépit de sa condamnation de l’enfermement identitaire, Fatou Diome reste un auteur «classique», car ses livres s’ordonnent autour d’un style, tout comme ceux de Cheikh Hamidou Kane ou de Bernard Dadié. Comme eux elle croit en la valeur éminente de la forme.
Les migrants
On a présent à l’esprit le contact de Léopold Sédar Senghor avec l’Amérique, et particulièrement avec Harlem où il débarque en 1954 comme membre d’une délégation française de l’O.N.U. En fait, cette découverte est plus ancienne. Etudiant à la Sorbonne, Senghor avait déjà beaucoup lu sur les Noirs américains. Par le truchement de la littérature comme par celui de la musique, il était au fait de la condition des populations noires auxquelles il fait des allusions éparses dans l’ «Elégie des saudades» [«À New York»] où sont évoqués les «murs ardents de Chicago » ou New York et le Middle West derrière un rideau de pluie:
Ecoute New York! ô écoute ta voix mâle de cuivre ta voix vibrante de hautbois, l’angoisse bouchée de tes larmes tomber en gros caillots de sang
Ecoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang tam-tam.(7)
Manhattan et sa fébrilité stérile aux yeux du poète ont vidé le temps de sa substance. Tous les repères culturels de l’homme sérère – la nature, la vie, la joie, la tendresse, la sagesse, l’amour, la saine nudité des corps – y sont brouillés. D’où la sensation du poète d’y passer des «heures vides ».
En revanche, l’inspiration surgit des profondeurs de Harlem, aux antipodes du tourbillon new-yorkais. Dans Harlem, Senghor retrouve des sensations proches de celles suscitées par le pays natal :
J’au vu dans Harlem bourdonnant de bruits de couleurs solennelles et d’odeurs flamboyantes
– C’est l’heure du thé chez le livreur-en-produits-pharmaceutiques
J’ai vu se préparer la fête de la Nuit à la fuite du jour. Je proclame la Nuit plus véridique que le jour.
C’est l’heure pure où dans les rues, Dieu fait germer la vie d’avant mémoire
Tous les éléments amphibies rayonnants comme des soleils.
Harlem Harlem! voici ce que j’ai vu Harlem Harlem! Une brise verte de blés sourdre des pavés
labourés par les pieds nus de danseurs
Dans […]
J’ai vu le ciel neiger au soir des fleurs de coton et des ailes de séraphins et des panaches de sorciers.
Ecoute New York! ô écoute ta voix mâle de cuivre ta voix vibrante de hautbois, l’angoisse bouchée de tes larmes tomber en gros caillots de sang
Ecoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang et tam-tam. (ANY, 55-56)
Cependant, dans la vision américaine contenue dans l’œuvre poétique de Senghor, l’image finale est celle d’un continent réconcilié avec lui-même(8): «les Blancs et les Noirs, tous les fils de la Terre-Mère » entonnant les mêmes chants et dansant, rassemblés autour des défenseurs de liberté : Washington, Langston Hugues, Du Bois, Malcolm X, Kennedy, Angela Davis. Martin Luther King figure dans ce tableau comme le «frère » du poète, qui bat la mesure de l'«Élégie pour Martin Luther King»:
La Négritude debout, une main blanche dans sa main vivante
Je chante l’Amérique transparente, où la lumière est polyphonie de couleurs
Je chante un paradis de paix.(9)
Dans l’univers poétique senghorien, l’émigration, au-delà des souffrances inhumaines que suppose le déplacement forcé de populations qu’elle a pu être – commerce triangulaire, colonisation –, demeure pour les terres d’arrivée un fabuleux trésor. L'auteur réhabilite, dans de vieilles cultures ou civilisations technocratiques en déshérence, de vraies valeurs humaines. Dès lors, la ville de New York, symbole à ses yeux de toutes les certitudes matérialistes, et de l’insensibilité à la poésie de l’existence, devrait pour son salut spirituel s’ouvrir à la parole des immigrés rangés derrière la population noire:
New York! je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang
Qu’il dérouille tes articulations d’acier, comme une huile de vie
Qu’il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes (ANY, 56).
Comme Senghor, qui n’a fait qu’un bref séjour à New York, Bernard Dadié aussi a produit des pages sur le pays-continent (l’Amérique), où l’appel à l’égalité raciale et à la prise en compte de la richesse culturelle de l’émigration noire dit tout le dépit de l’écrivain ivoirien: celui ressenti devant le spectacle d’une Amérique oublieuse des forfaits qui sont à l’origine de son étincelant développement technique:
Harlem, nouveau radeau de la Méduse sur le Mississipi, sur l’Hudson, sur l’East River! Harlem des sueurs, de la faim, des cris, des larmes et des rires pour abuser les gosses! Harlem des Church à entretenir l’espoir et des cafés pour tromper la faim…! Jazz de Harlem, jazz de protestation et de combat! Artistes de Harlem, hérauts de tous ceux qui sont disparus dans les océans de coton et de tabac! Filles de Harlem, filles montant la garde dans une immense rizière aux bas-fonds pleins de musique pour travailleurs de force. Harlem quartier nu, «dark-water » aux pieds des buildings! Harlem qui s’éclaire avant les autres quartiers pour voire clair dans le jeu et panser ses plaies! Harlem cale de l’immense navire américain dont le mât se nomme Empire State Building! Quand donc vont-ils cesser les appels déchirants qui montent de ce village africain au cœur de New-York? (10)
Aux yeux de ces auteurs (Senghor, Dadié) une réalité est prééminente: de l’émigration surgissent toujours des valeurs fécondantes pour les sociétés impérialistes.
Variations
En 1974, dans le sillage de L’Aventure ambiguë, Chaîne de Saïdou Bokoum revenait sur le thème du héros de roman déboussolé parce qu’ayant quitté son pays pour se fourvoyer dans l’espace inquiétant d’une France dont il ne maîtrise aucun des codes sociaux. Kanaan Niane, le personnage principal du récit, échappe au suicide à la fin de Chaîne, puis se dédie à l’aide à ses frères de misère, des immigrés comme lui qu’il veut détourner du dégoût d’eux-mêmes. C’est dire que la littérature avait annoncé l’émigration comme un parcours destructeur, à une époque où l’unanimité était belle autour des valeurs-refuges que constituaient le continent et son passé, la patrie ou la langue.
Aujourd’hui cette attitude est relayée par les points de vue les plus variés, allant de celui de Doomi Golo quiplaide pour un retour aux sources linguistiques et philosophiques (Kocc Barma Faal), à celui des écrits de guerre qui, tel La Mort ne veut pas de moi (1997) de Yolande Mukagasana, préviennent contre les dangers de la susceptibilité ethnique.
Cette évolution passe aussi par une nouvelle littérature de l’hybridité dont on ne saurait écarter Marie Ndiaye parmi les chefs de file, et à laquelle se rattachent Dossier classé d’Henri Lopes, 53 cm de Bessoraou encore Lagon, Lagunes de Sylvie Kandé ou Cola Cola Jazz de Kangni Alem. Les personnages centraux de ce courant littéraire n’entretiennent plus avec le pays d’origine – d’un des parents tout au moins – un rapport inconditionnellement révérencieux, car là n’est point la «source de Simal» d’où proviendrait toute la sève des œuvres. Cette dernière est au contraire puisée dans un sol plus composite «où les continents tremblent sur leurs plaques et où les détours de la filiation s’enchevêtrent en un vertige»(11) Fanny, l’héroïne de En famille de Marie Ndiaye (1990), est à cet égard la représentante d’un groupe de personnages romanesques mis au ban des familles reposant étroitement sur des certitudes mono-raciales ou mono-culturelles. Les amertumes de sa condition comme le sort de ses congénères (chez Lopes ou Kangni Alem) sont dépeints avec une grande lucidité. Pourtant, dans cette écriture de l’altérité, la clé des œuvres n’est pas dans le ressentiment. Elle serait plutôt dans une grande méfiance à l’égard des séductions du discours univoque de l’enracinement identitaire. Quelle est l’origine précise? De quelles racines a-t-on à se couper? Quelle terre tient-elle lieu de bercail? Telles sont les interrogations taraudantes. Pareilles aux personnages beckettiens(12), ces nouvelles figures du roman subsaharien sont au fond d’eux-mêmes des êtres irrémédiablement solitaires.
C’est ainsi que, dans Dossier classé d'Henri Lopes,le personnage principal, Lazare Mayélé, avoue dès les premières pages, avoir «une maîtrise insuffisante de la langue du pays»(13), en dépit des cours que lui donne Mama Motéma à la rue Théophraste Renaudot, afin qu’«il n’oublie pas la race» (DC, 12), lui qui est né en France et qui, après une dizaine d’années passées aux Etats-Unis, officiera comme journaliste au African Heritage. Il épousera une femme blanche américaine, Nancy. Et tout le mouvement de retour vers l’Afrique passera par une enquête palpitante pour retrouver les traces de l’assassin de son père : Bossuet Mayélé, un militant pour l’indépendance du Mossika, nommé bâtonnier de l’ordre des avocats après s’être éloigné de ses idées pan-africanistes pour redevenir chef de tribu. Il a été enlevé le 22 mars 1966. Le romancier précise malicieusement: «Le Mossika ne figure sur aucun Atlas. Ce pays existe pourtant, il appartient à mon Afrique intérieure» (DC, 16). Lorsque le narrateur débarque au Mossika, il y est l’objet de moqueries visant sa peau – trop claire selon ses habitants – et les efforts qu’il fournit pour «parler en langue» s’avèrent souvent maladroits.
La capitale du Mossika, Likolo, n’a pas de musée, et le Mossika en général est un Etat «où l’on ne connaît jamais la vérité » (DC, 236) sur quelque sujet que ce soit. Mal à l’aise avec la langue du pays et mal informé quant aux faits politiques qui l’ont amené à y séjourner pour le compte d’African Heritage, Lazare Mayélé vit en porte-à-faux par rapport aux réalités épaisses du Mossika. Une de ses tantes, Elodie, s’en rend compte, et lui propose, pour qu’il «retourne vers son sang», d’épouser une de ses cousines. Et lorsqu’il proteste qu’il est déjà marié en Amérique, elle lui demande: «Où est le problème, tu es un Noir, non? » (DC, 198).
Tout en décrivant la difficulté pour l’être métis qu’il est d’évoluer avec aisance dans le Mossika, Lazare Mayélé n’en remet pas pour autant la légitimité du combat de son père pour la liberté du pays. On lui a raconté en effet que, avant que son père et les militants indépendantistes n’aient arraché la direction du pays aux Blancs, son propre grand-père avait été fouetté par ces derniers sur une place publique. Comme il fallait réagir contre de telles humiliations, l’indépendance était un besoin impérieux. Cependant, la force du livre est dans le refus, une fois la souveraineté nationale acquise, de continuer à condamner les colons et le pays colonisateur: «Il nous faut changer notre mentalité. Il ne suffit pas de tout mettre sur le compte du colonialisme, de l’impérialisme et de faire l’apologie de nos sociétés communautaires…» (DC, 223).
Il n’est par ailleurs pas question pour Lazare Mayélé, qui doit rentrer en Amérique sans avoir percé le mystère de la mort de son père, de jeter l’anathème sur le Mossika, qu’il préfère abandonner à l’opacité de sa vie administrative, à l’incohérence de son régime social, et à la cruauté de ses sphères politiques.
Encore ici on voit bien que l’œuvre d’Henri Lopes est hantée par un souci permanent des frontières – ethniques, raciales, nationales – héritées ou non de la colonisation, et que les personnages de Sur l’autre rive (1992)par exemple cherchent à transcender. Marie-Eve, le personnage principal de ce livre, dont la mère ne sait ni lire ni écrire, parle et agit – par la peinture aussi – pour échapper à tout enfermement identitaire. D’où ses nombreux voyages, ses amours tumultueuses et son incrédulité vis-à-vis de tout enracinement unilatéral, uni-radical. De ce point de vue Dossier classé est l’expression d’un double regret: «Bossuet Mayélé était trop grand pour ce pays. Il n’aurait jamais dû y revenir » (DC, 223). Quant au fils, Lazare, il est à la fin du livre convaincu que son voyage au Mossika n’a en rien répondu à ses attentes :
Il était temps de rentrer au bercail. Où était mon bercail? En avais-je un? Je suis un sans-domicile-fixe, plus précisément un sans-identité-fixe. (DC, 248)
Alors, sur le campus de Haverford, la nuit même de son retour aux Etats-Unis, il a l’intention de répondre à Nancy – avec qui il fait l’amour – qui souhaite que leur enfant à naître soit appelé Bossuet Mayélé : «Ce prénom est ridicule. Il ne faut pas rouvrir des dossiers classés.» (DC, 252)
D’autres auteurs migrants déconstruiront diversement la trame romanesque habituelle: Kangni Alem par exemple. Aussi, lorsque l’on pénètre dans l’univers tourmenté de Cola Cola Jazz (2002), Héloïse Blinneka est-elle le personnage qu’il convient de suivre si l’on ne veut pas se perdre dans les tours et détours de l’intrigue. Elle a été conçue dans un train de banlieue par une mère française qui, après deux ans de vie commune avec son père, le fera expulser de France. A vingt ans, la fille part à la recherche du père, dont elle sait qu’il est un Africain. Elle croit aussi qu’il s’appelle Antoine Ganda, selon le nom qu’il a fourni au contrôleur qui l’a verbalisé: il n’avait pas de titre de transport en règle le jour où il a rencontré la mère d’Héloïse.
Après la naissance d’Héloïse, sa mère, séparée de son père, se drogue. Bien plus tard, Héloïse elle-même multipliera de façon suicidaire les relations sexuelles avec des amants toujours plus vieux qu’elle. Mais, un beau jour, elle décide d’aller rencontrer son père à Tibrava, le pays natal de celui-ci, sur lequel s’exerce une sévère dictature militaire au service de Yamatoké, un «ancien marmiton aux armées coloniales»(14). A Tibrava vit la demi-sœur d’Héloïse, Parisette, qui, bien que délurée, reste un soutien important du père. Ce dernier tentant toutes sortes de recettes pour devenir riche, allant jusqu’à créer une entreprise de pompes funèbres, parce qu’ayant observé qu’autour de lui les morts se comptent par dizaines toutes les semaines. «Et depuis lors, la fortune de père n’a plus jamais cessé de prospérer,» se réjouit Parisette (CCJ, 135).
En fait, le père, écrivain raté, n’a jamais su terminer Le Manioc rouge, le récit autobiographique qu’il s’était promis de publier. Il révèlera aussi à Héloïse que Parisette n’est pas sa sœur. La nouvelle soulagera l’héroïne qui venait d’avoir avec sa supposée aînée des relations charnelles hors-nature. Et le livre se termine sur ce constat amer d’Héloïse, partie en Afrique pour retrouver ses racines: «Certains retours sont impossibles» (CCJ, 197).
Si cette littérature exprime une profonde inquiétude devant le destin des peuples enracinés dans une histoire pluriséculaire et vigilante à rester dominante ; et que la promotion qu’elle donne aux domaines jusqu’ici tabous des attirances homosexuelles, de l’adultère, voire de l’inceste, élève ces déviances au rang de rituels initiatiques ; c’est qu’à l’émigration sont souvent attachés une angoisse et un souffle d’abîme venus des profondeurs de la détresse.
Donner le change
On avait déjà noté que sur les traces de Georges Ngal (Giambatista Viko ou le viol du discours africain, L’errance) dont la création littéraire reflète avec parcimonie l’origine nationale,(15) Kossi Efoui ou Sami Tchak, qui étaient allés beaucoup plus loin dans la voie de l’émancipation par rapport au déterminisme culturel caractéristique de l’écriture des années 1920 à 1970, avaient réussi à donner le change quant à l’espace précis de La Polka ou de Hermina. Du reste, après un premier roman (Place des fêtes en 2001) où il n’épargne aucune des icônes du sanctuaire des générations antérieures – mère, père, famille, patrie –, Sami Tchak continue avec Hermina (2003)et La fête des masques (2004) à contourner – dans ses romans – le territoire habituel de l’écriture francophone subsaharienne. Sans doute s’agit-il ici d’un des exemples les plus réussis d’une création – par un auteur africain – d’un espace imaginaire où la terre d’origine est à peine perceptible dans la microstructure du récit. En l’occurrence, l’inspiration naît d’une multitude de lectures – surtout dans Hermina – ou d’une plongée dans l’univers hispanophone, dont cependant bien des lieux interlopes pourraient rappeler une certaine Afrique déstructurée dans sa vie citadine. Livré à la permanence de son pessimisme, le romancier poursuit, en France, loin des limites imposées par les conventions, une œuvre romanesque originale par son style éclectique comme par son contenu subversif.
Le premier volume, Place des fêtes, n’avait retenu que l’attention d’une minorité. L’accueil fait au second, Hermina, révèle un élargissement d’audience non négligeable. Jusqu’ici, tous les romans de cet auteur déplacent l’accent porté par ses aînés sur des valeurs culturelles communautaires, à l’individu dépeint comme si pour lui le passé était considéré comme clos, et sans lien avec la vie qui se poursuit, «poreuse à tous les souffles du monde»(16). La poésie de l’enfance, qui avait nourri les écrits d’avant, n’éclaire plus cette littérature impatiente de prendre ses distances avec un passé opaque. Sans doute, pour leurs visions pessimistes, conviendrait-il de rapprocher l’œuvre de Sami Tchak de celle de Bolya (Les Cocus posthumes 2001, Afrique, le maillon faible 2002), la seconde étant volontiers plus pamphlétaire.
Sur un mode moins iconoclaste, d’autres auteurs migrants, Gaston-Paul Effa (Quand le ciel se retire ou Cheval-Roi), Sénouvo Zinzou (Le Médicament) ou encore Tierno Monénembo (Pelourinho),déterritorialisent le roman en le situant en Aquitaine ou dans le bocage normand, en Allemagne ou au Brésil, sans pour autant renoncer au fonds anthropologique du Cameroun, du Togo ou de la Guinée. Et la même remarque vaut lorsqu’il s’agit de la ville de Strasbourg chez Fatou Diome (Le Ventre de l’Atlantique), de Paris – ses quartiers ou sa région – dans l’œuvre de Daniel Biyaoula (L’Impasse, Agonies) ou celle de Calixthe Beyala (Le Petit Prince de Belleville, Maman a un amant, par exemple). Il en va de même de l’Amérique du Nord dans Dossier classé d’Henri Lopes pourtant fortement inspiré de Beto na beto de Mambou Aimée Gnali (2001). La voix de ces écrivains n’est plus repliée sur l’espace africain, mais elle en garde le timbre et les accents d’origine.
On peut encore remarquer que certaines œuvres littéraires, après s’être longuement poursuivies à l’étranger, se closent dans leur pays d’origine: de Ville cruelle (1954) à Branle-bas en noir et blanc (2000), celle de Mongo Béti est à cet égard exemplaire. Elle s’est, même lorsque son espace d’écriture a souvent été la France, abondamment nourrie d’épisodes et de personnages tirés de l’histoire sociale et politique du Cameroun. Ainsi peut-on aussi appréhender l’univers romanesque de Tierno Monénembo dont les textes, des Crapauds-brousse (1979) à Peuls (2004) en passant par Cinéma (1997) – qui sur fond de quête identitaire allie à une haute élaboration stylistique la flamme des paroles anti-impérialistes -, ont pour thème récurrent la démocratisation de la Guinée.
Selon une démarche sensiblement différente, certains écrivains qui ont entamé leur œuvre à l’étranger, l’y poursuivent tout en traitant de sujets en référence perpétuelle au pays d’origine: outre Bolya, peuvent être cités Olympe Bhêly-Quénum ou Daniel Biyaoula. Et c’est dans cette perspective que l’on peut voir un lien entre Abdourahman Wabéri et Charles Djungu Simba, Sévanou Dabla et Alain Mabanckou, Amadou Elimane Kane ou Mariama Barry.
La fidélité aux origines se traduit ainsi dans l’œuvre romanesque de Gaston-Paul Effa par des notations culturelles très précises, y compris dans ses textes entièrement situés en France: Quand le ciel se retire (1993) peut ici être cité. Le romancier y décrit, à la manière de M. Jouhandeau (De l’Abjection) ou de G. Bataille (Edwarda), les amours illicites d’un homme d’église découvrant avec Roberte, une femme mariée, l’ivresse des sens et la sensation que le péché confirme l’essence surnaturelle de l’homme. Ce prêtre français, le narrateur le fait naître en Afrique d’où il partira très vite sans en comprendre les «secrets ». Il en connaît cependant certaines populations sur lesquelles il pense pouvoir porter des jugements: les bétis, doualas, bamilékés et bassas ‑ ce qui situe l’univers de référence au Cameroun. Et c’est toujours de cette géographie natale que traite La Saveur de l’ombre (1993) lorsque l’auteur s’en prend à la polygamie d’Etoga, un chef béti dont l’arrogance n’a d’égale que son inaptitude à comprendre ses épouses ou ses compatriotes provenant d’autres horizons linguistiques et culturels.
C’est dire que le séjour en France, loin d’émousser la référence à l’espace culturel d’origine, stimule au contraire l’élan patriotique, conférant ainsi à la littérature des migrants une facture civique à l’image de l’écriture des résidents. Tierno Monénembo, en désignant l’évocation littéraire du pays d’origine par «le film de ses souvenirs»(17), inaugure ainsi un courant fécond où Abdourahman Wabéri, avec Le Pays sans ombres (1994), Cahier nomade (1995), Balbala (1997), Rift routes rails (2001) compte parmi les écrivains les plus représentatifs, à côté d’Alain Mabanckou (de Bleu Blanc Rouge en 1998 ou Et Dieu seul sait comment je dors en 2001) ou de Daniel Biyaoula (de L’Impasse en 1996 ou d’Agonies en 1998).
Quelque lointain que puisse être l’espace fictif où se déploie le roman subsaharien, ce monde neuf demeure pris dans les ombres intérieures du pays natal. Dossier classé d’Henri Lopes (2002), dont le Mossika sert de cadre mythique, n’échappe pas à cette tendance générale de l’écriture. Et Daniel Biyaoula dans La Source de joies (2003), en dépit de la critique torrentielle déversée sur les clivages ethniques en pratique dans l’univers originel, et au-delà de la terreur des «grands guides » et du népotisme outrecuidant, laisse percevoir un profond attachement aux paysages qui égayent les deux bords du fleuve Congo, inépuisables sources d’inspiration auxquelles sont consacrées les plus belles pages du roman.
C’est dans la mesure où «Boubou Blanc » dans Cinéma de Tierno Monénembo et le «Musulu » de La Chorale des mouches de Kadima-Nzuji en 2003 – où l’on n’accorde sa confiance qu’à des «gars de chez soi et de sa langue »(18) -, ne sont autres que des images destinées à peindre de manière biaisée les réalités politiques et économiques des pays d’origine des deux auteurs, que ces romans, écrits entièrement ou en partie en Europe, sont en réalité de Guinée ou du Congo-Zaïre, et distillent un puissant désir de fuite hors d’une réalité accablante. Ils sont en effet nés de réminiscences éprouvantes. Et la ligne inflexible et ténue de leur écriture consiste en la dénonciation.
La figuration du réel par métaphores plus ou moins explicites trouve encore l’une de ses plus belles réalisations dans Le Médicament deSénouvo Zinsou (2003). «Bayerrode » est facilement identifiable à la ville allemande qui sert de cadre d’écriture au livre. D’ailleurs, l’un de ses professeurs d’université est nommément cité dans cet autre roman africain en partie écrit en Bavière, La Chorale des mouches de Kadima Nzuji. Quant au Médicament, il plante «Dugan » comme décor de son cours africain, ville dont la capitale est «Puta » que le narrateur s’amuse à faire paraître comme simplement romanesque. Le lecteur y décèle cependant l’un des pays du Golfe du Bénin où l’on est accoutumé à consommer de l’akume et où sévit le Général Gnagbaza dont le Service de Renseignements est redoutable, et l’oligarchie qui le protège abominable.
L’angoisse liée à l’exil en Allemagne est palpable dans les propos de chacun des personnages créés par Zinsou. Le Médicament pourrait ainsi se lire comme une œuvre nostalgique du pays natal.(19) Au détour de chaque prise de parole on pourrait percevoir des gestes et un accent issus de la culture mina, un dialecte de l’éwé en usage surtout à Lomé et dans la région d’Aneho. Le yoruba aussi se profile dans les discours. Il est la langue de la grand-mère de l’écrivain :
L’influence de la langue et de la culture yoruba était d’ailleurs très présente, non seulement dans notre maison où nous communiquions cependant en mina, mais aussi dans tout notre quartier appelé Anagokomé, où s’était installée une colonie yoruba venue en partie directement du Nigéria, après avoir transité par Ouidah, Agoné ou encore Atakpamé.(20)
Le rapprochement, dans la peinture sur le vif des misères de l’exil, peut être fait avec d’autres auteurs migrants. Ainsi, la partie la plus significative de l’œuvre littéraire de Charles Djungu-Simba relève-t-elle de cette poétique du manque et de la marginalisation : de Cité 15 en 1989 à Ici ça va en 2000 – publié à L’Atelier des Ecrivains Marginaux (à Bruxelles), lequel précise dans le préambule présentant l’écrivain congolais au public belge : «Hors-champ, marginaux ou clandos, les auteurs qu’éditera L’Atelier des Ecrivains Marginaux ont tous dû quitter leurs pays respectifs afin d’échapper à diverses misères »(21) -, en passant par Des milliers de vies au taux du jour (1996) et En attendant Kabila (1997), pour culminer dans Nuages sur Bukavu (Les Editions du pangolin, 2007).
Né en 1953, Charles Djungu Simba a d’abord été enseignant, puis journaliste jusqu’à sa révocation, sous Mobutu, de la Radio et Télévision Nationales Congolaises. Ce parcours parsemé d’embûches politiques, l’écrivain a tenté de l’exorciser par plusieurs biais : d’abord par la création de sa propre maison d’édition, les Editions du Trottoir, puis parl’écriture romanesque. Réhabilité par Kabila, il sera de nouveau radié. Aujourd’hui, en exil depuis 1998, il vit entre la France et la Belgique. Sa polyvalence (récits, romans, recueils de poèmes, contes et nouvelles, essais) est tout entière résumée dans sa dernière publication : Nuages sur Bukavu, carnet d’un détour au pays natal (Les Editions du pangolin, 2007).
Ce livre illustre l’itinéraire d’un migrant à la fois journaliste et enseignant, et qui, revenu au pays natal pour une mission à la fois d’enseignement à l’Université Pédagogique Nationale et de mise sur pied d’une chaîne de télévision dans sa région d’origine, le Kivu, rencontre d’insurmontables difficultés à reprendre sa vraie place dans l’arène sociale. Son séjour s’est déroulé entre 2006 et 2007, et correspond à une période d’élections présidentielles, dites libres. Aussi Nuages sur Bukavu (2007) est-il la chronique sans ménagements des excès liés à cet événement politique : en présence des soldats de la MONUC, les partisans de Kabila livrent une véritable guerre à leurs adversaires idéologiques, dans des rues défoncées, signe d’une décrépitude et des lieux (le pays natal) et des droits de l’homme.
Impuissant devant le spectacle pitoyable d’un Congo à la dérive, l’émigrant n’en est pas moins ardent à clamer son attachement à la terre d’origine, certains poèmes de l’ouvrage laissant percer, derrière l’amertume et le dépit, une foi restée intacte en l’avenir de la patrie. La proximité du titre (Carnet d’un détour au pays natal) avec le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire établit une riche intertextualité impliquant aussi Une saison au Congo. L’écrivain martiniquais sert ici de référence historique et littéraire. Mais ici il convient de noter une différence significative : Césaire est resté à la Martinique, contre vents et marées (voir Moi, laminaire, Ferrements), tandis que les générations suivantes, aux Antilles comme en Afrique subsaharienne, ont souvent plus ou moins longtemps «déserté la hideur des plaies»(22) – économiques, politiques, morales – faites au visage des sociétés post-coloniales. Les lames croisées de la gabegie et des ajustements structurels, de la fuite des cerveaux et d’une mondialisation correspondant à la prééminence d’un modèle social nord-américain plutôt qu’à la somme des spécificités culturelles, ont défiguré un continent où naguère, pour qu’ils soient «lavés de la boue de la Civilisation»(23), un grand poète avait donné rendez-vous à un autre :
sous le kaïcédrat […] Quand fume sur les toits la douceur du soir au soleil déclive / Et que promènent les athlètes leur jeunesse, parés comme des fiancés.(24)
C’est dire que l’écrivain, Djungu Simba, qui regagne l’Europe après un «détour » aux origines, est une âme écartelée entre la terre où de tout son être il entend «battre le pouls profond »(25) de son ascendance, et une terre devenue nourricière, celle de l’exil, matériellement plus nantie. Paradoxalement, et à l’instar de nombre d’émigrants de la nouvelle génération, c’est sur ce second sol qu’il se sent en sécurité, de gares en gares, d’ébauches de livres en conférences. C’est de là qu’il tente de se faire entendre, voire d’inscrire dans la mémoire universelle le souvenir du Kivu.
Ecriture de l’écart, celle des migrants traduit souvent une vie double, conjointement emplie du souvenir du pays réel et des réalités nouvelles du lieu d’accueil. Il n’est par ailleurs pas sûr que les lecteurs les plus réguliers de ces romans de l’immigration soient des résidents africains. Bon nombre des difficultés liées à l’émigration, même dans leur exposé le plus didactique, comme dans Le Ventre de l’Atlantique, ne sont pas assurées de trouver écho dans l’espace public qu’ils visent idéalement. Leur réception est avant tout européenne et conditionne parfois leurs performances linguistiques et la forme aphoristique(26) donnée à la critique sociale sur fond de roman leste.
Aïchetou(27) de la Mauritanie peut être citée ici comme auteur dont la vie et l’œuvre illustrent les déficiences du pays de départ et les espérances, parfois comblées, suscitées par l’émigration: l’initiative individuelle, l’anonymat souvent, et la possibilité d’écrire loin du bruit quotidien des querelles tribales. Elle est née à Archam – Rychian dans ses récits – à côté de Boutlimitt, en 1961 dit-elle, sans en être sûre. Elevée par l’esclave de sa grand-mère, Talya, parce que venue au monde alors que sa mère attendait plutôt un garçon, elle s’est toujours sentie rejetée par la société de son village. Aussi son mariage avec un Italien, et son départ d’abord pour l’Ethiopie (1988-1992), puis pour la France en 1998, seront-ils vécus comme une libération(28) des entraves de sa tribu, les Oulad N’teïchat, un campement replié sur lui-même et rétif à l’idée d’envoyer les filles à l’école française(29).
Son premier roman, L’Impossible retour (Paris : L’Harmattan, 2003), fait suite à un retour décevant en Mauritanie. Eminemment autobiographique, il démystifie le retour aux sources, et milite pour l’indépendance des femmes. Les mêmes thèmes se retrouveront dans La Ligurienne (Paris : L’Harmattan 2003) où en filigrane l’auteur s’adresse à ses deux filles, et sous d’autres aspects dans DivorceZ de Lui (Paris : L’Harmattan 2005), ce dernier titre étant plus énergiquement dirigé contre les intellectuels mauritaniens, lesquels, selon Aïchetou, ont assisté sans broncher à la détérioration de la société mauritanienne et, en 1989, au lynchage des Négro-Mauritaniens. La romancière ne s’éloigne pas des thématiques que voilà lorsqu’elle fait paraître en 2005 Sarabandes sur les dunes, d’abord conçu comme un feuilleton pour distraire un ami malade, et restructuré en récit largement autobiographique, où, au-delà de la description de son campement, la narratrice entonne un hymne vibrant au courage des femmes, et notamment à celui de sa grand-mère et de la vieille compagne de celle-ci, la servante Talya, qui l’a élevée comme une mère.
L’émigration, dans le cas d’Aïchetou, a contribué à la reconstitution de l’être et rendu la parole littéraire plus affûtée à dire l’étroitesse des cultures tribales et la lâcheté des classes dirigeantes dans une Mauritanie largement entourée de voisins négro-africains, mais s’enferrant à s’inclure dans le Maghreb. Le ton d’Aïchetou, tour à tour impudique,(30) outré ou cassant lorsqu’il évoque la Mauritanie comme «un désert interdit à jamais »(31), où entre autres pratiques aberrantes l’on soumet l’honnêteté des femmes à toutes sortes d’épreuves; ce ton, en somme grave, prête rarement à sourire. Il est fait pour décrire par le menu un pays à l’identité ambiguë et aux airs présomptueux, que le lecteur quitte avec soulagement, en compagnie de la romancière en fuite.
L’humour
Si les romans parus entre 1980 et 2006 traitent avec plus ou moins de gravité de l’émigration en relation avec les thèmes de l’identité culturelle (Fatou Diome, Djungu Simba, Zinsou), du statut de la femme (Khadi Hane, Calixthe Beyala, Aminata Zaaria, Ken Bugul) ou du métissage (Marie Ndiaye, Henri Lopes, Sylvie Kandé, Bessora, Kangni Alem), quand ce n’est pas de la dictature politique (Kadima, Caya Makhélé, Tanella Boni), ils se caractérisent par ailleurs par une persistante dérision où le sarcasme, dans le prosaïsme du langage parlé, prend souvent des allures d’exorcisme. Cet humour varie de l’autodérision (Lopes, K. Alem, Bessora) à des visions eschatologiques (Sami Tchak), en passant par la prose à la fois hilarante, élégiaque ou farcesque d’Alain Mabanckou. En effet, dans Verre cassé (2005) tous les émigrants rentrent de leur aventure remplis d’amertume et à jamais désabusés de leur parcours migratoire. Ce qui fait de ce roman, et du bar (Le Crédit a voyagé)qui en est le cœur palpitant, le lieu d’une parole truculente mêlant à la narration des mésaventures financières de l’émigrant celle de ses déboires conjugaux, et, pour finir, lui forgeant un destin picaresque: en dépit de ses efforts intellectuels, de son courage physique et de son extrême vigilance à l’égard de la communauté immigrée dont il craint les jalousies et les manœuvres occultes, son sort demeure pitoyable. L’Imprimeur, personnage loquasse de ce récit de toutes les déchéances physiques et morales, et dont la réussite sociale – bon salaire, grande maison, enfants inscrits dans de bonnes écoles – était incontestable, garde en définitive de son séjour en France le souvenir d’une descente aux enfers orchestrée par l’amour incestueux entre son épouse infidèle et un fils né d’un premier mariage. Il en perdra la raison, au point d’être intarissable dans l’évocation de sa déconvenue:
chaque jour je surprends maintenant l’Imprimeur en train de narrer à quelqu’un d’autre ce qu’il appelle son aventure ambiguë, il m’avait pourtant fait croire que j’étais le seul à qui il l’avait racontée, je pense sincèrement que quelque chose ne fonctionne pas bien dans sa tête, il a des périodes de lucidité, surtout les après-midis, je crois surtout que cette histoire l’a rendu dingue(32).
Entre sublime et grotesque, Alain Mabanckou a su dire la tragédie de ces vies brisées, dont aucune magie, ni même celle de l’écriture la plus délirante – sans points pour délimiter les interminables phrases d’un discours apocalyptique – ne saurait reconstituer les éléments épars. Hilarant lorsqu’il multiplie les épithètes homériques, les énumérations loufoques et les calembours, il fait de Verre cassé l’une des œuvres les plus significatives dans la narration dérisoire de l’émigration ratée.
Conclusion
En associant immigration et folie Mabanckou prend le contre-pied des romans d’Aïchetou, montrant par cette divergence que la littérature romanesque inspirée par le phénomène migratoire d’Afrique subsaharienne vers l’Europe est loin d’être univoque. Elle oscille entre l’exaltation d’un ailleurs propice à l’épanouissement personnel, à la liberté d’expression et au choix d’un mode de vie, même si parfois cette option se paie par une grande solitude (Fatou Diome : Le ventre de l’Atlantique) et la stigmatisation du «paradis du Nord(33) », un miroir aux alouettes, dont les premières victimes, les familles d’immigrés, paient toujours très cher le relâchement de la discipline et l’abandon à la société de consommation : emprisonnements, rapatriements forcés ou violences policières diversement motivées finissent par être leur lot.
Par un autre biais, Daniel Biyaoula montre dans La Source de joies (Présence Africaine 2003) que l’immigré est en fait un éternel insatisfait dans les combats qu’il livre: celui de l’intégration dans la société d’arrivée, et celui de la ré-insertion dans la société de départ. Nostalgique d’une image du passé, et souvent réticent à adopter toutes celles du présent, il se condamne ainsi à une perpétuelle errance entre une hypoculture(34) qui s’effrite ou se sanctifie au fur et à mesure que le séjour européen se prolonge, et une hyperculture de plus en plus prégnante, et efficacement servie par la langue courante du pays d’accueil.
Il arrive aussi que d’une génération à l’autre, l’hyperculture supplante totalement la culture d’origine, et que les enfants issus de l’émigration – ou amenés très tôt en Europe – adoptent la culture marginale et agressive des périphéries urbaines, s’exposant ainsi aux rigueurs de la loi, comme le montre en 2006 Thomté Ryam dans un roman aussi palpitant qu’une excellente partie de football, Banlieue noire (Paris : Présence Africaine).(35) Sébastien, le héros central de ce récit, plaidera à la fin du texte pour une vie plus harmonieuse dans les «cités moches» et reléguées dans les confins besogneux de la vraie vie en France.
Ainsi peut-on noter que de Cheikh Hamidou Kane (1961) à Thomté Ryam (2006), les textes varient dans le traitement de l’émigration comme dans leur écriture. Toutefois, quelles qu’en soient les factures, ils nous intéressent au premier chef, car ils nous permettent d’éprouver une certaine conception du langage et de la littérature : celle de l’historicité des créateurs et de leurs œuvres.
▲
Remarques:
1 Pour une analyse des mécanismes à l'œuvre, cf. V. Porra,
«Langue française, langue d’adoption». Discours et positionnements des romanciers d’expression française originaires d’espaces non francophones dans le champ littéraire français, Habilitationschrift, Universität Bayreuth 2000, 274 pages.
2 K. Kwahulé, «Éloge de l'hérésie », in: S. Chalaye, Le syndrome Frankenstein, Limoges, Editions Théâtrales, 2004, 39.
3 Voir la thèse d’E. Moukodoumou Midepani, Les indigènes évolués dans l’œuvre romanesque de Tchicaya U Tam’si, Université de Paris XII, Centre d’Etudes Francophones, année 2005-2006, 377 pages.
4 Awu est l’abréviation d’Awudabiran, deuxième épouse de «maître Obame Afane », la première «étant morte de chagrin », car «le sort d’une parcelle aride n’était-il pas d’être abandonné au profit d’une terre productive? » Cf. J. Mintsa, Histoire d’Awu, Paris, Gallimard, 2000, 11.
5 Cf. J. Riesz et R. Dion (dir.), Ecrire en langue étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le monde francophone, Francfort–Montréal, IKO Verlag–Editions Nota Bene, 2002, 532.
6 F. Diome, Le ventre de l'Atlantique, Paris, Carrière, 2003 (=VA).
7 L. Sédar Senghor, «À New York», in: L. Sédar Senghor, Éthiopiques, Paris, Seuil, 1956, 56 (=ANY).
8 Cf. R. Jouanny, Espaces littéraires d’Afrique et d’Amérique, tome I, Paris, L’Harmattan, 1996, 79-101 («Trois poètes à New York : García Lorca, Senghor, Dadié »).
9 L. Sédar Senghor, «Élégie pour Martin Luther King», in: L. Sédar Senghor, Poèmes, Paris, Seuil, 1984, 302.
10 B. Dadié, Patron de New York, Paris, Présence Africaine, 1964, 150 (= PNY).
11 E. Glissant, Faulkner, Mississippi, Paris, Gallimard, 1998, 300.
12 Solitaires, et davantage solitaires parmi la foule, ils sont prisonniers d’un temps sans bornes. Il en est ainsi du sort des vieux amants dans Oh les beaux jours!, de celui de Winnie et Estragon ou encore de Hamm et Clov dans Fin de partie. Nagg et Nell dans Fin de partie ressentent aussi cette solitude irréductible, comme Vladimir et Estragon dans En attendant Godot, ou encore la communauté décrite dans Le Dépeupleur.
13 H. Lopes, Dossier classé, Paris, Seuil, 2002, 12 (= DC).
14 K. Alem, Coca Cola Jazz, Paris, Dapper, 2002, 86 (= CCJ).
15 Exception faite de La condition démocratique: Séquestré du Palais du Peuple, son dernier roman, Paris, Editions Tanawa, 2002. Plus que partout ailleurs dans son œuvre littéraire, il s’en prend ici nommément à Mobutu et souligne la responsabilité de ce dernier dans l’effondrement des systèmes politiques et économiques de son pays.
17 T. Monénembo, Cinéma,Paris, Seuil, 1997, 29.
18 M. Kadima-Nzuji, La Chorale des mouches,Paris, Présence Africaine, 2003, 240.
19 Bien que certaines de ces réflexions dépitées de la fin du roman inclinent à penser que c’est partout que les émigrants sont seuls au monde : «La phrase est restée collée à mon esprit depuis ce jour… Alle Menschen…Mesdames, Messieurs… Ausländer…partout…chez vous…dans le monde […]…votre pays…nearly ewerywhere » (S. Zinsou, Le Médicament, Paris, Hatier, 2003, 492.
20 J. Riesz - S. Komlan Gbanou - S. Agbota Zinsou, «Pratiques de langue et d'écriture des écrivains africains d'expression française vivant en Allemagne. L'exemple de Sénouvo Agbota Zinsou », in: Riesz-Dion 2002, 534.
21 Le texte entier est celui-ci : «Hors-champ, marginaux ou clandos, les auteurs qu’éditera l’Atelier des Ecrivains Marginaux ont tous dû quitter leurs pays respectifs afin d’échapper à diverses misères. Dont celle de s’user dans les tabloïdes et dans l’inédit. Au programme des illusions qu’ils ont eu à perdre : s’imaginer que l’Europe les aiderait à sceller leurs talents d’hommes de lettres! Partout, ils n’ont trouvé que ghetto éditorial et rôle de marrons. L’Atelier leur offre, pour eux-mêmes, la chance de ne pas perdre la main et, en faveur des générations à venir, un espace pour s’acquitter du devoir de témoignage. Le tout dans la marginalité ». Texte annonçant l’esprit de la maison d’édition, sise au 39, rue de l’Agrafe, 1070 Bruxelles. Cf. C. Djungu-Simba, Ici ça va. Récit d’exil, Bruxelles, Atelier des Écrivains Marginaux, 2000, 3.
22 Cf. A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1993, 22 : «Partir. Mon cœur bruissait de générosités emphatiques. Partir… j’arriverai lisse et jeune dans ce pays mien et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair : J’ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies».
23 Cf. L. Sédar Senghor, «Le Retour de l’enfant prodigue », in : Senghor 1984, 48: «Et mon cœur de nouveau sur les marches de la haute demeure. / Je m’allonge à terre à vos pieds, dans la poussière de mes respects / A vos pieds, Ancêtres présents, qui dominez fiers la grand-salle de tous vos masques qui défient le temps. / Servante fidèle de mon enfance, voici mes pieds où colle la boue de la Civilisation ».
24 L. Sédar Senghor, «Lettre à un poète – À Aimé Césaire », in: Senghor 1984, 13.
25 L. Sédar Senghor, «Nuit de Siné », in: Senghor 1984, 14.
26 Cf. F. N’Sougan Agblemagnon, Sociologie des sociétés orales d’Afrique noire, Paris, Silex, 1984, 111-112.
27 Le nom entier est Aïchetou Mint Mohamed Mahmoud Ould Haïmoudane.
28 Cf. la thèse de doctorat nouveau régime de M. Bengoéchéa, La littérature mauritanienne francophone : panorama, analyse, réflexions, tome 3, annexes («Entretien avec Aïchetou»), Paris XIII, 2004, 9- 41.
29 Le parcours scolaire de la romancière est raconté dans Sarabandes sur les dunes, Paris, Harmattan, 2005.
30 Cf. Aïchetou, DivorceZ de Lui, Paris, L'Harmattan, 2005, 139: «J’étais devenue, très jeune une spécialiste de cette partie intime du corps féminin ; chez les Bédouins d’abord, quand, avec ma cousine Salma, nous nous cachions derrière un rideau pour observer une jeune mariée qui aérait ses parties intimes, tout en parlant avec ses camarades, faute d’un minimum d’eau pour se laver. La pauvre chatte de la jeune femme était encore meurtrie par une pénétration qui n’avait pas été particulièrement tendre, nous dégoûtant Salma et moi à jamais des mariages bédouins. »
32 A. Mabanckou, Verre cassé, Paris, Seuil, 2005, 75.
33 Titre du roman de J.-R. Essomba, Le Paradis du Nord, Paris, Présence africaine, 2000, où l’auteur dévoile certains des pièges du parcours migratoire d’Afrique vers l’Europe.
34 Cf. P. S. Diop, Archéologie littéraire du roman sénégalais,Francfort, IKO Verlag, 1995, 18.
35 Au sujet de la banlieue et de ses cultures, lire M.-M. Bertucci et V. Houdart-Merot (dir.), Situations de banlieues. Enseignement, langues, cultures, Paris, INRP, 2005.
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Papa Samba Diop: Ecriture et émigration: les auteurs francophones subsahariens -
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_diop.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25