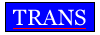 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Le portrait de l’immigré clandestin dans le roman arabe
Miloud Gharrafi (
Toulouse II – Ecoles militaires de St-Cyr Coëtquidan) [BIO]
Email: mgharrafi@yahoo.frâ
Introduction
Depuis la fin des années quatre-vingt du vingtième siècle, la traversée de la Méditerranée vers l’Europe prend une tournure dramatique. Des jeunes et des moins jeunes, issus du Maghreb et de l’Afrique noire, partent en aventures suicidaires vers l’Espagne dans des barques de fortune. Certains trouvent la mort en pleine mer et d’autres atteignent vivants les côtes espagnoles et accèdent au statut de « brûleurs » – ceux qui dans le jargon arabe des jeunes maghrébins ont « brûlé » les étapes et les règles pour émigrer.
Le roman arabe marocain a rapidement saisi l’occasion pour rendre compte de ce phénomène. Il raconte l’histoire de ces jeunes avant et après la traversée, met en scène leur quotidien espagnol ou français, leurs rapports avec l’Autre, l’espace et le temps. Certains de ces romans sont de véritables autobiographies, d’autres émanent d’un vécu que l’auteur a partagé avec ces immigrés. Les romans que nous étudions ici appartiennent à deux marocains : Les Vagues de Mustapha Chaabane et Chroniques d’un immigré clandestin de Rachid Nini.(1) La lecture que nous proposons porte essentiellement sur le personnage de l’immigré clandestin.(2) Nous tâcherons de dégager le portrait de ce personnage tel qu’il s’impose dans une littérature où le réel ressemble davantage à la fiction : qu’en est-il de son quotidien en exil, de sa perception du nouveau monde, de son identité, de son corps et de son pays natal ?
La littérature est un mensonge
Le roman de Nini retrace l’itinéraire d’un immigré clandestin, écrivain et poète, en Espagne. Le narrateur revient sur son passé très proche de poète, sur ses rencontres avec des intellectuels dans son pays d’origine et sa fréquentation des lieux de culture. Une fois immigré clandestin, confronté aux travaux dans les champs d’orangers, à la colère de son patron et à la nécessité de travailler pour gagner sa vie, il remet en question tout son parcours d’intellectuel. Tout au long du roman, le narrateur ne cesse de réaliser le décalage entre le rêve d’un poète et la réalité, entre le travail manuel et le travail intellectuel. S’il lui arrive de joindre l’un à l’autre en écrivant ses chroniques pendant les moments de repos, le personnage-narrateur devient de plus en plus pragmatique et finit par rire des intellectuels. Il les trouve hypocrites et opportunistes :
Les intellectuels sont le plus souvent hypocrites. Pour obtenir une invitation banale à une manifestation culturelle, certains sont prêts à tout […]. Les salauds. Ils pensent qu’ils sont importants pour le monde entier. Les oranges, elles au moins, n’ont pas besoin d’intellectuels. Elles poussent toutes seules. (Chroniques, 27)
Désormais, seul le travail manuel, celui qu’il exerce dans les champs ou dans un restaurant, a un sens et une existence réelle. Le reste, comme les livres, est un mensonge. Le narrateur fait même une découverte : il réalise qu’en lui résident deux personnages à la fois - l’écrivain et le voleur - et espère que le voleur l’emporte sur l’écrivain, car ce dernier « est un menteur. Le voleur vole et ne ment pas. Toute la différence est là ». (Chroniques, 41)
Autre découverte : la littérature aussi ment, du moins celle qu’il a lue dans son pays natal sur l’Europe. La ville de Paris manque de chaleur humaine, les gens ne se parlent pas dans le métro et n’ont plus le temps de donner des renseignements sur les directions, les agents de police se promènent avec leurs gros chiens dans le métro. La Seine est polluée et, en Espagne, les Gitanes ne sont pas aussi belles que nous le fait croire la poésie arabe. La littérature ment parce que le narrateur-immigré clandestin ne perçoit comme véridique que le quotidien pénible auquel il est confronté. Chez Rachid Nini, tout est revu à la lumière des champs d’oranges. L’image de l’espace occidental dont le narrateur a tant rêvé s’effondre et l’écriture, dont il se moque, n’est désormais qu’un outil pour évacuer un malaise profond :
J’écris pour démasquer quelque chose en moi, quelque chose qui me fait honte jusqu’à la mort. Dès que j’aurai le sentiment de l’avoir démasqué, je renoncerai à cette mauvaise habitude que l’on nomme écriture. (Chroniques, 63)
Elle lui permet de s’interroger sur les choses les plus ordinaires de la vie comme par exemple : « J’aime que la femme m’ignore. J’ai besoin de souffrir autant qu’elle. » (Chroniques, 56).
En réalité, derrière la critique faite à l’intellectuel en général et cette tendance permanente qu’a le narrateur à se plonger dans son propre passé de poète – quitte à regretter d’être devenu écrivain au lieu de voleur – , résident une conscience malheureuse, un sentiment de frustration et une difficulté à oublier son statut d’écrivain. En témoignent de nombreux motifs narratifs qui déclenchent à chaque fois la comparaison entre le poète et le travailleur immigré et clandestin. Chaque parole, chaque geste et chaque objet font penser à son statut initial. Voici un exemple typique de cette comparaison :
A chaque fois que Fernando, le chauffeur du camion, arrive, je pense à Fernando Pessoa ; même s’ils ne se ressemblent point. Fernando le chauffeur du camion ne porte pas de petites lunettes de vue comme Pessoa. En plus, Fernando conduit un camion et n’écrit pas de poésie. C’est ridicule. (Chroniques, 29)
L’immigré et l’Autre
Comment lire une littérature sur l’immigration clandestine ou légale sans être constamment interpellé par la dualité « l’étranger » et « l’Autre », en l’occurrence, le Maghrébin et l’Européen ? Les deux romans insistent beaucoup sur cette dualité laquelle n’est pas toujours conflictuelle. Elle est donnée à lire tantôt comme purement culturelle tantôt comme un creuset social et économique entre un Sud pauvre et un Nord riche. Face à des personnages incarnant l’image de l’immigré se trouvent ceux qui représentent la culture locale (européenne) : ce sont d’abord les autorités qui par le biais des policiers civils ou en uniforme poursuivent les sans-papiers. Les Vagues consacre plusieurs pages à ce sujet et fait de son héros un personnage presque obsédé par la peur d’être interpellé par « les démons », ces êtres invisibles qui peuvent surprendre à tout moment l’immigré clandestin : « A Paris, quand je sors le matin je ne sais pas si je reviendrai le soir à ma chambre ou non. » (Les vagues, 9)
Dans le chantier, il craint une visite surprise des « démons »qui agissent sur le rapport du personnage avec le temps et l’espace :« Je n’aime pas attendre devant une cabine téléphonique. […]. La minute à l’intérieur de la cabine n’est pas la même qu’à l’extérieur ou dans ma chambre » (Les vagues,66) La peur est l’élément psychologique le plus dominant dans le roman de l’immigration. Elle résume ce que seule la littérature est capable de dresser comme portrait détaillé et profond de l’immigré clandestin. Elle se manifeste dans les moindres mouvements du personnage et le poursuit même dans son sommeil. Les rêves commencent bien et finissent par des cauchemars ‑ toujours les mêmes, les « démons », les policiers : « Je maudis ma vie. Les démons sont avec moi partout, dans mes maladies et dans mes sommeils. Ils me gâchent la vie. » (Les vagues,37) La même attitude vis-à-vis des policiers revient dans le roman de Nini, mais elle relève plus de la vigilance que de la peur : « Mes yeux étaient fatigués de regarder la fête et de scruter en même temps le public à la recherche des policiers en uniforme. » (Chroniques, 32)
Le narrateur des Chroniques n’est pas aussi obsédé par l’arrestation que Rahhal, personnage de Chaabane. En témoignent, par exemple, les quelques voyages qu’il fait entre la France et l’Espagne ainsi que ses aventures de vol à l’arraché et dans les magasins. C’est un personnage qui prend des risques. Il ne vit pas non plus au même degré que Rahhal le malaise culturel. Ce dernier multiplie les monologues pour faire parler en lui Hamdûn et Intégré, deux voix qui s’entredéchirent, se partagent le personnage et le tirent chacune de son côté. Hamdûn (en arabe louange) représente la culture d’origine, celle qui, faute de lui procurer, dans le pays d’exil, l’atmosphère festive de El-Aid(3), le culpabilise et lui suggère de temps en temps le retour. Intégré, comme son nom l’indique, est la voix de la nouvelle société, celle qui l’incite à s’y installer, celle qui lui dit comme pour le réconforter : « Le plus important est non de savoir où on est mais d’être bien où on est. » (Les vagues,145) Le nom du personnage des Vagues (Rahhal veut dire nomade en arabe) renvoie plus à un voyage à l’intérieur de lui-même (en témoignent ses nombreux monologues) et de son instabilité identitaire que d’un voyage dans des lieux.
Pour parler de l’Autre, celui-ci est perçu dans son entité culturelle, dans ses opinions et ses préjugés :
Les femmes ici pensent que nous sommes des êtres sexuels avec des sexes énormes. Les films à la télévision présentent l’homme arabe comme un idiot qui bave dès qu’il voit une femme et parfois avec un gros ventre et un regard méchant en train de mettre du poison dans le verre de quelqu’un d’autre. C’est pour cela que j’ai toujours pensé que le cinéma est le dernier lieu à fréquenter pour connaître l’Autre. (Chroniques, 52)
En même temps, la thématisation de l’Autre permet aux auteurs de dénoncer le racisme :
Les espagnols ne savent pas grand-chose sur les immigrés (…). Ceux de l’ancienne génération ont connu l’émigration à l’époque de la deuxième guerre civile et du général Franco. Ils savent en conséquence comme il est dur d’émigrer. Ils sont allés au Mexique, en Argentine, en France, en Allemagne et je ne sais où encore et ils n’ont pas honte à présent de dire dès qu’ils voient des Arabes : « Oh ! Ils sont encore de retour ces Maures. » (Chroniques, 74)
Un peu plus loin, nous lisons : « Dans le bus […] j’ai lu gravé sur le siège ceci : les Arabes sont des chiens. » (Chroniques, 177)
Mais l’Autre constitue aussi une identité plurielle. Les héros des deux récits ne rencontrent pas, sur le chemin de l’exil et de la clandestinité, que des êtres hostiles à leur identité (aussi bien dans le sens personnel que culturel). Rahhal apprécie beaucoup le chef de chantier pour ses qualités humaines et admire le geste de cette Française qui offre un cadeau de Noël à un sans-abri (peut-être s’identifie-t-il à lui). Le héros des Chroniques pour sa part, côtoie plusieurs personnages d’origines et de religions différentes et semble plus hostile aux identités sociales (riche vs pauvre) qui le distinguent de son patron par exemple, qu’aux identités culturelles.
La nostalgie
Rahhal est le personnage nostalgique par excellence :
Le temps passe et la nostalgie pour ma famille me saisit. (Les vagues, 65)
L’exil a un prix […]. C’est dans ses déserts que l’on ressent l’amour de la patrie. (Les vagues, 38)
Je pense à la famille…au retour… (Les vagues, 69)
La nostalgie m’envahit… (Les vagues, 70)
Dans les Chroniques le mot nostalgie est prononcé une seule fois, mais intensément et avec un qualificatif qui en dit long sur le rapport de l’immigré avec le passé et le présent : « La nostalgie est mon seul ennemi. Mais jusqu’à présent je la combats avec acharnement. » (Chroniques, 128) L’équivalent arabe de nostalgie (hanîn) peut être ajouté à la liste des mots qu’en fait Kundera dans son roman L’ignorance consacré à juste titre au thème de l’émigration des Tchèques lors de la période communiste. Kundera définit la nostalgie comme « la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner »(4) et retrouve ce sens dans la plupart des langues européennes (aňoranza en espagnol, saudade en portugais, homesickness en anglais, heimweh en allemand, söknudur ou heimfra en islandais, etc.). Nostalgie en arabe ne signifie pas autre chose que le sens de la souffrance et de la douleur. hanîn veut dire exactement pleurs et passions intenses (Cf. Lisân). Souffrances, douleurs, pleurs et passions, autant d’éléments qui ressurgissent dans les deux romans pour exprimer à la fois le mal du pays et le mal à trouver en exil le statut espéré. Autrement dit, c’est souvent le mal en exil qui engendre le hanîn.
C’est ainsi que le présent du narrateur renvoie toujours au passé, y compris le plus lointain (l’enfance), et l’ici à l’ailleurs (le pays natal). Les deux romans procèdent presque de la même façon : devant chaque obstacle, le narrateur-héros compare l’exil à la patrie, replonge dans le passé, remémore son enfance ou pense à sa bien-aimée restée au pays. Quand les deux séries de tableaux disparaissent c’est pour laisser la place à des dialogues et des monologues. Ces derniers sont très fréquents dans le roman de Chaabane.
C’est ainsi également, comme si la nostalgie avait eu raison de l’immigré, que le thème de retour revient souvent dans le roman de l’immigration : « L’idée de retour – dit le narrateur des Chroniques ‑ me traverse l’esprit tous les jours. Mais je pense en même temps que la patrie peut être emportée. Il suffit juste de la rechercher au fond de soi. Lorsqu’on la retrouve, on peut se réconcilier avec elle et l’habiter à nouveau. » (Chroniques, 54)
Il est vrai que la nostalgie est moins fréquente chez Nini, mais le narrateur des Chroniques ne tombe pas non plus amoureux de l’Occident. Le roman révèle même une attitude critique du narrateur vis-à-vis de la société et de la culture occidentales. (52, 54, etc.)
Le corps de l’immigré
Si les deux romans procèdent sur le plan narratif et esthétique de la même façon et se partagent plusieurs thématiques, ils ne dressent pas le même profil de l’immigré clandestin. Rahhal est un personnage fragile, sensible, discipliné, très nostalgique, vigilant et souvent malade – en somme, un personnage passif, pessimiste et profondément malheureux. L’immigré clandestin des Chroniques, lui, est solide, combatif, aventurier et très critique vis-à-vis à la fois de son pays et de l’exil. Le premier cherche à se déguiser en bon citoyen et prend toutes les précautions nécessaires pour détourner le soupçon des « démons » : il donne beaucoup d’importance à la tenue vestimentaire, et se promène ou se rend à son travail toujours avec un cartable. A force d’adapter son physique à toutes les situations de la vie quotidienne, il finit par considérer son corps comme un fardeau. Il le traîne, le soigne, l’habille, le déshabille sans être sûr qu’il ne le trahisse pas puisque son corps est le signe extérieur même de son identité d’étranger, le signe qui ouvre la porte à tous les soupçons :
Je ne suis rien dans ce monde. Je ne fais que traîner ce corps et excelle dans les manières de le cacher de plus en plus des yeux qui le guettent. Je le rétrécis et le dissous quand il fait chaud et le remets à son état initial dès que je regagne ma chambre et ferme la porte. (Les vagues, 83)
Le corps-objet prend une place si importante dans les soucis de Rahhal que ce dernier s’interroge sur le sort qui lui serait réservé s’il trouvait la mort en exil. Il finit par prendre une assurance de décès qui permettrait à son corps d’être transporté au pays pour l’enterrement. La décision est prise : « Ce corps que je traîne ne retournera pas au pays dans une bassine(5) comme au départ. » (Les vagues, 35)
Le personnage des Chroniques, lui, est en revanche fier de son corps. Après de longues études et un avenir toujours incertain, le narrateur prend conscience de l’importance de son corps et réalise que lui seul peut lui venir en aide :
Mes amis poètes parlent, dans leurs poèmes, du corps. Ils disent que c'est une nouvelle mode. Des poètes avec des corps chétifs et souvent malades. Le corps c'est aligner cinq cents caisses dans la camionnette […] sans trouver le temps d'essuyer la sueur sur son front. C'est ainsi que tu testes bien ton corps pour voir si vous vous méritez l'un l'autre. Moi, je pense que mon corps me mérite, parce qu'il ne m'a pas trahi quand j'avais besoin de lui. Ce n'est pas comme les livres et les poèmes qui trahissent jusqu'à la mort. (Chroniques,8)
Son corps peut même le sauver de l’expulsion dans la mesure où il témoigne de l’intégrité physique de son maître : « Il suffit de montrer tes mains aux policiers s’ils te demandent ta pièce d’identité pour qu’ils soient persuadés que tu travailles péniblement dans les champs et te libèrent » (Chroniques, 177). Il est en fait sa seule pièce d’identité, la vraie, la plus authentique qui lui garantit la légitimité de rester sur le sol de l’exil malgré sa véritable identité de clandestin.
Conclusion
Avec ces deux récits, le roman arabe de l’immigration se trouve complètement renouvelé. Il marque une rupture claire avec le roman de l’immigration des années soixante, lequel relatait l’immigration légale de l’étudiant arabe en Occident et mettait l’accent davantage sur la problématique du retour et du choc culturel.
Le ton dans le récit de Chaabane est triste. Dans celui de Nini, il est très humoristique. Mais les deux se donnent à lire comme une littérature de témoignage.(6) Dans ce témoignage, la réalité du clandestin semble relever de la fiction. Le quotidien de l’immigré clandestin est si dramatique qu’on ne voit plus dans le roman la frontière entre le réel et le fictif. De même, le vécu des personnages est tellement commun à tous les immigrés clandestins que l’on oublie parfois l’accent fort autobiographique de ces deux récits.
Bibliographie
- Chaabane, Mustapha : amwâj ar-rûh. Berkane, Maroc, Éditions Tarifa, 1998.
- Gharrafi, Miloud : « Une littérature arabe ’immigrée’». In : Horizons maghrébins 52(2005), 156-161.
- Ibn Mandhûr (Jamâl Al-Dîn Abû Al-Fadhl), Lisân al-‘arab, Dar Ehia AL-Tourath Al-Arabi.
Beyrouth, Liban, 1999.
Kundera, Milan : L’ignorance, Paris, Gallimard, 2005.
- Nini, Rachid : yawmiyyât muhâjir sirrî. Rabat, Éditions du Ministère de la culture, 1999.
Remarques:
1 Les deux romans ont été publiés à la même période (amwâj ar-ruh, Berkane, Maroc, Éditions Tarifa, 1998, et yawmiyyât muhâjir sirrî, Rabat, Éditions du Ministère de la culture, 1999). Nini est un poète qui se convertit après son retour au Maroc dans le journalisme. Il est actuellement directeur du quotidien arabophone le plus lu au Maroc (al-masâ’). Chaabane, lui, après le succès qu’a rencontré sa première oeuvre, s’est lancé dans l’écriture du roman et des nouvelles et continue de vivre à Paris
Largement médiatisés par la critique arabe au Maroc, ces deux romans, sont souvent considérés comme les premiers récits dans le thème de l’immigration clandestine, alors qu’en 1995 déjà Ahmed Ababri a publié (Fès, imprimerie Hazzaz) un roman intitulé min al-bahr ilâ al-bahr (De la mer à la mer). D’autres récits de ce genre ont vu le jour plus tard ; nous citons à titre d’exemple : ar-raqs ’lâ al-mâ‘ (Danse sur l’eau) de Hocine Tahri et zafrât al-ghurba (Soupirs d’exil) de Saber Boughnam.
2 D’autres thématiques de ces deux romans ont été étudiées ailleurs. Voir notre article « Une littérature arabe ’immigrée’», in :Horizons maghrébins 52(2005), 156-161.
3 En arabe, fête religieuse musulmane.
4 Milan Kundera, L’ignorance, Paris, Gallimard, 2005, 10.
5 Le terme « bassine » est employé par le narrateur pour désigner la barque de fortune qui transporte les clandestins vers l’Europe.
6 Est-ce pour cette raison que les deux auteurs ne mentionnent pas le genre « roman » dans leur texte et préfèrent de mettre en titre pour Nini et en sous-titre pour Chaabane la mention « chroniques d’un immigré clandestin » ?
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Miloud Gharrafi: Le portrait de l’immigré clandestin dans le roman arabe -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_gharrafi.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25