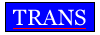 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
La métaphore du jeu dans l’œuvre de Shan Sa:
Indice d’une hybridation identitaire et culturelle?
Julia Pröll (Université d’Innsbruck) [BIO]
Email: Julia.Proell@uibk.ac.at
Der Weltlauf ist ein spielendes Kind,
das hin und her die Brettsteine setzt,
ist ein Königreich des Kindes.(1)
Introduction
L’omniprésence du jeu comme thème, métaphore et principe de la narration montre la puissance créatrice de l’œuvre de Shan Sa. D’un geste ludique son écriture déconstruit les oppositions binaires et lance un défi à toute conception essentialiste d’"identité" et de "culture". Cette libération donne accès à un (tiers) espace entre les cultures où l’imagination peut s'épanouir sans être entravée par la logique. La "profession de foi" de l’espion David Parkhill du roman Les conspirateurs montre la perméabilité des frontières identitaires et culturelles. Par son métier, qui consiste à s’infiltrer dans des mondes étrangers, il est un personnage modèle de l’entre-deux et joue avec la réalité qui l’entoure: "Ce monde est un patchwork d’images que l’on peut coudre, découdre, recoudre."(2) Une telle action entièrement libre, gratuite, amusante et à l’issue incertaine renvoie, en partie, à la définition du jeu donnée par le néerlandais Johan Huizinga:
Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel [...] eine freie Handlung nennen, die als "nicht so gemeint" und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird [...].(3)
Pour Roger Caillois, cette gratuité de l’action est également une caractéristique importante du jeu. Dans son œuvre Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige il reprend la définition de son prédécesseur mais y ajoute certains aspects et établit une typologie des jeux. Selon l’élément dominant de l’action ludique il distingue:
- l’ambition de triompher grâce au seul mérite dans une compétition réglée (agôn),
- la démission de la volonté au profit d’une attente anxieuse et passive d'un arrêt du sort (alea),
- le goût de revêtir une personnalité étrangère (mimicry) et finalement
- la poursuite du vertige (ilinx).(4)
Les jeux de cette dernière catégorie reposent sur "la tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse". Le joueur se livre à l’extase, à la griserie et à l’ivresse; il "se place [de son propre gré] sous le signe du 'trouble', du 'goût normalement réprimé du désordre et de la destruction', du 'tourbillon d'eau'"(5). L’enjeu est d’ouvrir des perspectives inédites, de fragmenter la réalité et de rendre le (trop) connu étrange et méconnaissable. Le plaisir qui découle d’un tel "dérèglement des sens", d’un tel "trouble" peut être associé aux jeux de miroir dans les textes de Shan Sa – jeux qui semblent étroitement liés à son expérience migratoire. Perçu sous cet angle, son exil en France n’apparaît plus comme déracinement traumatisant, mais, au contraire, comme "déclencheur" de sa créativité en français. Cette réévaluation positive de la perte et du déracinement comme "perturbation productive" (Moser et Mertz-Baumgartner)(6) ou "école de vertige" (Cioran)(7), s'inscrit dans des recherches récentes qui mettent l'accent sur le côté positif de la migration. Ainsi, Febel, Stuve et Ueckmann affirment-elles dans Écritures transculturelles: "Wir schlagen vor, den Prozess des Schreibens und das Motiv der Verstörung – als positiv affirmierter Zustand des erlebenden und schreibenden Subjekts wie auch als intendierte Rezeption – zu betonen, und sprechen daher von Écritures transculturelles und Écritures de troubles."(8)
Notre article se propose d'examiner ce côté positif et stimulant de l’exil à l’aide de la métaphore du jeu. Elle permet à Shan Sa la déconstruction de sa propre identité (1ère partie), de l'identité de ses protagonistes (2e partie) et finalement de l’identité de cultures entières (3e partie).
Tous les étrangers éveillent le soupçon.
Pourquoi abandonner la certitude d’une vie
et oser
l’incertitude d’une autre?
Que cherchent-ils à s’approprier en France? (LC, 27)
Shan Sa : une joueuse de go littéraire?
Yan Ni est née le 26 octobre 1972 à Pékin et, plus tard, probablement lors de sa venue en France, elle adopte son pseudonyme, Shan Sa, qui signifie "bruissement de vent". Ses premières œuvres publiées en Chine et en chinois sont encore signées de son véritable nom. À l'âge de 12 ans, en 1983, elle publie son premier recueil de poésie intitulé Les poèmes de Yan Ni, suivi de Libellule rouge (1988), de Neige (1989) et d’un recueil d’essais et de nouvelles Que le printemps revienne (1990). À l’âge de douze ans elle obtient le premier prix du concours national de poésie des enfants. Le choix du genre lyrique montre son goût pour un emploi ludique et gratuit de sa langue maternelle.
Ce sont les évènements de Tian An Men qui marquent une césure décisive dans sa vie et qui la détournent de son pays d’origine, de l’idéologie communiste et de sa langue maternelle : "Après avoir vu Tian An Men, j’ai décidé de rompre avec cette vie et d’en recommencer une nouvelle. Pour vivre dans une autre civilisation avec une langue, le français, qui n’était pas la mienne."(9)
Ce déracinement peut être considéré comme blessure initiale qui nourrit son écriture en français et surtout les trois œuvres de notre corpus. L’abandon de son véritable nom au profit du pseudonyme pourrait être lu comme le symbole pour une réécriture de soi-même – réécriture salutaire qu’elle décrit comme suit dans une interview: "Après Tian An Men, j’ai choisi de renaître en France."(10) Arrivée à Paris elle entre d’abord à l’École alsacienne de Paris. En 1992 elle obtient un baccalauréat français dans la section lettres-philosophie. De 1992 à 1994 elle poursuit des études de philosophie à l’Institut catholique de Paris.(11) Ces quelques détails de sa biographie et de sa formation montrent qu’elle s’imprègne fortement de la culture et de l’imaginaire occidental – un apprentissage qu’elle conçoit comme un jeu, comme une compétition où il s’agit d’un affrontement permanent à l’altérité : "Il fallait se battre constamment pour rencontrer l’Occident ; cette lutte de tous les instants implique d’innombrables difficultés de compréhension de l’autre, à travers nos différences mutuelles."(12)
De 1994 à 1996, elle est secrétaire du peintre Balthus dont la femme Setsuko, japonaise, l’initie à la civilisation japonaise. Les traces de cette influence se trahissent dans le titre de son roman La joueuse de go où elle désigne ce jeu traditionnel par son appellation japonaise au lieu du nom chinois (weiqi). La présence simultanée de plusieurs cultures est une des caractéristiques de son écriture qui fait appel à deux ou plusieurs réalités sans en privilégier aucune. L’auteure se déplace entre ces mondes différents avec l’élégance et la maîtrise(13) d’un funambule – exercice sur la corde raide qui fait naître chez elle et chez ses lecteurs un sentiment de vertige, de l’ilinx. La désorientation voluptueuse émane de la multiplication des perspectives, propre à son écriture qu’elle compare à un pont:
Écrire en français c’était pour moi la meilleure façon de faire le pont entre la Chine et la France. Parce que dans ces moments-là, les codes tombent. J’essaie de ne pas faire de roman exotique, de guide de la Chine. Ecrire directement en français a cet avantage : on écrit un vrai roman. Les lecteurs voyagent dans un univers qui leur est totalement inconnu mais avec la facilité de la langue. Et j’espère que cette langue française est écrite de telle manière qu’à travers elle, on aperçoit ce qu’est la langue chinoise. C’est peut-être là ce qui fait le style de tous mes livres.(14)
Le "thème clef" de cette écriture est le massacre de Tian An Men que ses textes dédramatisent, transforment ou travestissent. Chacune des œuvres de notre corpus a sa façon particulière de jouer avec ce pan d’Histoire. Porte de la paix céleste est à nos yeux une "œuvre-matrice", "séminale", qui présente pour la première fois la dualité des personnages reprise dans les deux autres romans. L'œuvre nous raconte l’histoire de l’adolescente Ayamei, jeune dirigeante de la révolte estudiantine, qui s’enfuit vers la montagne, poursuivie par Zhao, soldat fidèle au régime. Shan Sa y essaie de transcender l’événement de Tian An Men vers le poétique. Lorsque Ayamei et Zhao, ces êtres si différents, se rencontrent loin de la Place de Tian An Men dans une nature douce et joyeuse, leur affrontement baigne dans l’irréel et le mythique. Sous les yeux de Zhao, l'ennemie, habillée d’une robe rouge, longue et flottante, se transforme en une fée et ressemble de plus en plus au protagoniste féminin d’une légende que lui ont racontée les habitants du village :
Il régla ses jumelles et découvrit une étendue infinie et rousse. D’énormes pierres se détachaient de la montagne et roulaient dans le vide. Soudain, une forme apparut. Il vit une femme, dans une longue robe de feu. Il distingua nettement les mains et les pieds nus, marqués de sang. Il vit l’interminable chevelure et la traîne de soie rouge en lambeaux. Elle se retourna. […] Elle le dévisagea. Et, les yeux dans les yeux, il oublia soudain toute sa vie passée. Le regard était noir, intense. Les lèvres rouges.(15)
Sous l’impact de cette rencontre, qui balaye d’un seul coup toute sa discipline militaire et toute conviction idéologique, Zhao, comme dans un état de transe, oublie sa mission et épargne sa cible – un dénouement contraire aux attentes des lecteurs et aux données historiques. L’atroce réalité se trouve donc transfigurée ; elle est niée au profit de l’univers poétique, vaste espace de jeu avec ses propres lois. Créer un univers à part, réussir le passage du réel vers le poétique, tel est l’enjeu de ce roman formulé par Shan Sa dans une entrevue:
J’ai voulu commencer par un passage dur, sec, journalistique. Il m’a permis de développer ensuite mon style de la dureté à la poésie. En allant au cœur du réalisme, on réussit à atteindre la poésie. L’horreur de Tian An Men au début de l’ouvrage contraste avec la beauté de la nature où se réfugie ensuite Ayamei. La révolution et la paix éternelle.(16)
La joueuse de go(17) reprend la constellation dualiste des personnages : dans la Mandchourie des années trente, occupée par l’armée japonaise, un soldat japonais déguisé en Chinois joue au go avec une jeune Chinoise pour sonder ses intentions. Comme Zhao dans Porte de la paix céleste il est attiré par l’adolescente mystérieuse qu’il poursuit avec obsession. Contrairement aux apparences, ce texte ne reprend pas seulement le principe de la dualité des protagonistes, mais aussi l’évènement de Tian An Men qu’il cache derrière le masque d’un roman historique. Sous deux aspects le texte est révélateur d’un jeu : premièrement, les courts chapitres qui font alterner les perspectives de la jeune fille et du soldat ressemblent aux pions des deux adversaires placés à tour de rôle sur le damier ; deuxièmement, le déguisement que choisit le texte pour parler encore une fois des évènements de Tian An Men évoque la mimicry selon la typologie des jeux de Caillois. Shan Sa nous renseigne dans une entrevue sur le brouillage de pistes opéré dans ce livre :
Après mon deuxième roman [Les quatre vies du saule (1999) – J.P.], j’ai voulu revenir sur l’évènement Tian An Men pour raconter de manière extrêmement crue ce que j’ai vécu. J’ai aussi voulu écrire notre histoire d’amour qui n’était pas très présente dans Porte de la Paix céleste. En travaillant, je me suis aperçue que je ne pouvais pas ressusciter le passé. C’est pourquoi j’ai transposé la tragédie dans une autre époque. La Joueuse de go n’est pas un roman historique. Derrière 1937, il y a Tian An Men.(18)
L’histoire d’amour qu’elle a négligée dans Porte de la paix céleste concerne un fragment autobiographique. Il s’agit de son histoire d’amour avec Min qu’elle a vécue en Chine. Dans les romans de notre corpus Min apparaît toujours comme l’amant de l’héroïne qu'il trahit: dans Porte de la paix céleste il accomplit le suicide que son amante n’ose pas accomplir ; dans La joueuse de go il épouse Tang, une jeune combattante dans la résistance, avant son exécution par l’armée japonaise. En évoquant Min, Shan Sa joue avec sa propre biographie, peut-être dans le dessein de se libérer d’une faute. Car en réalité, c’était elle qui avait abandonné ce garçon, pour commencer une nouvelle vie en France. Ce renversement de la vérité est pour elle une caractéristique essentielle de l'écriture: "Écrire c’est mettre le monde à l’envers."(19) Un tel jeu vertigineux perturbe la perception du lecteur, qui ne sait plus distinguer entre vérité autobiographique et mensonge.
Un jeu de cache-cache et de poursuite plus universel et global est décrit dans Les conspirateurs, comme le montrent les nombreux renvois à la métaphore du jeu et au vocabulaire théâtral.(20) Dans ce roman Shan Sa reprend explicitement l’histoire d’Ayamei de Porte de la paix céleste et nous parle de ce qu’elle est devenue. Contrairement aux deux autres romans l’action se déroule en France et en Asie – indice pour "l’entre-deux" culturel de ce texte. Dans un immeuble près du jardin du Luxembourg à Paris se rencontrent les voisins Jonathan Julien, espion américain, et sa cible, Ayamei. Mais celle que nous prenons pour la jeune révoltée – même son journal que Zhao lit avec passion dans Porte de la paix céleste est repris dans le texte pour renforcer une (fausse) impression d’authenticité – est en vérité l’espionne chinoise Ankai. En adoptant l’identité de la combattante pour les Droits de l’homme elle s’est infiltrée dans le gouvernement français pour mieux manipuler Philippe Matelot, conseiller économique du Premier ministre, avec qui elle effectue un trafic d’armes. Devant ces identités mouvementées le lecteur est vite pris de vertige, car dans ce quiproquo global il ne lui est plus possible de distinguer qui joue quel rôle et qui poursuit qui. L’Histoire traumatisante de Tian An Men s’y est transformée définitivement en une multitude d’histoires inventées.(21) Le trauma initial ne pèse plus, il est devenu presque aérien et se dissout dans le ludique. Cette légèreté est exprimée dès le début par Ayamei qui dit à Jonathan : "La vie est un songe et un mensonge." (LC, 26)
Le jeu : lieu de déconstruction d’identités individuelles
Les protagonistes des romans en question sont tous des " étrangers à eux-mêmes" au sens de Julia Kristeva.(22) Leur biographie, leur caractère ou leur métier les prédisposent à reconnaître la part d’irréductible altérité à l’intérieur d’eux-mêmes
Dans Porte de la paix céleste la mère d’Ayamei décrit sa fille comme "un oiseau indomptable qui mourrait si on l’enfermait". (PPC, 55) Ce goût pour la liberté et le mépris des idéologies apparaît le jour du décès de Mao Tse Tung. En classe, elle est la seule à rire parmi les professeurs et les enfants choqués. Seule la peur de la rééducation et de la prison lui fait finalement couler des larmes feintes (cf. PPC, 61-62). Mais aussi sa lutte dans la résistance ne semble pas la satisfaire. Après la mort de son ami Xiao lors du massacre de Tian an Men elle décide, poussée "par un sentiment confus et étrange" (PPC, 16) de ne pas retourner place de la Paix céleste. Au lieu de mourir en héroïne elle s’enfuit dans la nature. Son désir de liberté triomphe sur la mort comme martyre pour la liberté ; le vœu formulé par sa mère s’accomplit : "une fois sortie de la ville, une fois rendue à la nature, elle déploiera ses ailes et prendra son essor. Hélas, jamais elle ne reviendra." (PPC, 55)
Zhao, de son côté, n’est pas le soldat exemplaire pour qui le lecteur pourrait le prendre. Un coup d’œil sur sa formation militaire nous montre plutôt que c’est avec un grand effort qu’il joue à incarner le soldat modèle. Décrit comme "enfant taciturne" (PPC, 23) et "être malingre" (PPC, 23), pour qui "l’uniforme […] était trop grand" (PPC, 24), la première année à la garnison est dure pour lui. Le lieu où il se sent le plus à l’aise n’est pas l’univers militaire avec ses règles strictes, mais – comme pour Ayamei – le rêve et la nature: "Zhao rêvait de son village, de campagne verte, des baignades dans l’étang limpide lorsqu’il rentrait à la maison sur le dos de son buffle. Il se réveillait souvent en sanglotant […]." (PPC, 24)
Les deux participants au jeu dans La joueuse de go possèdent, eux aussi, une identité hétérogène. Cette hétérogénéité est, cette fois-ci, due à leur biographie. La joueuse est née en Europe, à Londres – signe pour son étrangeté irréductible et son humeur vagabonde: "Je suis née dans la brume londonienne. Le mal de cette naissance déplacée se manifesta aussitôt dans les caprices de mon âme dérangée." (JG, 42) À l’école elle est surnommée "l’étrangère" (JG, 41) – différence fondamentale liée à sa passion pour le go considéré par ses camarades de classe comme "folie exotique" (JG, 41). Son adversaire, le soldat japonais, est éduqué "avec une implacable sévérité" ce qui le prépare à son futur métier de soldat qu’il adopte avec moins de difficultés que Zhao. Mais au milieu de la sévérité et de la discipline vécues pendant sa jeunesse il s’enfuit sur des îlots de tendresse. C’est sa nourrice pékinoise qui le choie et l’incite à la littérature, à la rêverie et à la langue chinoise :
Les joues en feu, les larmes aux yeux, le cœur meurtri, je me précipitais dans les bras de ma Chinoise qui pleurait mes malheurs. Pour effacer la douleur, elle m’étreignait et me contait les légendes de son pays. Le chinois fut ma langue de rêve et de consolation. Plus tard, elle m’apprit à réciter les poèmes de la dynastie Tang et à écrire […]. Quand je lisais ces textes à voix haute, ma prononciation à la pékinoise provoquait chez elle des sanglots de joie. (JG, 151)
Cette connaissance de la culture et de la langue chinoise fait de lui l’espion idéal pour s’infiltrer Place de Mille Vents et y jouer au go. Le capitaine Nakamura circonscrit sa mission qui consiste en un double jeu, comme suit : "Vous qui parlez le chinois avec un superbe accent pékinois, vous devriez vous déguiser en civil et y jouer une partie." (JG, 152)
Dans Les conspirateurs toute identité stable et homogène se dévoile comme mensonge. Les deux espions sont des êtres creux qui changent leurs identités comme des habits. La fente qui les traverse est descriptible en termes médicaux. Ainsi, Philippe Matelot parle de la "schizophrénie" d’Ayamei (cf. LC, 144). La condition nécessaire pour ce jeu identitaire est une absence d’attaches symbolisée par le statut d’orphelin réclamé par chacun des protagonistes. Sans famille, sans tradition et sans héritage ils ne ressemblent à personne et sont prêts à jouer tous les rôles que les puissants de ce monde, que ce soit à l’est ou à l’ouest, leur commandent. Ils sont – comme l’affirme l’espion américain en ce qui le concerne – leurs "propre[s] créateur[s]". (LC, 34) Quant au pouvoir libérateur d’une telle non-appartenance l’espion remarque: "Ne pas connaître les visages, les corps, les vies qui m’ont engendré me préserve de tourments inutiles […] Moi, je suis libre de mon corps et de mon sang […] Je ne me regarde pas à travers mes parents. C’est plutôt une chance." (CP, 34)
Contrairement à l’Américain, qui s’est inventé un destin d’orphelin, Ayamei a vraiment grandi dans un orphelinat (cf. CP, 205). Dès sa première jeunesse elle joue des rôles : elle incarne avec perfection l’élève modèle pour ses professeurs ; derrière la façade elle est un "animal alpha" qui impose sa loi où elle peut (cf. CP, 206). Lorsqu’elle est recrutée comme espionne par l’armée soviétique, cette habituée des tourments divers ne considère pas comme perte l’abandon de la vie menée alors : "Une fois habillée, je me suis présentée à un bureau où l’on m’a dit que mon ancienne fiche d’état civil avait été effacée et qu’une nouvelle venait d’être créée. J’ai perdu le nom donné par l’orphelinat et pris celui inventé par l’armée." (CP, 207)
À Paris, son absence d’attaches est symbolisée par un appartement scrupuleusement nettoyé. Mais ce que l’espion américain ignore, c’est qu’il s’agit d’une purification jouée exclusivement pour lui. Cette mise en scène sert à le convaincre qu'il se trouve devant la vraie Ayamei, la réfugiée politique qui a voulu renaître en France:
Le nettoyage est symbole de purification. Déjà dépouillée de famille, de biens, de racines, que veut-elle encore décaper? Ou ces rangements maniaques expriment-ils une volonté de construire un avenir sur un présent dompté, maîtrisé, mis en ordre? Sans profession, sans histoire d’amour, elle demeure la Chinoise de Tianan men. Ici, sa vie est transitoire, la longue attente d’un éventuel retour. (LC, 46)
Les deux espions – le fait que leur métier rappelle le mot "pion" ne semble pas aléatoire – vivent entièrement dans le jeu. Ainsi, pour David Parkhill, alias Jonathan Julian, le rôle finit par se confondre avec la réalité. L'habitude aidant, il est devenu un passeur habile entre "être" et "paraître".
Ses collègues, fiers d’être des enfants de Descartes, Rousseau, Voltaire, Sartre, font entendre leur opinion. En une heure, ils refont le monde : les otages, le clonage, le mariage homosexuel, la Sécurité sociale, l’élection présidentielle, la Constitution européenne, le plombier polonais, le péril chinois et les vacances. Le rôle finit par se confondre avec la réalité. L’incarnation a pris racine dans son ventre. Tel le myope qui oublie ses lunettes posées sur son nez, Jonathan ne s’observe plus distribuant ses sourires béats, ses paroles mal articulées, ses gentillesses benoîtes. L’automatisme est en route. Il entend sans écouter, égrène les répliques en pensant à une autre histoire. Il s’exile tout en restant là. Il s’absente pendant qu’il joue. (CP, 42)
Les passe-temps favoris de David témoignent de son mépris pour la stabilité et la permanence. Toutes les activités évoquées excitent la "panique voluptueuse" propre à l’ilinx : le surf sur des vagues immenses et l’alpinisme extrême dans l’Himalaya. Étonnée par ces activités sportives Ayamei lui lance: "Le surf, l’alpinisme, vous recherchez l’équilibre dans le déséquilibre, l’accomplissement dans le défi perpétuel." (LC, 31)
Les ressemblances profondes entre tous ces supposés antagonistes mènent à ce que leurs rencontres ne sont pas de simples affrontements entre un (homme) dominant et une (femme) dominée mais font ressortir les points communs. Dans chaque texte, le contact avec l’autre transforme le propre être, ce qui fait de l’altérité, au lieu d’une menace, une source d’enrichissement pour le développement de la personnalité: "In der Differenz zum Anderen konfrontiert sich der Mensch mit seinen offenen Grenzen, dem Diversen, das erst ein eigenes Erleben intensivieren kann."(23)
Dans Porte de la paix céleste Zhao est tellement obsédé par sa cible qu’à la fin il l’épargne. Au début du livre, lorsqu’il arrive à la capitale pour combattre l'insurrection estudiantine, son regard appauvri est encore insensible aux beautés de Pékin. L’aveuglement idéologique lui fait voir partout "une opulence fondée sur l’exploitation du peuple". (PPC, 21f.) Sous l’impact du journal d'Ayamei la réalité change d’aspect et le soldat redevient le rêveur sensible d’autrefois "Les iris du jardin avaient éclos ; leur grâce et leur splendeur évoquaient la beauté de cette princesse héroïque [Ayamei]. Zhao, après les avoir longuement admirés, se demanda pourquoi, auparavant, il était si peu sensible aux fleurs." (PPC, 57)
La répartition des rôles est également instable dans La joueuse de go. La condition nécessaire pour l’interchangeabilité entre la cible (la jeune Chinoise) et le persécuteur (le soldat japonais) est une sorte de dérangement "originaire" et primaire qui arrive à la narratrice par son premier contact sexuel avec Min. Après avoir été dépucelée par lui elle se sent blessée, mais d’une façon positive: "Quelque chose enfouie depuis toujours dans les méandres de mon être est exhumée, tel un drap sorti du coffre pour être exposé au soleil. Ma virginité n’est plus qu’une plaie. Fendu en deux, mon corps est ouvert et la brise me traverse." (JG, 134) Au lieu d’éprouver cette fente comme une tare elle la porte avec beaucoup d’orgueil:
Le lendemain, au lycée, je promène un regard fier sur mes camarades. La douleur d’hier demeure dans mon corps. Elle me brûle, me démange. Elle est ma dignité. Enveloppée dans ma robe bleue pareille à celle des autres, je sais pourtant que, désormais, je suis différente. (JG, 138)
C'est de cette différence qu’elle tire la force pour affronter les trois hommes Min, Jing et le soldat japonais et pour insister sur son indépendance. Son goût pour la liberté se dévoile à travers son comportement devant Min et Jing: elle refuse de se marier avec Min (cf. JG, 133), ne veut pas choisir entre Min ou Jing (cf. JG, 170) et finalement – loin de Pékin – abandonne Jing avec qui elle a quitté la capitale. Le jeu de go qui lance un défi à tous les chez-soi, est la métaphore pour ce besoin de liberté:
Je préfère le go aux échecs pour sa liberté. Dans une partie d’échecs, les deux royaumes, avec leurs guerriers cuirassés, s’affrontent face à face. Les cavaliers de go, virevoltants et agiles, se piègent en spirale: l’audace et l’imagination sont ici les vertus qui conduisent à la victoire. (JG 157)
Min et Jing représentent des identités stables, homogènes. Pour créer une différence stimulante, l'adolescente a besoin des deux garçons à la fois: "Sans Jing, mes étreintes avec son rival deviendraient vulgaires. Sans Min, Jing n’existe plus. Par contraste avec la légèreté de mon amant, son caractère aride paraît grave et mystérieux. En choisissant l’un, je renonce à l’autre et je les perds tous deux." (JG, 175) Le go reflète cette constellation. Sur le damier aucune entité fixe n'est admise, mais seulement des différences en mouvement :
La position d'un pion évolue au fur et à mesure qu’on déplace les autres. Leur relation, de plus en plus complexe, se transforme et ne correspond jamais tout à fait à ce qui fut médité. Le go se moque du calcul, fait affront à l’imagination. Imprévisible comme l’alchimie des nuages, chaque nouvelle formation est une trahison. Jamais de repos, toujours sur le qui-vive, toujours plus vite, vers ce qu’on a de plus habile, de plus libre, mais aussi de plus froid, précis, assassin. Le go est le jeu du mensonge. (JG, 310)
Contrairement aux deux amis chinois de la jeune fille, qui ne s’intéressent pas au go, le soldat japonais est un initié à ce jeu. Le goût qu’il y prend est l’indice pour sa personnalité complexe – complexité que la discipline militaire n’a pas su effacer. À chaque fois qu’il se rend, déguisé en Chinois, Place de Mille Vent, il s’aperçoit profondément double; il joue avec ces identités différentes qui font de lui un miroir à double face:
En uniforme ou en civil, je suis deux hommes différents. Le premier domine la ville avec l’orgueil du vainqueur, le second se laisse vaincre par sa beauté. Le Chinois, c’est moi. J’observe avec stupéfaction qu’il prend l'accent, modifie son allure, s’invente une image. En me déguisant, je perds mes repères et me distancie de moi-même. J’en suis presque devenu un homme libre qui ignore l’engagement militaire. (JG, 207)
Au jeu de go s’ajoute alors un jeu identitaire, auquel le soldat ne peut et ne veut pas résister. Son jeu de rôle ne lui est pas pénible mais plutôt un plaisir qui lui fait découvrir sa liberté. Cette liberté nouvelle lui permet de se regarder "de l’extérieur", de reconnaître la "relativité" de son métier de soldat. Ce qu’il a cru pendant longtemps l’essence de son être devient un rôle qu’il joue (parmi d’autres). Pendant qu’il joue un Chinois jouant au go, sa dureté militaire s’évapore – une transformation qui ne passe pas inaperçue de sa partenaire:
L’Inconnu joue avec une infinie lenteur. Le cheminement de sa pensée me surprend. Chacun de ses coups traduit un souci d’harmonie avec le tout. La progression de ses pions est aérienne, subtile, telle la danse des grues. J’ignorais qu’à Pékin, il existât une école où l’élégance prime sur la violence. Perplexe à mon tour, je me laisse emporter par son rythme. (JG, 158)
La joueuse est attirée par l'inconnu car il possède cette étrangeté que Min et Jing n’ont pas. Avec la montée de sa passion pour son adversaire, le jeu change de caractère et se développe du ludus à la paidia. Selon Caillois il existe, dans chacune de ses catégories des jeux, deux manières de jouer.(24) La paidia est définie comme "principe de turbulence", étroitement lié à l’improvisation, au plaisir et à la joie; le ludus apparaît comme "appareil disciplinaire" pour apprivoiser cette exubérance primaire. Il s’agit de toutes les "conventions arbitraires, impératives" à l’œuvre pour garantir un déroulement ordonné du jeu. (25) Le go, qui requiert surtout la réflexion pondérée, fait dominer, comme les échecs, le ludus, principe que Papineau associe à l’ordre apollinien.(26) Mais plus le jeu entre le Japonais et la Chinoise dure, plus l’ordre est déstabilisé: une énergie violente est déchaînée qui relève de la paidia, du principe dionysiaque pour employer la notion nietzschéenne. Cette force élémentaire et ambiguë détruit volontiers ce qu’elle désire:
Dieses elementare Bedürfnis nach Bewegung und Lärm tritt zunächst als Trieb, alles zu berühren, zu ergreifen, zu schmecken, zu beriechen, in Erscheinung, um dann jeden erreichbaren Gegenstand wieder fallen zu lassen. Es wird leicht zum Trieb am Zerstören oder am Zerbrechen.(27)
La jeune fille s’abandonne de plus en plus au jeu, ce qui contredit sa volonté de domination. Les deux adversaires se transforment de plus en plus en partenaires égaux; leur jeu n’est plus un miroir de la guerre, mais une imitation du jeu sexuel où la différence entre victime et persécuteur tend à s’effacer: "Sur le damier, océan tourmenté, vagues noires, vagues blanches se poursuivent, se bousculent. Près des quatre rives, elles reculent, tourbillonnent, s’élancent vers le ciel. Entremêlées, elles s’écrasent pour s’étreindre encore plus profondément." (JG, 308) La métaphore aquatique évoque l’absence de toute barrière, l’amollissement de toute frontière et l’abandon d’un moi stable et circonscrit. Le jeu de go, qui, à son début, a opposé deux êtres différents, culmine en son contraire: la fusion. Au lieu de le battre la jeune fille veut s’identifier à son adversaire comme le montre le vœu suivant: "Ce n’était pas pour vous vaincre, je voulais vous découvrir. J’ai visité votre âme, j’ai palpé les recoins que vous ignorez, je suis devenue vous et j’ai compris que vous n’étiez pas tout à fait vous-même." (JG, 315) Le damier devient l’endroit où s'’épanouit le "sentiment océanique" tant méprisé par Freud:
[…] nach außen wenigstens scheint das Ich klare und scharfe Grenzlinien zu behaupten. Nur in einem Zustand, einem außergewöhnlichen zwar, den man aber nicht als krankhaft verurteilen kann, wird es anders. Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen. Allen Zeugnissen der Sinne entgegen behauptet der Verliebte, dass Ich und Du Eines seien, und ist bereit, sich, als ob es so wäre, zu benehmen.(28)
La fascination irrésistible de la joueuse pour l’inconnu émane de ce qu’il réunit en lui des qualités opposées sans les neutraliser. Contrairement à Min et Jing il ressemble pour elle à un homme "sans domicile fixe" qui méprise les dogmes. Au lieu d’aller tout droit vers un but il semble, à ses yeux, avoir choisi l’errance. "À travers vos yeux j’ai connu le pays de votre origine: sur une terre recouverte de neige éternelle les arbres brûlent et les flammes s’épanouissent dans le vent. L’ardeur de la neige et du feu fait de vous un magicien errant." (JG, 314) Dans le miroir des yeux du Japonais la Chinoise rencontre sa propre image, celle d’une jeune femme qui méprise les appartenances. Néanmoins, elle cherche un endroit "hors jeu" où son amour pour l’étranger pourrait se réaliser. Mais le soldat est trop lâche pour oser l’amour. Soudain, il déplore son manque d’authenticité et le ressent comme lourd fardeau. L’aveu de son impuissance à quitter le jeu (militaire) scelle le triomphe de la discipline: "Je ne suis pas capable d’être moi-même. Je ne suis qu’une succession de masques." (JG, 316
Lors de leur ultime rencontre en pleine guerre – la narratrice, qui s’est enfuie de la capitale, tombe entre les mains de l’armée japonaise – le soldat choisit la mort, seule issue pour échapper au devoir de violer sa victime. Après que la Chinoise lui a révélé son nom, Chant de nuit, le soldat la tue et se suicide ensuite. Leur fusion tant souhaitée s’accomplit dans la mort, ce principe égalitaire qui, finalement, surmonte toutes les différences. Mais le suicide du soldat ne consacre pas son échec; au contraire, cet acte final acquiert la qualité d’un geste subversif par lequel le Japonais se donne une identité bâtarde et hybride l’unissant finalement à l’aimée: "Pour vous, je renonce à cette guerre, je trahis ma patrie. Pour vous, je suis un fils indigne, un descendant qui aura terni sa lignée." (JG, 342)
Dans Les conspirateurs le jeu de cache-cache se poursuit et s’étend. Chacun des deux espions n’est qu’"une succession de masques" ce qui rend obsolète toute notion traditionnelle de vérité ou d’identité individuelle. Ces deux entités se dévoilent comme fictions pures et simples au sens de Nietzsche: "Was also ist Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, [...] Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind."(29) Un tel univers voué entièrement au mouvement, qui ne connaît ni point fixe ni centre, ressemble à un damier du go; les espions deviennent, à leur tour, des pions sur l’échiquier planétaire poussés par les puissants de ce monde, tel Philippe Matelot : " il était devenu un pion que Pékin poussait sur un vaste échiquier par la main d’Ayamei." (LC, 108) Le caractère d’Ayamei obéit également au mouvement. Sa personnalité change en fonction des relations qu’elle entretient, comme le montre sa conversation avec Philippe Matelot:
- […] J’ai dit à Jonathan Julian que je ne buvais pas. Allergie à l’alcool.
- Pourquoi?
- Parce qu’avec lui je suis Ayamei, la pure, la naïve, la rebelle traumatisée.
- Et avec moi?
Elle lève la tête.
- Réjouis-toi, je ne joue pas. Je suis moi-même, hélas. (LC, 101-102)
L’esprit froid, calculateur des deux espions se dégèle par leur contact. Au début, l’espion américain ressemble encore au joueur d’échecs stratégique, pour qui, selon Matelot, l’amour devrait rester à jamais un horizon inaccessible : "S’[…]il est envoyé par la CIA, c’est un joueur d’échecs qui lit le monde à travers les mathématiques. Tomber amoureux? Tu te fais des idées." (LC, 113) Le premier contact sexuel entre les deux espions, initié par David, semble conforme à ce portrait. L’espion américain est la part active et séduit la jeune femme qui semble succomber aisément à son charme. Il paraît qu’il réussit à "mettre la machine en route" et à s’attacher Ayamei. Lorsqu’elle lui avoue, après l’acte, avoir feint la jouissance, David est dérangé et le lecteur ne sait plus qui trompe qui. Ce jeu de cache-cache se complique encore par le fait que, peu à peu, de "vrais" sentiments naissent entre l’espion et celle qu’il prend pour la combattante pour les Droits de l’homme. Cet enchevêtrement entre être et paraître est remarqué par Philippe Matelot : "Unis dans le jeu d’illusions, leur vigilance relâchée, ils oublient le monde réel où ils sont ennemis. Les personnages qu’ils incarnent s’aiment et elle tombe amoureuse." (LC, 144) Le Français remarque aussi que la carapace d’Ayamei, par endroits, se fissure :
Elle a changé. Pourquoi faire l’apologie de l’amour? L’Ayamei qu’il a connue était un boa. Jonathan Julian l’a fascinée avec ses histoires de spiritualité. On dirait qu’elle est en train de se révolter contre la Chine, contre la France, contre elle-même qui n’est qu’une créature de la haine. (LC, 143)
Le jeu de poursuite entre les deux espions change de caractère, comme dans La joueuse de go, et passe du ludus à la paidia. David, qui croit en la sincérité de l’amour ressenti par Ayamei, hésite à lui avouer sa véritable mission de faire d’elle "un pion sur l’échiquier du renseignement américain." (LC, 179-180) Pour ne pas la blesser il voudrait lui dire:
Oui, j’ai joué avec toi et j’ai triché. Oui, je suis un schizophrène, un funambule que tu mépriseras le jour où tu connaîtras mon vrai visage. Oui, je me suis servi de ta naïveté, de ton ardeur. Je t’ai prostituée et t’ai fait du mal. Ayamei, merci d’exister. Merci d’avoir rendu ma conscience coupable. Merci d’avoir aimé un homme seul, fou, damné. Pardonne-moi ! (LC, 180).
Lorsqu’il s’aperçoit qu'Ayamei joue le même jeu que lui il est déconcerté parce qu’il se rend compte de son désir pour cette femme – désir qui s’épanouirait loin du tissu de mensonges dans un espace "authentique" :
Pourquoi Bill Kaplan, le funambule marchant au-dessus des illusions terrestres, a-t-il été ensorcelé par la femme qui avance sur le même fil? pourquoi a-t-il cru aux mensonges d’une Chinoise? Il n’a rien compris à la femme. Il ne connaît plus son métier. Serait-il devenu fou? (LC, 190)
À la fin du livre Ayamei éprouve aussi le besoin de se confesser, d’atteindre la sphère de l’authentique. Le colonel Ankai, alias Ayamei, autrefois inflexible et dur comme l’acier, s'est transformée en une femme prête pour le désir et l'amour:
Mon corps, après tant d’années d’insensibilité, s’est soudain dégelé et mis à vibrer. Comment croire que l’espionne est folle de désir pour un espion dont la mission consiste à la rendre folle de désir? Oui, "Ayamei", la rebelle de Tianan men, et moi, le colonel Ankai, nous avons perdu la tête. (LC, 202)
Là où dans La joueuse de go l’amour s’est réalisé dans le "non-lieu" de la mort, ce roman plaide pour son accomplissement dans le hic et nunc. Après être monté chez Ankai, David Parkhill, au lieu de la liquider comme le lui dicterait sa mission, se déshabille sur le pas de la porte. Sa nudité montre qu’il réussit finalement à se débarrasser de son rôle. Il est prêt à se diriger tout droit vers un tiers espace au-delà des appartenances idéologiques et à s’installer dans le lieu précaire et instable de la zone de contact entre Orient (Chine) et Occident (Amérique).
Examinons dans une dernière partie l'hybridation progressive de l’espace dans les trois textes. À l’aide de la métaphore du jeu Shan Sa décrit un contact de cultures qui correspond au paradigme transculturel.
Le jeu: métaphore pour la déconstruction d’identités culturelles
La France n’existera dans le monde
qu’en s'inscrivant dans une histoire d’amour triangulaire
avec la Chine et les Etats-Unis (LC, 109).
Bien que Shan Sa ait des réserves sur le terme de métissage elle est en quête d’espaces-modèles où des cultures différentes pourraient cohabiter, s’échanger et s’enrichir mutuellement:
Je n’aime pas tellement les mots de "métissage" ou "rencontre". Cela sous-tend une opposition, deux êtres en un, alors qu’il s’agit de superposition. Cela se fait de manière verticale, non horizontale. Je crois que c’est la meilleure façon de pénétrer une civilisation. On ne peut pas la rencontrer mais on peut la traverser, l’appréhender sur un niveau plus poétique que le métissage, qui est quelque chose de physique.(30)
Le mouvement vertical évoqué dans cette citation suggère la lecture des œuvres de Shan Sa sous l’aspect d’une "littérature transversale" ("querende Literatur") telle qu’elle a été définie par Febel, Grote et Ueckmann:
Es geht um Literaturen, die sich nicht mehr in die Nationalliteraturen einordnen lassen, genauso wenig aber im traditionellen Modell der Weltliteratur aufgehen, die also quer zum literarischen Kanon stehen. Es sind zudem Literaturen, die oft selbst über Grenzen hinweg wirken und rezipiert werden und gleichzeitig Bewegungen, also Überquerungen und Übersetzungen zum Thema haben. Nicht selten wirken sie als etwas Widerständiges: Sie verweigern sich einer Kategorisierung, sie verstören, befragen vermeintlich homogene Kulturen, Nationalsprachen, Kanonbildungen und schlichte Weltanschauungen und sind insofern oftmals "unbequem".(31)
La condition nécessaire pour les "traverses" et "passages" des protagonistes dans les romans de notre corpus est l’ouverture des espaces au sens d’un écroulement de barrières idéologiques et culturelles. Porte de la paix céleste décrit pour la première fois une telle "perturbation productive" d’espaces homogènes. Au début du livre, la Place de la paix céleste où se "joue" la révolte estudiantine est décrite comme un endroit fermé, encerclé par un dispositif. (cf. PPC, 11) C’est le lieu d’affrontement d’idéologies différentes, les révoltés d’un côté, le gouvernement de l’autre. La place devient ainsi l’emblème pour un encroûtement dogmatique au centre duquel se trouve Ayamei qui "jou[e] [son] rôle de catalysateur" (PPC, 14) à la perfection. Les images télévisées nous la décrivent "debout près de la stèle des héros de la Libération élevée au centre de la place de la Paix céleste." (PPC, 39) Sa position dans l’espace n’est pas encore perturbée et "décentrée", mais, au contraire, elle s’identifie sans réserve à son rôle de combattante contre le régime communiste. Son lieu d’exil chez les parents du chauffeur Wang est le contraire de la Place de la paix céleste et signale l’ouverture des espaces. L’endroit est situé " au bord de la mer" (PPC, 46) – paysage qui rappelle le flou, le vague et l’absence de frontières. On y arrive en traversant "une vaste plaine au milieu de champs de blé" (PPC, 47), autre évocation d’un espace illimité. Ayamei y arrive comme "voyageur sans bagages", car il s’agit d’ "un endroit isolé de tout" (PPC, 46) où elle est une inconnue sans passé. Cette perte positive d’identité rappelle la propre biographie de Shan Sa et sa "renaissance" en France. Dans Porte de la paix céleste un tel contact stimulant avec l’autre culture est seulement esquissé. Zhao et Ayamei se rencontrent à la fin du livre ; ils restent muets, aucun échange verbal n’a lieu
L’intrigue dans La joueuse de go va plus loin et décrit le contact intellectuel et physique entre deux êtres séparés par les mêmes gouffres idéologiques que Zhao et Ayamei. L’action se déroule dans la ville de Mille Vents, sur la place éponyme, dont le nom déjà indique l’absence de "centre" (Pékin) et la dominance du mouvement. Un coup d’œil sur l’histoire de la ville nous montre que des procédés d’hybridation y sont à l’œuvre qui détruisent le mythe d’une culture homogène et unifiée. Quant aux habitants le soldat japonais remarque non sans désarroi: "[…] les natifs d’ici sont de physionomie délicate. On dit qu’ils ont pour ancêtres les bâtards des princes, que dans leurs veines coule un sang subtilement mêlé de Mandchous, de Mongols et de Chinois." (JG, 136) Le jeu de go chinois est, toujours selon le soldat japonais, également un "bâtard". Dans sa variante chinoise vulgarisée, il apparaît, à ses yeux, comme dépourvu d’élégance (cf. JG, 161). Pour la joueuse, le go est, dès le début, perçu d’une façon positive. Pour elle c’est une sorte d’exil réconfortant : "Après la classe, je me rends place des Mille Vents. Le jeu de go me propulse vers un univers de mouvement. Les figures sans cesse renouvelées me font oublier la platitude du quotidien." (JG, 41) Au cours de la partie le soldat japonais succombe aux charmes de son adversaire. Petit à petit il oublie son appartenance à la culture dominante, car, sur le damier, toute différence culturelle semble s’effacer dans un mouvement perpétuel. Ainsi le soldat japonais se rend-il compte, non sans étonnement, que sur la Place des Mille Vents son déguisement de Chinois ne lui sert à rien:
Je redoutais qu’à la longue, ils ne sachent discerner un faux Chinois d’un vrai. Cette inquiétude est balayée. Ici, la parole perd son prestige et cède son autorité au claquement des pions. On m’a inventé une fausse identité. Elle ne m’a jamais servi. La joueuse ne me demande jamais mon nom, insignifiant détail dans une partie de go. (JG ,214)
La qualité du go comme espace "transculturel" est également souligné par l’auteur qui remarque dans une entrevue : "c’est un jeu où le langage est banni, un jeu où enfin deux jeunesses de nationalité différente, de langue différente, d’idéologies différentes, peuvent enfin se rejoindre."(32)
Dans Les conspirateurs la déconstruction des espaces homogènes se renforce encore et donne lieu à l’épanouissement du transculturel. L’importance de l’entre-deux culturel pour ce roman se dévoile dès le début du livre où l’espion américain fait de son origine une devinette à résoudre par sa voisine Ayamei : "Un couple américain a adopté un enfant dans un orphelinat de la banlieue parisienne et l’a emmené en Californie. Que devient-il a votre avis? – Un Français en Amérique et un Américain à Paris répond-elle sans ciller." (LC, 28) Dans cette devinette il joue avec son déracinement, qu’il ne ressent pas comme un fardeau. La prompte réponse d’Ayamei nous montre que cette femme est aussi une habituée des "identités multiples".
Leur "entre-deux" leur fait mépriser le tourisme, cette forme passive et apaisante pour s’approcher de tout ce qui est étranger et inconnu. Ayamei exprime son scepticisme en disant : "Je ne suis pas touriste, je suis une passante." (LC, 57) Ce mépris de l’attitude touristique se reflète aussi dans les moqueries des deux espions sur des situations touristiques exemplaires : Ayamei n’a pas su se servir d’une fourchette et d’un couteau lorsqu’elle a été invitée pour la première fois à dîner en Europe. Jonathan, de son côté, n’a pas su utiliser des baguettes.
Les deux espions illustrent un contact de cultures opposé au tourisme et descriptible en termes du "transculturel". La transculturalité se montre par la position que les deux protagonistes ont dans l’espace. Ayamei et David sont des voisins qui n’habitent pas porte à porte mais à des étages différents. Cette verticalité reflète l’attitude de Shan Sa, selon laquelle différentes cultures ne se mélangent pas mais se juxtaposent et se traversent. Le passage entre la Chine (l’appartement d’Ayamei) et l’Amérique (appartement de David) dans un immeuble à Paris est garanti par l’ascenseur (et son mouvement vertical entre les étages) ainsi que par l’escalier. La juxtaposition de différentes cultures qui finissent par se pénétrer – l’acte sexuel auquel la fin du roman fait allusion pourrait en être un symbole – est décrite comme suit: "À présent, deux espions habitent le même immeuble. La Chinoise dort au-dessus de l’Américain. Leurs rêves flottent l’un sur l’autre. Un escalier aux rampes de bronze relie leurs vies comme un cordon ombilical." (LC, 132) L’image du "cordon ombilical" qui suggère les idées d’origine et d’héritage, sert, dans ce contexte, plutôt à la déconstruction de toute entité stable et immobile. En fait, il lie des êtres qui font preuve d’une profonde "étrangeté à eux-mêmes". Il s’agit de deux êtres déshérités et déracinés qui s’installent, de leur propre gré, dans l’entre-deux. Cet espace entre les cultures qui permet des passages et des traverses est métaphorisé par l’escalier – espace liminal et hybride selon Homi Bhabha:
The stairwall as liminal space, in-between the designations of identity, becomes the process of symbolic interaction, the connective tissue that constructs the difference between upper and lower, black and white….This interstitial passage between fixed identifications opens up the possibility of a cultural hybridity that entertains difference without an assumed or imposed hierarchy.(33)
Selon cette image, la juxtaposition de différentes cultures dans Les conspirateurs ne signifie jamais un rapport hiérarchique mais est à la base d’échanges multiples.
Le dernier chapitre du roman qui évoque la possibilité d’un rapport "horizontal" entre les deux protagonistes – David monte chez Ankai, cette fois sans déguisement et non pas en cachette – ne signifie pas non plus l'absorption d'une culture par l’autre. Au contraire, il s’agit d'un échange réciproque et continu, comme l’affirme Shan Sa dans une entrevue:
[…] j’écris des rencontres de personnages de cultures opposées, de religions opposées, qui ont des intérêts opposés, pour montrer que ces conflits sont la base de la naissance d’une culture nouvelle dans laquelle tout le monde se retrouve. On ne perd pas la particularité culturelle, on en gagne une autre.(34)
Conclusion
Par sa recherche de nouveaux modèles pour une cohabitation entre individus et cultures Shan Sa s’inscrit avec ses œuvres dans la nouvelle "littérature-monde en français", telle qu’elle a été décrite dans le manifeste éponyme. Cette littérature nous parle du monde actuel dans toute sa complexité et hétérogénéité. Ce faisant, elle mène aussi à une redéfinition de la littérature "française" contemporaine. Celle-ci, de plus en plus traversée par les "voix venues d’ailleurs", est actuellement confrontée à une "perturbation productive" qui l’enrichit et suscite chez le lecteur une "panique voluptueuse". La mission de cette littérature, désormais décentrée, à laquelle appartient aussi Shan Sa, pourrait être décrite comme suit:
La tâche de donner voix et visage à l’inconnu du monde – et à l’inconnu en nous. Enfin, si nous percevons partout cette effervescence créatrice, c’est que quelque chose en France même s’est remis en mouvement où la jeune génération, débarrassée de l’ère du soupçon, s’empare sans complexe des ingrédients de la fiction pour ouvrir de nouvelles voies romanesques. En sorte que le temps nous paraît venu d’une renaissance, d’un dialogue dans un vaste ensemble polyphonique, sans souci d’on ne sait quel combat pour ou contre la prééminence de telle ou telle langue ou d’un quelconque "impérialisme culturel". Le centre relégué au milieu d’autres centres, c’est à la formation d’une constellation que nous assistons, où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l’imaginaire n’aura pour frontières que celles de l’esprit.(35)
▲
Remarques:
1 Heraklit, Fragment Nr. 52. Zit. nach : Andreas von Arnauld (Hg.),
Recht und Spielregeln, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 3.
2 Shan Sa, Les conspirateurs, Paris, Le livre de poche, 2007, 196 (= LC, p.).
3 Johan Huizinga, Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg, Rowohlt, 1956, 20. Pour une synopsis des théories les plus importantes du jeu cf. Ruth E. Burke, The Games of Poetics. Ludic Criticism and Postmodern Fiction, New York u.a., Peter Lang, 1994, 7-67.
4 Cf. Roger Caillois, Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch, Frankfurt a. M. u.a., Ullstein, 1982, 21-36.
5 Bruno Tritsmans, Livres de pierre. Segalen – Caillois – Le Clézio – Gracq, Tübingen, Gunter Narr, 1992, 37.
6 Ursula Mathis-Moser‑ Birgit Mertz-Baumgartner (éds.), La littérature "française" contemporaine. Contact de cultures et créativité, Tübingen, Gunter Narr, 2007, 13.
7 Emile Cioran, La tentation d'exister, Paris, Gallimard, 1997, 66.
8 Gisela Febel ‑ Karen Struve ‑ Natascha Ueckmann (éds.), Écritures transculturelles. Kulturelle Differenz und Geschlechterdifferenz im französischsprachigen Gegenwartsroman, Tübingen, Gunter Narr, 2007, 12-13.
11 Philippe Perrier, "Shan Sa, la France comme liberté", in : Lifre.fr décembre 2001. WWW : http://www.lire.fr/site.asp/idC=41953/idTC=29/idR=242/idG=# Letzter Zugriff 8.2.2008.
13 La rigueur que Shan Sa s’est imposée pour l’apprentissage de la langue française apparaît dans une interview : "Souvent, je passe des heures à écrire une seule phrase ; je suis plus modeste, je travaille la langue avec acharnement, je réécris 30 fois le même livre." Cf. Morency 2002.
15 Shan Sa, Porte de la paix céleste, Paris, Gallimard, 2007, 146 (= PPC, p.)
17 Shan Sa, La joueuse de go, Paris, Grasset, 2001 (= JG, p.).
18 Perrier 2001/2002. WWW : http://www.lire.fr/site.asp/idC=41953/idTC=29/idR=242/idG=# Letzter Zugriff 8.2.2008.
20 Cf. p.ex. LC, 75 : "Il marque un temps d’arrêt et improvise une tirade passionnée."
21 Il semble que Shan Sa s’est finalement libérée des événements de Tian An Men qui ne reviennent plus dans son roman le plus récent. Cf. Shan Sa, Alexandre et Alestria, Paris, Flammarion, 2006.
22 Cf. Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Flammarion, 1991.
23 Birgit Wagner, "Konfliktuelle Begegnungen. Ein Versuch über die räumliche Dimension von Kulturkontakten und Kulturkonflikten", in: Verena Berger ‑ Friedrich Frosch ‑ Eva Vetter (Hgg.), Zwischen Aneignung und Bruch. Studien zum Konfliktpotential von Kulturkontakten in der Romania, Wien, Löcker, 2005, 22.
25 Cf. Caillois 1982, 36.
28 Sigmund Freud, "Das Unbehagen in der Kultur", in: Sigmund Freud, Gesammelte Werke XIV. Werke aus den Jahren 1925-1931, Frankfurt, Fischer, 1999, 423.
29 Friedrich Nietzsche, "Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn", in: Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, Band III, München, Hanser, 1966, 314.
31 Febel‑Grote‑Ueckmann 2007, 26.
33 Homi K. Bhabha, "Introduction: locations of culture", in: Homi K. Bhabha, The location of culture, London, New York, Routledge, 1994, 4.
34 Thomas Flamerion, "L'amazone en quipao. Interview de Shan Sa", in: évène.fr, september 2006. WWW: http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-shan-sa-alexandre-alestria-476.php. Letzter Zugriff: 10.02.2008.
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Julia Pröll: La métaphore du jeu dans l’œuvre de Shan Sa: Indice d’une hybridation identitaire et culturelle? -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_proell.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25