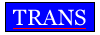 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
La quintessence française a pour source l’amour
Sabine van Wesemael (Université d’Amsterdam) [BIO]
Email : S.M.E.vanWesemael@uva.nl
Andreï Makine est souvent considéré par la critique comme un auteur français mais en fait son œuvre réconcilie deux univers, le français et le russe. Makine, de sa place d’émigré, n’arrête pas d’écrire sur le pays lointain et neigeux de sa naissance. Nous nous proposons d´étudier cette dialectique franco-russe en analysant la façon dont Makine s’est inspiré de la théorie de l’amour proustienne.
Andreï Makine a une forte prédilection pour la figure du jeune héros en quête d’amour. Mitia de Au temps du fleuve Amour, Aliocha du Testament français, le jeune narrateur de La femme qui attendait et celui de La terre et ciel de Jacques Dorme, pour ne citer que ces exemples, se présentent comme de jeunes ingénus désireux de découvrir la sensualité féminine dans un pays qui en principe ne semble pas avoir le sens de l’amour. Mitia revient sans cesse sur l’idée que l’univers sibérien n’est pas conçu pour abriter ce dernier :
La beauté était la moindre des préoccupations dans le pays où nous sommes nés [...]. L’amour aussi s’enracinait mal dans cette contrée austère. Aimer pour aimer a été, je crois, tout simplement oublié – atrophié dans la saignée de la guerre, étranglé par les barbelés du camp tout proche, glacé par le souffle arctique. Et si l’amour subsistait, c’était sous une seule forme, celle de l’amour-péché. Toujours plus ou moins imaginaire, il éclairait la routine des rudes journées hivernales.(1)
En Sibérie, les femmes, portant une carapace de vêtements molletonnés, n’évoquent rien de féminin. Leur féminité s’est épuisée depuis longtemps dans cette rude résistance quotidienne au froid, à la solitude, à l’absence de tout changement possible. Elles ressemblent aux amantes silencieuses des cosaques d’antan dont les corps, enduits avec de la graisse de renne, échappaient à l’étreinte. Les Sibériens “font” une femme et ne s’intéressent guère aux secrets de la sensualité féminine. Otar, un homme qui a pris le jeune narrateur de La Femme qui attendait en autostop, semble le porte-parole fidèle du savoir sibérien en matière d’amour :
Je veux te donner un conseil, tu es jeune, fais comme ce gros porc d’Azerbaïdjanais. Oui, pour ne pas souffrir, il faut être un porc. Tu vois une femelle, tu la baises, tu passes à la suivante. Surtout n’essaie pas d’aimer ! Moi, j’ai essayé, j’ai écopé de six ans de camp. C’est elle, ma foutue bien-aimée, qu’elle soit enculée cent fois par jour, qui m’a trahi [...]. Avec les femmes, je suis un porc, car elles sont toutes des truies.(2)
A la léthargie éternelle des steppes correspond chez les Sibériens un refus de toute forme d’idéalisme. Véra, qui attend depuis trente ans son amant qui, en 1945, est parti au front, est jugée folle. Dans son dernier roman, L’amour humain(3), Makine semble revenir un peu sur cette idée qu’en Sibérie l’amour est sordide et désespérant. Le protagoniste, Elias, pour qui l’amour est un critère secret, une pierre de touche pour juger toute activité humaine sur cette terre, se rend compte à la fin de son parcours révolutionnaire désillusionant qu’il aurait dû s’ensevelir avec son amante Anna dans le fin fond de la Sibérie orientale. Le narrateur, quelques jours avant la mort brutale d’Elias, comprend que celui-ci aurait été plus heureux si au lieu d’épouser les révolutions, il se serait installé avec Anna à Sarma : « Ce soir-là, à Cabinda, je crois comprendre ce qu’il a véritablement connu à Sarma : une vie qui naît quand l’Histoire, ayant épuisé ses atrocités et ses promesses, nous laisse nus sous le ciel, face au seul regard de l’être aimé. »(4)
Or, à l’exception d’Elias, les jeunes protagonistes de Makine s’offusquent de la rudesse des moeurs sexuelles en Sibérie et aspirent à un autre univers qui soit plus conforme à leurs besoins amoureux. C’est à chaque fois la figure maternelle qui les initie aux secrets de l’amour occidental qui constituera pour nos héros un apprentissage crucial. Olga de Au temps du fleuve Amour, Charlotte du Testament français et Alexandra de La terre et le ciel de Jacques Dorme, toutes nées en France au début du vingtième siècle, transmettent un savoir et une culture qui permettra aux jeunes protagonistes de connaître le savoir-faire érotique de l’Occident : « Et le magma effrayant et indicible de l’amour commença à se dire avec une clarté occidentale : séduction, désir, conquête, sexe, érotisme, passion. »(5) La France sera pour eux le pays du culte de l’amour dont le président Félix Faure meurt à l’Élysée dans les bras de sa maîtresse alors qu’à côté de Staline, de Khroutchev ou de Brejnev aucune présence féminine et, à plus forte raison, amoureuse n’était concevable : « Je pressentais dans cette liberté d’expression une vision insolite du corps, de l’amour, des rapports entre l’homme et la femme – un mystérieux ‘regard français’. »(6) La France, c’est avant tout le Paris romantique de la Belle Époque où un jeune dandy est trompé par sa maîtresse qui, lors d’une glorieuse soirée mondaine, tente de séduire le meilleur ami de son amant en lui caressant les pieds sous la table : « Rien dans notre univers ne correspondait à la finesse voluptueuse de la scène. Nous cherchions désespérément quel pied dans notre entourage pouvait être capable d’une telle caresse et d’une telle trahison. À nos yeux se présentaient de grosses bottes de feutre, des mains rouges couvertes de gerçures... ».(7) Mitia, Aliocha et beaucoup d’autres héros de Makine rêvent des aveux à bout de souffle, des lettres d’amour, des stratagèmes de la séduction, des affres de la jalousie, des intrigues qui ponctuent les récits des grands-mères sur la France de la Belle Époque. Or, une figure de cette période qui, bien sûr, fait travailler leur imagination, c’est Marcel Proust, l’auteur du roman-fleuve A la recherche du temps perdu, qui, tout comme l’oeuvre de Makine, offre avant tout un regard nostalgique. Les critiques ont évoqué à plusieurs reprises cette influence proustienne sur Makine. Certains journalistes l’ont même surnommé ‘un Proust des steppes’. Ainsi, selon Nina Nazarova, Proust et Makine passent de l’impression à l’expression en se servant d’un riche réseau métaphorique ; pour les deux le style est avant tout une vision et ils donnent la préférence à la description par rapport à la narration, rejetant l’action à la périphérie. Aliocha qui à la fin du Testament français découvre sa vocation littéraire – tout comme le narrateur proustien – estime en effet que c’est dans le styleque l’auteur se manifeste : « Ma situation outre-tombe est idéale, non pas seulement pour découvrir cette vie essentielle, mais aussi pour la recréer, en l’enregistrant dans un style qui reste à inventer. Ou plutôt ce style sera désormais ma façon de vivre. Je n’aurai d’autre vie que ces instants renaissant sur une feuille... » (8) Ce passage est un véritable pastiche des propos tenus par le narrateur proustien sur le roman qu’il envisage d’écrire ; lui aussi établit sans cesse un rapport entre style, métaphore et cette recherche de l’essence qui le hante depuis ses expériences de mémoire involontaire :
On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d’un beau style ; même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant l’une et l’autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore. (9)
Makine se préoccupe aussi constamment du côté stylistique de son oeuvre et y introduit même certains traits et techniques empruntés au style métaphorique de Proust, tels que l’inversion, la répétition et d’autres. À la suite de Proust aussi, Makine crée une autobiographie déguisée et les deux sont convaincus de la nécessité de ranimer la mémoire et de reconstruire la fragile vérité du souvenir.(10) Nazarova évoque le rapport indéniable entre Proust et Makine en termes très généraux et laisse donc la place à une analyse plus approfondie. Lors d’un entretien avec Arnould de Liederkerke dans Le Figaro, l’auteur lui-même stipule très clairement que sa poétique est proche de celle de Proust mais qu’on ne saurait jamais écrire comme l’auteur d’A la recherche du temps perdu et que c’est seulement avec l’éloignement que l’œuvre du grand maître prend tout son sens :
Je pense que dès que l’on commence à écrire on devient étranger. La langue littéraire est toujours une langue étrangère. À s’en tenir au français de Berlitz, uniforme, monolithique, Flaubert, Proust, Balzac, n’existeraient pas. On peut les imiter, on ne peut pas « devenir » Proust ou Balzac. Une langue c’est un univers différent. C’est d’ailleurs pour cela que certains auteurs nous restent tellement hermétiques :(11)
Qu’en est-il de l’influence de Proust sur Makine ? Afin de répondre à cette question nous nous concentrerons sur un thème omniprésent dans leurs deux œuvres – celui de l’amour.
Le Crime d’Olga Arbélina : Combray réécrit.
Dans Combray, Marcel Proust oppose deux types de mémoire qu’il valorise différemment : la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. Lorsque le héros-narrateur évoque consciemment son passé, il n’y a qu’un seul souvenir qui lui revient : le fameux drame du coucher. Selon Proust la mémoire volontaire est donc pauvre en souvenirs. Il y oppose la mémoire involontaire, plus riche en souvenirs authentiques et donc plus vraie. Comme chez Proust, l’enjeu, dans les romans de Makine, est surtout dans l’analyse des mécanismes de formation et de conservation des souvenirs. Tout comme A la recherche du temps perdu, maints romans de Makine, sont le récit d’un homme qui se penche sur son passé, d’un homme à la recherche des années écoulées, qui s’interroge sur la difficulté de ressusciter un passé disparu. Chez les deux auteurs, le roman se double ainsi d’un métadiscours où le commentaire sur la mémoire vient nourrir la mémoire elle-même.
Chez Proust les deux scènes, ‘drame du coucher’ et ‘scène de la Madeleine’ tournent autour de l’amour d’un petit garçon pour sa mère. C’est Serge Doubrovsky qui en 1974 déjà, dans son célèbre étude La place de la Madeleine, propose avant tout une analyse psychanalytique de la scène de la Madeleine insistant notamment sur son caractère sexuel (la petite coquille a la forme du sexe féminin) et sur l’oralité et l’analité du narrateur enfant. Ce n’est pas par hasard que c’est justement Olga, une des principales figures maternelles de l’œuvre de Makine, qui révèle à Mitia le sens profond de la mémoire involontaire chez Proust :
Le héros buvait, comme nous, un thé, sans pour autant avoir droit à un samovar. Une gorgée parfumée et une bouchée de gâteau au nom inconnu produisait en lui une réaction gustative merveilleuse : il voyait renaître les bruits, les odeurs, l’âme des jours lointains de son enfance. Sans oser interrompre le récit d’Olga, ni avouer notre intuition, nous nous demandions avec un étonnement incrédule : « Et si l’image cent fois revue, celle de la tisseuse, l’odeur fraîche des chapkas couvertes de neige fondue, l’obscurité de la salle de L’Octobre rouge, si tout cela pouvait remplacer le gâteau du jeune esthète français, si nous aussi nous pouvions accéder à cette mystérieuse nostalgie occidentale avec nos moyens de bord rudimentaires ? (12)
Les romans de Makine, de même que ceux de Proust sont dominés par le thème de la nostalgie. À cet égard, il faut d’ailleurs évoquer aussi l’œuvre de l’auteur russe Bounine dont la structure, selon Makine dans sa thèse, est également fondée sur une poétique de la nostalgie : « Il devient possible d’aborder l’univers poétique de Bounine comme une structure vivante d’images nostalgiques : celles de l’ancienne Russie, des civilisations disparues ou exotiques, de l’existence de la noblesse ruinée et enfin l’image nostalgique de telle ou telle ‘époque’ de l’histoire personnelle. » (13) Il suffit de remplacer le mot Russie par le mot France pour obtenir une caractérisation tout à fait adéquate de l’œuvre de Proust. Bounine, Proust et Makine vivent plongés dans leurs souvenirs. Mais revenons à nos moutons : Makine a souvent recours à la mémoire involontaire, à cette mémoire spontanée qui provoque des résurrections inattendues. C’est Mitia d’Au temps du fleuve Amour qui dans un restaurant russe à New York retrouve la Sibérie de son enfance en écoutant une chanteuse chanter une chanson russe : « Et la musique devient l’air frais de l’isba sentant la bourrasque, la chaleur lumineuse du feu, l’odeur du cèdre brûlé, le silence limpide de la solitude... » (14) Mais c´est surtout Olga dans Le Crime d´Olga Arbélina(15) qui tente de se réfugier dans cette réalité du souvenir comme instant conservé dans son originalité authentique. Ce roman est probablement le texte le plus proustien de Makine en ce sens qu’il peut se lire comme une variante de Combray ressucitant aussi bien le drame du coucher que la scène de la Madeleine. Olga, obsédée par l’amour incestueux que lui réserve son fils, aimerait retrouver la réalité innocente de sa prime enfance. Comme chez le narrateur proustien, c’est en buvant une tasse de thé que les premières impressions lui reviennent dans un tourbillon de souvenirs extra-temporalisés dévoilant cette personnalité authentique et non-coupable :
Cette éclosion des instants d’autrefois dura jusqu’à la nuit. À peine consciente, elle poussa la porte, enleva son manteau, alla allumer le fourneau, préparer le thé... Mais au-delà des gestes, ces éclats du passé, toujours très humbles et, on eût dit, inutiles, se déployaient, la laissaient vivre dans leur temps de lumière. Elle s’approchait de la table, prenait sa tasse, la théière... (Un jour de printemps, encore à Paris, dans cet appartement sombre où le seul rayon de soleil vient en fin d’après-midi, reflété dans les fenêtres de la maison d’en face. L’appartement où l’on pressent déjà un départ proche. Le rayon pâle glisse sur la table, emplit un bouquet de branches de merisier en fleur. Arrêtée sur le seuil, elle surprend l’enfant qui, le visage plongé dans les grappes blanches, chuchote en imitant plusieurs voix, avec l’intonation tour à tour suppliante ou enflammée. Elle recule d’un pas, le crissement d’une latte de parquet la trahit. L’enfant lève la tête. Ils se regardent longtemps en silence...). Elle s’éveilla au milieu de la cuisine, ne comprenant pas ce qu’il fallait faire de cette tasse, de cette théière qu’elle tenait encore, tels les objets dont on ignore l’usage...[...]. Avant de s’endormir, il y eut encore plusieurs chutes lumineuses dans le passé. Et une fois, en émergeant, en revoyant dans un seul regard tous ces reflets que sa mémoire avait secrètement retenus, elle eut cette pensée qui l’éblouit par son évidence : « Donc je n’ai rien oublié, je n’ai rien manqué du tout... » Le sommeil engourdissait déjà sa pensée. Elle comprenait seulement qu’à son insu elle avait préservé l’essentiel de cette enfance, sa part silencieuse, vraie, unique. (16)
Le crime d’Olga Arbélina relate le drame d’une femme confrontée à l’inceste que lui fait subir dans son sommeil un fils adolescent. Or, la fixation érotique d’un jeune enfant sur sa mère est également au centre du roman proustien. Ainsi, le drame du coucher nous est-il présenté en somme comme un complot d’amoureux. Le narrateur en montre bien le caractère amoureux par une longue comparaison avec une attente amoureuse que Swann avait éprouvée quelques années auparavant et par les renvois à François le Champi, un des romans champêtres de George Sand. Dans ce roman il s’agit également de la relation mère/fils. François, enfant trouvé, devient amoureux de Madeleine, sa mère adoptive, et l’épouse après la mort de son mari. Pour le narrateur c’est donc une première expérience de l’art comme compensation imaginaire d’un désir réel. François le Champi parle d’une mère qui peut être possédée par son fils. Proust, plus que Makine, revient sans cesse au fantasme originel d’amour pur pour la mère, au désir d’union sexuelle avec elle. Dans La Prisonnière, le narrateur établit régulièrement un parallèle entre son expérience avec Albertine et la scène du drame du coucher. Le baiser d’Albertine ne le calme pas plus que le baiser de sa mère à Combray : « Ce n’était plus l’apaisement du baiser de ma mère à Combray que j’éprouvais auprès d’Albertine, ces soirs-là, mais, au contraire, l’angoisse de ceux où ma mère me disait à peine bonsoir, ou même ne montait pas dans ma chambre, soit qu’elle fût fachée contre moi ou retenue par des invités. » (17) Chez Makine la mère apparaît également parfois comme une image pure, mais non pas sans souillure. Dans son dernier roman, L’amour humain, on constate un retour insistant de l’amour idéalisé pour la mère, même si cette mère est prostituée. Elias tombe amoureux d’Anna, une femme qui en principe n’est pas de son genre, parce qu’elle lui rappelle sa mère :
Il n’avait jamais vécu d’instants pareils en compagnie d’une femme et d’ailleurs il ne s’était jamais imaginé capable de vivre et de voir cette félicité douloureuse, cette acuité d’halluciné. C’était si neuf pour lui qu’un jour il eut envie de moquer cette sensibilité extrême qui l’habitait désormais. « L’homme nouveau ! » déclama-t-il, imitant le révolutionnaire costumé de la pièce qu’il avait vue avec Anna. Il sourit mais l’appellation ne sembla pas fausse : un être inconnu s’animait en lui. Et quand il pensa à cette présence nouvelle, alliage de tendresse, de confiance, de paix et terrible angoisse de perdre ce qu’il aimait, un souvenir lui revint, intact : à la nuit tombante, le seuil d’une case et cet enfant qui noie son visage dans le creux du coude de sa mère. Il crut alors avoir trouvé celle à qui il pourrait parler de cet enfant dont il n’avait encore trouvé l’existence à personne(18).
Chez Proust et Makine les figures paternelles sont systématiquement écartées du roman et elles expriment des idées similaires concernant le point de vue génétique (l’importance de l’enfance), le complexe de sevrage (le traumatisme d’abandon de la mère), le complexe d’Oedipe, le corps et la sexualité comme centre de l’existence humaine et la présence de l’inconscient. Mais une autre parenté entre ces deux auteurs réside dans le fait que, chez chacun, un interdit pèse sur l’amour idéalisé pour la mère. Dans La fugitive nous assistons à l’élimination progressive de l’image d’Albertine. Il y a retour de l’amour idéalisé pour la mère avec qui le narrateur part en voyage. À Venise le départ de la mère fait surgir un souvenir ancien dans l’esprit du narrateur qui annonce le châtiment qui se rattache au caractère incestueux de sa libido :
[...] si bien que ce bassin de l’Arsenal, à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de ce mélange de dégoût et d’effroi que j’éprouvai la première fois que, tout enfant, j’accompagnai ma mère aux bains Deligny, et où, dans ce site fantastique d’une eau sombre que ne couvraient pas le ciel ni le soleil et que cependant, borné par des chambrettes, on sentait communiquer avec d’invisibles profondeurs couvertes de corps humains, je m’étais demandé si ces profondeurs, cachées aux mortels par des baraquements qui ne les laissaient pas soupçonner de la rue, n’étaient pas la mère libre du pôle ; et dans ce site solitaire, irréel, glacial, sans sympathie pour moi, où j’allais rester seul, le chant de Sole mio s’élevait, et semblait prendre à témoin mon malheur.(19)
Ce passage évoque la nudité féminine. Le narrateur y souligne la fonction sexuelle de l’eau. La femme qui s’y baigne sera nue. La descente aux bains avec la mère se déroule comme un rite d’initiation. Mais le narrateur ressent un fort dégoût devant ce spectacle, cette mer immense est froide, polaire et par là menaçante. La mère se baigne dans ce passage dans une mer glaciale qui est comparée à l’entrée aux enfers : la mer libre devient une mer funéraire. Chez Proust, derrière le désir incestueux se profile toujours la mort. Au cours de La Prisonnière, Albertine amorce une métamorphose régressive qui la ramène d’abord à des formes végétales :
Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude d’un naturel qu’on n’aurait pu inventer, je lui trouvais l’air d’une longue tige en fleur qu’on aurait disposée là ; et c’était ainsi en effet : le pouvoir de rêver que je n’avais qu’en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d’elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l’amour : seul, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas ; présente, je lui parlais, mais étais trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n’avais plus à parler, je savais que je n’étais plus regardé par elle, je n’avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l’un après l’autre, ses différents caractères d’humanité qui m’avaient déçu depuis le jour où j’avais fait sa connaissance. Elle n’était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m’appartenait davantage.(20)
L’arbre, tout comme la mer, est avant tout un symbole maternel. Selon Bachelard, en plaçant le mort dans le sein de l’arbre « on vit doublement ce mythe de l’ensevelissement par lequel on imagine, nous dit Carl Jung, que ‘le mort est remis à la mère pour être réenfanté’. La mort dans les eaux sera pour cette rêverie la plus maternelle des morts ». (21) Avant de choisir l’accident d’équitation, Proust avait pensé à la noyade, à un moment prophétisée par Albertine : « La mer sera mon tombeau. Je ne vous reverrai jamais. Je me noierai, je me jetterai à l’eau. Comme Sapho ». (22) Au dernier terme de la métamorphose régressive d’Albertine, il y a donc la mort. Il y a la dégradation de l’être dans cette régression vers l’inerte et vers la pierre. Ce corps dont le narrateur admire d’abord la jeunesse et la féminité, devient marqué par la vieillesse et par la mort lorsqu’qu’il est contemplé endormi : « Ce fut une morte en effet que je vis quand j’entrai ensuite dans sa chambre. Elle s’était endormie aussitôt couchée ; ses draps, roulés comme un suaire autour de son corps, avaient pris, avec leurs plis, une rigidité de pierre » (23) Or, l’amour d’Olga pour son fils, un amour criminel, se situe également à la frontière de la mort et de la vie ; elle finit par sombrer dans la démence. Son fils souffre d’une maladie incurable et lors de l’acte amoureux, Olga prétend dormir, être morte :
Au début de la nuit, elle le vit apparaître de nouveau sur le seuil de la chambre. Elle se moula presque sans effort dans la mort momentanée qui rendait son corps insensible. Son bras qu’il souleva avec précaution pour le déplacer retomba avec la molle pesanteur du sommeil. Cette mort n’exigeait d’elle qu’une chose : se sentir totalement étrangère à ces déplacements furtifs transmis à son corps, à ces caresses à peine perceptibles et toujours comme étonnées d’elles-mêmes, à tout ce lent et craintif sortilège de gestes et d’expirations retenues. Oui, s’éloigner de ce corps, être intensément morte en lui... .(24)
Margaret Parry est d’avis que l’inceste dans ce roman n’est guère présenté comme un amour perverti (comme chez Proust). Selon elle, l’amour d’Olga pour son fils se vit comme un amour rédempteur, qui la restaure, la rend à elle-même et à un état d’intégrité d’avant la chute, la déchéance.(25) Ce qu’on pourait objecter à cette interprétation, c’est qu’Olga a la mort dans l’âme et qu’elle finit par sombrer dans la démence : sur le rapport incestueux pèse donc bel et bien un interdit chez Makine.
Ceci n’empêche que Makine partage avec Proust un goût de la perversion ; les deux auteurs s’intéressent spécialement à toutes sortes de perversions sexuelles : exhibitionisme, masochisme, sadisme, voyeurisme et cetera. A la recherche du temps perdu et les romans de Makine abondent en actes sexuels obscènes où la femme est traitée de façon sadique. Le narrateur proustien terrorise Albertine par des interrogatoires inquisitoriaux tandis que Mitia désire mépriser le grand corps amorphe de la prostituée rousse, l’humilier, lui imposer sa force dédaigneuse. Et le dernier roman de Makine, L’amour humain, s’ouvre sur la description d’une femme violée par des combattants. Les personnages de Proust et de Makine fuient souvent les amours normaux. Ainsi, on signale également l’importance du scopique et plus particulièrement du voyeurisme dans la figuration de la séduction amoureuse chez les deux auteurs ; c’est comme si leurs personnages avaient peur de l’amour agissant et fuyaient dans une attitude passive. Jouer du regard de l’autre afin de se l’approprier, est essentiel, par exemple, dans la scène de séduction entre le baron de Charlus et Jupien dans Sodome et Gomorrhe. Le comportement et les regards des deux protagonistes sont une façon de figurer de quelle manière l’amour exige qu’on se soumette au désir de l’autre. Chez Makine, on rencontre également beaucoup de personnages qui assistent, involontairement, pour leur satisfaction et sans être vus, à quelque scène érotique. Elias s’accroupit derrière un bac à fleurs et assiste à une scène sexuelle entre l’organisatrice du colloque et un dessinateur kinois tandis que le narrateur proustien à Montjouvain, caché derrière une touffe de buissons, assiste, sans être vu, aux amours de Mlle Vinteuil et son amie. Aliocha, sur une péniche, contemple un soldat et une femme qui font l’amour : « Mon excitation était telle que le bord de la péniche me parut soudain étalé à l’horizontale ». (26) Voyeurisme et onanisme sont intimement liés. On a déjà insisté sur le caratère érotique des scènes de découverte de l’amour homosexuel chez Proust ; la scène de Montjouvain serait en réalité également une scène de masturbation.
Or, un autre point commun entre Proust et Makine c’est qu’ils ne condamnent jamais la conduite de leurs personnages ; ils évitent le ton moralisateur et soulignent sans cesse le caractère normal de l’amour perverti. Dans la scène de Montjouvain, le narrateur affirme qu’il ne faut pas se fier aux apparences et condamner l’acte odieux de Mlle Vinteuil : lors de leurs ébats amoureux les deux femmes crachent sur le portrait de M. de Vinteuil, décédé depuis quelque temps. Selon le narrateur, Mlle Vinteuil n’est en réalité nullement une fille perverse ; elle n’a contre son père aucun ressentiment :
Les sadiques de l’espèce de Mlle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux que même le plaisir sensuel leut paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s’y livrer un moment, c’est dans la peau des méchants qu’ils tâchent d’entrer et de faire entrer leur complice, de façon à avoir eu un moment l’illusion de s’être évadés de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir. (27)
Les narrateurs de Makine, confrontés aux perversions sexuelles, se révèlent aussi moralement neutres, étrangers à toute considération de valeur morale. Ainsi, le narrateur de L’amour humain, lui aussi, se montre tolérant à l’égard de tout amour interdit :
Hier encore, tout cela m’aurait paru d’une totale insignifiance. Une femme blanche, profite d’un voyage professionnel en Afrique pour nouer une liaison peu encombrante avec un jeune Africain sexuellement mieux fourni que son mari, ce Christian aux yeux honnêtes et mélancoliques. Très peu moraliste, j’aurais même trouvé ça plutôt ‘sympa’, le bénéfice du féminisme devenu routine, la modernité déclompexée. (28)
Comment Makine se distancie de son maître
Dans Au temps du fleuve Amour, Olga explique à Samouraï et Mitia que ce n’est pas la taille du sexe qui compte mais que c’est la consonance de tout – de lumières, d’odeurs, de couleurs :
Olga dit que le corps d’une femme arrête le temps. Par sa beauté. Tout le monde court, s’agite... toi, tu vis dans cette beauté...[...]. Je l’écoutais distraitement. Je crus saisir l’essentiel. C’était le visage de la blonde inconnue sur la rive que je revoyais maintenant. Oui, c’était une consonance : le ruissellement de l’Oleï, sa fraîcheur, le souffle odorant du feu de bois, le silence attentif de la taîga. Et cette présence féminine intensément concentrée dans la courbe tendre du cou de la blonde que je dévisageais par-dessus la danse des flammes. (29)
Makine semble ici rejoindre la théorie proustienne concernant le rôle important que jouent métonymie et métaphore dans l’amour. Souvent, chez Proust, on trouve des transpositions typiquement métonymiques pour souligner leur coexistence dans le même contexte mental. Proust, également, essaie d’assimiler chaque objet, chaque personnage à son environnement. Ainsi, Albertine est-elle sans cesse décrite en termes marins parce que le narrateur l’a rencontrée pour la première fois au bord de la mer : « Albertine tenait, liées autour d’elle, toutes les impressions d’une série maritime qui m’était particulièrement chère » , conclut le narrateur dans Le côté de Guermantes. (30) Or, une différence fondamentale entre Proust et Makine c’est que ce dernier rejette en fin de compte cet amour sublimé par les associations métonymiques. Après son aventure amoureuse avec la prostituée rousse, Mitia dénonce les théories d’Olga comme de folles chimères :
Je ressentais envers eux non plus de la jalousie, mais une sorte de mépris haineux. Surtout vers Samouraï. Je me souvenais de ses longs discours dans les bains. Sur les femmes. Sur l’amour. Ses éternelles citations de cette vieille folle d’Olga. Comment disait-il déjà ? « L’amour est une consonance. » Quel imbécile ! L’amour, mon cher Samourai, c’est une isba qui sent la fumée froide. Et l’horrible solitude de deux corps nus sous une ampoule d’un jaune violet. (31)
Chez Makine l’amour est beaucoup moins sublimé et intellectualisé que chez Proust ; il attribue une importance beaucoup plus grande à l’amour physique qui est quasiment absent de l’œuvre proustienne. Aliocha, après avoir fait maladroitement l’amour à une jeune fille décide de se rendre à Saranza pour détruire la France : « Il fallait en finir avec cette France de Charlotte qui avait fait de moi un étrange mutant, incapable de vivre dans le monde réel ». (32) Et Mitia, en fin de compte, est beaucoup plus tenté par les ébats physiques de Belmondo que par l’amour épuré proustien ; il ne trouve pas le corps féminin chez l’auteur d’A la recherche du temps perdu, sa sensualité physique : « Mais vint Belmondo avec ses exploits pour rien, avec ses performances sans but, son héroïsme gratuit [...]. Nous découvrîmes que la présence charnelle de l’homme pouvait être belle en soi ! Sans aucune arrière-pensée messianique, idéologique ou futuriste ». (33) Belmondo, contrairement à Proust qui décrit sans cesse l’aspect obscur de la sexualité, apprend à Mitia que nous possédons un corps capable de se donner, de jouir, immédiatement, naturellement. Dans la scène qui ouvre Au temps du fleuve Amour, Mitia, tel un ours, un barbare venu du pays des neiges éternelles, fait l’amour à une femme qui s’appuie sur un piano : « Et quand elle me sent détonner en elle, la symphonie se brise en un jet de notes aiguës et fébriles fusant sous ses doigts. Ses mains tambourinaient en s’accrochant aux touches glissantes. Comme si elles s’agrippaient à l’invisible bord du plaisir qui se dérobe déjà à la chair ». (34) Or, cette scène est l’exacte réplique d’une scène que Mitia a vue dans un film de Belmondo où le héros, de façon très acrobatique mais élégante, fait l’amour à une superbe espionne renversée également sur un piano. Et le narrateur de La femme qui attendait veut réveiller la sexualité de Véra qu’elle étouffe ; il s’oppose à son amour-sacrifice et s’imagine qu’elle baise à droite et à gauche : « Rien ne blesse aussi durement que la banalité amoureuse chez une femme qu’on a idéalisée. L’existence que j’avais imaginée pour Véra était un joli mensonge. La vérité se nichait dans le corps de cette femme, une femme qui très sainement, une fois par semaine (ou plus fréquemment) couchait avec un homme [...] ». (35)
L’aspect physique de l’amour, le culte de l’érotisme, est donc beaucoup plus important chez Makine que chez Proust. Une autre différence majeure entre les deux auteurs est que la théorie de l’amour de Proust est beaucoup plus pessimiste justement parce qu’il a une conception trop intellectuelle et trop sublimée de l’amour. Makine ne semble pas partager les idées de Proust concernant le caractère captatif de tout amour, l’incommunicabilité fondamentale entre les êtres et la jalousie en tant que moteur de l’amour ; la jalousie ranime l’amour. Bien au contraire, chez Makine, le plus souvent, l’amour n’est pas lié à la déception. Dans A la recherche du temps perdu l’amour nous est présenté comme impossible, sa réalisation étant hors du pouvoir humain. Or, bon nombre des romans de Makine réintègrent, au contraire, l’amour à un univers de pureté et d’innocence. La terre et le ciel de Jacques Dorme est conçu en tant qu’une chronique de l’amour d’une Française habitant en Russie et d’un pilote français prenant part aux opérations aériennes militaires en Sibérie pendant la deuxième guerre mondiale. Ivan de La Fille d’un héros de l’Union soviétique, se marie avec Tatiana, la femme qui l’a sauvé, malgré ses blessures : « Tu sais, Tania, je t’aimerai encore davantage avec ta blessure ! » (36) Et l’histoire d’Elias et d’Anna de L’amour humain, convainc le narrateur du caractère sacré de l’amour :
Je n’ai pas revu Elias et je n’ai pas eu le temps de repenser à ses paroles. Une fois seulement, dans une brève intuition douloureuse, je me suis rendu compte que son amour pour Anna, leur amour, ressemblait à la béance du ciel la nuit où nous avons parlé pour la dernière fois. Un ciel superbement étoilé au-dessus d’une ville qui s’apprêtait à mourir. Pareil à ce gouffre noir, leur amour se passait de mots, trop éloigné de la vie des humains. J’ai senti en moi une méfiance, un doute, le besoin d’une preuve, Je devinais pourtant que croire en cet amour était l’ultime croyance de ma vie, la foi au-delà de laquelle rien ici-bas n’aurait plus eu de sens(37).
Makine a donc une conception beaucoup plus optimiste de l’amour mais il s’accorde avec Proust pour qui l’art représentait l’ultime possibilité d’échapper aux contingences et aux déceptions de l’amour, de l’amitié et de la vie mondaine ; l’art nous apporte des satisfactions que la vie nous refuse dans ce sens qu’il nous permet de fixer l’essence des choses entrevue momentanément dans la vie de tous les jours. Aliocha, installé dans un cimetière parisien, finit par comprendre que l’Atlantide de Charlotte l’a laissé entrevoir, dès son enfance, cette mystérieuse consonance des instants éternels qu’il doit maintenant, tout comme le narrateur proustien, exprimer dans une œuvre d’art :
Ma situation outre-tombe est idéale, non pas seulement pour découvrir cette vie essentielle, mais aussi pour la recréer, en l’enregistrant dans un style qui reste à inventer. Ou plutôt, ce style sera désormais ma façon de vivre. Je n’aurai d’autre vie que ces instants renaissant sur une feuille...(38)
Cette analyse contrastive des théories de l’amour de Proust et Makine montre que la situation migrante possède un potentiel créateur, l’auteur émigré étant confronté avec tout un patrimoine culturel supplémentaire dont il peut s’inspirer ou, au contraire, se démarquer. Pour Makine la confrontation avec la culture française fut certes enrichissante mais il serait erroné de confiner l’auteur dans la seule tradition française ; mieux vaut l’approcher à la manière d’un écrivain international.
Remarques:
1 Andreï Makine,
Au temps du fleuve Amour, Paris, Folio, 1994, 17.
2 Andreï Makine, La femme qui attendait, Paris, Éditions du Seuil, 2004, 66.
3 Andreï Makine, L’amour humain, Paris, Éditions du Seuil, 2006, 236.
4 Andreï Makine, op. cit., 236.
5 Andreï Makine, op.cit., 133.
6 Andreï Makine, Le testament français, Paris, Folio, 1995, 264.
7 Andreï Makine, Au temps du fleuve amour, op. cit., 198.
8 Andreï Makine, Le testament français, op. cit., 309.
9 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Paris, Éditions de la Pléiade, 1954, établies par Pierre Clarac et André Ferré, III, 889. Nous citons désormais de cette édition.
10 Nina Nazarova, Andreï Makine, deux facettes de son oeuvre, Paris, L’Harmattan, 2005.
11 Arnould de Liederkerke, « Andreï Makine: politiquement incorrect », propos recueillis dans : Le Figaro magazine, 26 février 2000, 86.
12 Andreï Makine, Au temps du fleuve amour, op. cit., 217.
13 Andreï Makine, La prose de I.A. Bounine: la poétique de la nostalgie, thèse de doctorat d’études slaves, Université de Paris IV, 1991, 9.
14 Andreï Makine, op. cit., 260.
15 Andreï Makine, Le Crime d’Olga Arbélina¸ Paris, Mercure de France, 1998.
16 Andreï Makine, op. cit.,202-203.
17 Marcel Proust, op. cit., III, 111.
18 Andreï Makine, L’amour humain, op. cit., 146-147.
19 Marcel Proust, op. cit., III, 653.
20 Marcel Proust, op. cit., III, 69-70.
21 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Paris, José Corti, 99.
22 Marcel Proust, op. cit., II, 801.
23 Marcel Proust, op. cit. III, 359.
24 Andreï Makine, Le crime d’Olga Arbélina, op cit., 196.
25 Margaret Parry, « Makine, romancier orthodoxe », dans: Margaret Parry (dir.), Andreï Makine, Perspectives Russes, Paris, L’Harmanttan, 2005, 115-127.
26 Andreï Makine, Le testament français, op. cit., 236.
27 Marcel Proust, op. cit., I, 162.
28 Andreï Makine, L’amour humain, op. cit., 138.
29 Andreï Makine, Au temps du fleuve amour, op. cit., 53.
30 Marcel Proust, op. cit., II, 363.
31 Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, op. cit., 97.
32 Andreï Makine, Le testament français, op. cit., 248.
33 Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, op. cit., 129.
34 Andreï Makine, op. cit., 15.
35 Andreï Makine, op. cit., 131.
36 Andreï Makine, La fille d’un héros de l’Unions soviétique¸ Paris, Folio, 1995, 37.
37 Andreï Makine, op. cit., 264.
38 Andreï Makine, Le testament français, op. cit., 309.
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Sabine van Wesemael: La quintessence française a pour source l’amour -
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_wesemael.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25