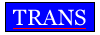 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
«Eloge de la fuite»: la poétique de l’exil de Gao Xingjian
Laurence Dahan-Gaida (Université de Franche-Comté, France) [BIO]
Email: dahangaida@free.fr
« L’individu a toujours connu son épanouissement
grâce à ces rencontres successives avec l’extérieur.»
François Cheng (Extrait d'une interview du 13 Avril 1999)
Ecrire du dehors
Ecrivain chinois naturalisé français, qui écrit en Chinois mais vit en France où il a obtenu le prix Nobel en 2000, Gao Xingjian embarrasse aussi bien l’institution littéraire française - qui ne sait comment l’étiqueter - que les autorités chinoises qui conçoivent mal la séparation entre le territoire national et les identités culturelles.(1) Or Gao refuse de solidariser son projet littéraire avec une appartenance nationale de même qu’il refuse l’antinomie idéologique de la Chine et de l’Occident. L’ouverture d’horizon imposée par la mondialisation suppose à ses yeux l’abandon des limites obsolètes : l’homme ne vit plus au centre d’un espace et de sa mémoire, il se tient désormais au seuil des choses, à la charnière des cultures et des traditions, dans un entre-deux dont il lui faut exploiter les ressources.
Dans Le Livre d’un homme seul(2), son deuxième roman, ces questions sont évoquées lors d’un colloque réunissant écrivains et intellectuels chinois du monde entier :
Et la littérature chinoise permet-elle de communiquer ? Et avec qui ? Avec l’Occident ? Ou bien entre les Chinois du continent et ceux d’outre-mer ? Et qu’appelle-t-on littérature chinoise ? La littérature connaît-elle des frontières ? Comment définir les écrivains chinois ? Est-ce que les Chinois du Continent, de Hong Kong, de Taï Wan et ceux qui ont la nationalité américaine, sont tous des Chinois ? [...] Tu as complètement perdu le goût de ce genre de polémique sur la littérature et la politique, la Chine est tellement éloignée à présent, tu as été exclu depuis longtemps par cet Etat, tu n’as pas besoin de son label, simplement tu utilises encore le chinois pour écrire, rien d‘autre. (373)
La mondialisation est en passe de faire émerger un nouvel espace littéraire, constitutif d’un espace sinophone qui inclut non seulement la Chine continentale mais aussi les littératures de Taï Wan, Hong Kong et Macao ainsi que celles de la diaspora. Prenant ses distances par rapport à une culture (chinoise) que le pouvoir présente volontiers comme «monolithique et territoriale alors qu’elle est disséminée et réinventée au contact du monde extérieur»(3), Gao assigne à l’écrivain une position d’extra-territorialité, qui renvoie non seulement à son expérience d’exilé mais aussi à une pratique littéraire qui renoue avec la tradition de la mise en exil par l’écriture. Loin d’être une expérience négative, l’exil possède pour Gao une dimension créative : en coupant l’écrivain de la langue maternelle, du contexte social où elle est parlée et de son lectorat, l’exil le pousse en effet à mûrir, c’est-à-dire à développer une attitude plus grave et plus rigoureuse vis-à-vis de la langue.(4) C’est là que se situe la créativité de l’exil pour Gao : dans une conscience accrue de la langue, dans un sentiment de responsabilité plus aiguisé à son égard :
Lorsqu’un homme se sépare de sa prétendue patrie, il acquiert une distance qui lui permet d’écrire de manière détachée. La culture chinoise est diffuse dans mon sang, je n’ai pas besoin de me rajouter une étiquette. […] Pour un écrivain, l’important est de se détacher, il lui faut créer et non vivre l’héritage de ses ancêtres. […] L’écrivain n’est ni le représentant d’une culture nationale, ni le porte-parole des masses populaires ; et si, par malheur, il devient l’un ou l’autre, il sera totalement méconnaissable.(5)
L’exil est pour l’écrivain un moyen de se libérer de toute détermination sociale ou politique et ainsi d’atteindre à la pleine conscience de soi. Mais l’exil n’est pas seulement d’ordre politique ou géographique : il est d’abord un état existentiel, lié à la pratique de l’écriture, qui apparente l’existence à un séjour loin de chez soi, où que l’on se trouve, même dans le pays natal. Gao attire notre attention sur la productivité de l’exil, qui n’est pas seulement déracinement, arrachement, mais aussi un dépaysement créateur qui permet de libérer des ressources à exploiter : non seulement des possibles de pensée, mais aussi des possibles de langue et d’identité.
Thème essentiel dans la poétique de Gao, l’exil est aussi un principe structurant de son écriture qui articule exotopie, dialogisme et mobilité énonciative à l’intérieur d’un modèle original. Empruntée à Bakhtine, la notion d’exotopie désigne à la fois un hors-lieu créateur à partir duquel l’écrivain peut reconfigurer la langue et un hors-soi fondateur qui lui permet de recomposer son identité.(6) Ce double mouvement vers le dehors procède d’une volonté de mettre à distance sa culture d’origine, de se libérer des catégories ethnocentriques de départ pour produire de nouvelles configurations, c’est-à-dire de nouvelles rencontres et de nouveaux usages de la langue. C’est ce que j’essaierai de montrer à partir d’une lecture de son deuxième roman, Le Livre d’un homme seul.
Ex-optiques
Le Livre d’un homme seul (Yigeren de shengjing) est un livre du souvenir, une auto-fiction dans laquelle Gao Xingjian règle ses comptes avec l’histoire de la Chine et avec sa propre histoire.(7) La phrase initiale du roman - «Il n’a pas oublié qu’il a eu une autre vie» - exprime une coupure existentielle qui imprime sa marque à tous les niveaux du récit. Le roman repose en effet sur le parallélisme entre deux lignes narratives distinctes, qui sont présentées en alternance et correspondent à deux vies successives : les cinquante années en Chine – l’enfance et l’adolescence heureuse, la révolution culturelle, la fuite à la campagne – puis l’exil à Hong Kong, Stockholm, Sydney, New York et finalement en France. Le passage d’une temporalité à l’autre est souligné par l’alternance entre la 2ème et la 3ème personne qui se relaient sur un rythme strictement binaire tout au long des 61 chapitres. Inspiré par Marguerite Duras et par Georges Perec,(8)le jeu avec les pronoms personnels permet de donner voix aux différents points de vue d’une même conscience : alors que le IL renvoie au passé du protagoniste et à la longue temporalité des années chinoises, le TU renvoie au présent de la narration et à l’espace de liberté ouvert par l’exil
Tout en contribuant à construire l’altérité du IL, le recours à la 2ème personne permet d’objectiver les souvenirs du narrateur, d’installer la distance nécessaire à l’auto-observation d’un homme qui dit n’être «plus manipulé par aucune doctrine», un «observateur qui vit en marge de la société, qui, bien qu’il ne puisse éviter d’avoir un point de vue, une opinion et ce que l’on nomme des penchants, n’a aucune doctrine voilà où réside la différence entre le «tu» ici présent et le «il» que tu observes» (200) :
[...] tu veux te contenter d’exposer les faits pour revenir grâce au langage au «il» de ce temps-là, tu reviens aux lieux et aux temps qui correspondent à ce «il» à partir des lieux et du temps présent. A partir de ton état actuel, tu veux montrer le «il» de cette époque. Voilà où réside sans doute le sens de ton observation. (200)
Soumis au pouvoir totalitaire, «souillé» par la politique, IL, l’acteur de l’histoire est deux fois dissocié de l’auteur qui le tient «à la vigilance introspective»(9) par le biais du TU, qui est un sujet libre, en exil, désolidarisé de celui qu’il fut : «Toi, c’est toi, et lui c’est lui» (237). Si dans les premiers chapitres, la séparation des deux perspectives est rigoureusement maintenue, des interférences viennent peu à peu brouiller leur écart et déconstruire la hiérarchie entre le sujet et l’objet de l’observation. Dans certains chapitres, le TU fait brusquement irruption dans la narration pour interpeller le IL, abandonnant le ton neutre du témoin pour celui, accusateur, du critique. Le monologue cède alors la place à un tissage dialogique qui montre l’effort des deux voix pour essayer de se comprendre mutuellement et pour essayer de comprendre ensemble. Par ses justifications ou ses explications, IL semble répondre aux interrogations, aux doutes, aux critiques du narrateur à la deuxième personne :
Où fuir ? te demande-t-il. Il ne pouvait fuir cet immense pays, il ne pouvait quitter le grand bâtiment de son organisme aussi bourdonnant qu’une ruche, où il gagnait l’argent pour se nourrir. [...] Il dit qu’il n’avait pas d’autre choix, qu’il était comme une abeille protégée par cette ruche, la folie y régnait et ils n’avaient d’autre issue que de s’attaquer mutuellement en s’agitant en tout sens, reconnaissait-il.
Est-ce qu’en s’agitant ainsi on arrivait à sauver sa vie ? demandes-tu.
Mais c’était déjà fait, dit-il en riant amèrement. S’il avait pu réaliser dès le début, il n’aurait pas été un insecte.
Un insecte capable de rire, voilà quelque chose d’étrange, tu t’approches pour l’examiner.
Ce qui est étrange, c’est ce monde, ce ne sont pas ces insectes qui dépendent de la ruche, dit l’insecte. (336-337).
Le dialogisme est un moyen d’éveiller la pensée, de favoriser la prise de conscience de soi qui, selon Bakhtine, implique toujours un interlocuteur, le regard d’autrui qui se pose sur nous et nous permet de dialoguer avec nous-mêmes. L’homme en effet ne possède pas de territoire intérieur souverain, il n’existe qu’en dialogue avec un point de vue extérieur, qui lui permet de saisir les reflets de sa propre existence : «Je ne puis me passer d’autrui, je ne puis devenir moi-même sans autrui (dans le reflet, dans la perception mutuels)».(10) En l’absence de cet autre, c’est à l’écriture qu’il revient d’inventer un point de vue extérieur et, par là, de rendre possible le dialogue avec soi, ce qui est pour Gao sa vocation première : «On peut dire que se parler à soi-même constitue le point de départ de la littérature, communiquer au moyen du langage vient en second.»(11) Le dialogue avec soi-même permet à l’écrivain de mettre à distance celui qu’il a été, de l’observer du dehors et ainsi de prendre la mesure de l’écart entre celui qu’il fut et celui qu’il est devenu. Ce hors-soi créateur implique un dédoublement de la perspective qui ne va pas sans effets de réverbération. Comme dans le passage suivant où le narrateur, qui porte un regard sur sa façon de regarder dans le passé, en vient à s’observer lui-même s’observant :(12)
On peut aussi changer d’angle de vue, tu te trouves parmi les spectateurs, tu le regardes monter sur la scène, une scène vide, il se tient debout, nu, et sous la lumière crue des projecteurs, il doit pendant un instant s’habituer à cette lumière avant de pouvoir, à travers le faisceau lumineux éclairant la scène, te distinguer toi, assis sur un fauteuil de velours rouge au dernier rang au fond du théâtre vide aussi. (320)
Le croisement réciproque des points de vue suppose l’existence d’un «troisième œil», celui de l’auteur qui construit la position du sujet en même temps que celle de l’objet à voir, livrés au lecteur dans la spécularité de leur auto-réfléchissement. Tout autant qu’une pratique, l’écriture de soi est donc une optique – une ex-optique, comme le dirait F. Jullien – qui, pour «faire voir», impose son angle d’approche, ses cadrages et ses focalisations, lesquels sont eux-mêmes le produit d’une mise en scène, celle qui est réalisée par le dispositif énonciatif. Le modèle de cette écriture est l’objectif photographique, métaphore récurrente dans le texte.
Dans le deuxième chapitre, alors qu’il est dans une chambre d’hôtel avec son amante à Hong Kong, le narrateur s’imagine qu’ils pourraient être filmés par une caméra. L’œil de la caméra est une allégorie idéologique et politique du pouvoir qui transforme le réel en champ de surveillance. Mais il est aussi une allégorie du pouvoir créateur de l’écriture qui requiert une présence et une temporalité discontinues, proches de la photographie. L’objectif de la caméra permet de recomposer le regard et le récit selon une perspective dont la neutralité n’est qu’apparente : «ce que tu veux, c’est un réel limpide, comme un tas d’ordures saisi par un objectif, l’ordure reste l’ordure, mais à travers l’objectif elle porte ta tristesse. Le réel, c’est cette tristesse.» (427). L’objectivation produite par le dispositif optique n’est ni statique ni réifiante car derrière l’objectif, «l’œil de l’homme vise et règle la distance focale. […] Dans l’œil d’un homme vivant, il n’y a pas d’image visuelle purement objective, il garde toujours une part de sensation ; même s’il reste totalement froid, cette image visuelle fait encore appel à une certaine disposition d’esprit».(13) Derrière l’apparente objectivité du point de vue, ce que l’écriture cherche à transmettre, ce n’est pas une vérité universelle mais une expérience vivante, humaine, personnelle :
«La prétendue sincérité des poètes est comme la prétendue vérité des romanciers, l’auteur se dissimule derrière elle comme un photographe se cache derrière son objectif, en apparence il a l’air froid et impartial derrière son objectif neutre, mais [...] ce regard faussement neutre est mû par toutes sortes de désirs, et ce qu’il reflète est complètement teinté de saveur esthétique, même si l’on fait semblant de considérer le monde d’un regard froid et indifférent. Le mieux est que tu reconnaisses que ce que tu écris est tout au plus ressemblant, quoique toujours séparé du réel par le langage» (255)
La littérature «froide» réclamée par Gao est une littérature sans pathos ni lyrisme, qui congédie les postures du témoignage comme de l’engagement politique pour valoriser l’expérience vivante, subjective, singulière «d’un homme seul». Refusant tout asservissement au collectif et au politique, elle n’a d’autre justification que l’individu singulier, fragile, souffrant, qu’elle aide à supporter l’existence : «La littérature froide est une littérature de fuite pour préserver sa vie, c’est une littérature de sauvegarde spirituelle de soi-même afin d’éviter l’étouffement par la société».(14) Combinant désir d’échappée et vigilance critique, cette littérature cherche à soustraire l’expérience vécue aux récupérations idéologiques, ce qui impose à l’écrivain une position d’extériorité : «le meilleur choix est de rester au bord de la société. Tout en ne cessant de critiquer. Mais en restant vigilant quand l’enthousiasme tout autour s’enflamme. Sinon, tu es entraîné. Ou bien tu domines la situation (en t’excluant), ou bien tu es dominé par les autres !»(15) Malgré son appel au désengagement et à l’intransitivité, l’écriture de Gao ne procède pas d’une forme d’escapisme, elle témoigne au contraire d’une exigence éthique qui se manifeste par l’insoluble tension qu’elle instaure entre histoire et individu, histoire et littérature.
Hors lieu
Loin d’être seulement liée à l’exil et à l’expérience de réfugié en Occident, la fuite est pour Gao une expérience inaugurale, comme le suggère ce passage extrait de son premier roman, La Montagne de l’âme : « Je suis un réfugié depuis ma naissance. Ma mère disait qu’elle avait accouché en plein bombardement. [...] J’ai poussé mon premier cri seulement quand le docteur accoucheur m’eut donné une fessée. Voilà sans doute ce qui m’a prédestiné à fuir ma vie durant. Je m’y suis habitué et j’ai appris à trouver un peu de plaisir dans les espaces vides entre ces périodes de désordre».(16)
Thème central dans Le Livre d’un homme seul, la fuite est d’abord celle de l’intellectuel qui se réfugie à la campagne pour échapper aux «chiens de chasse» qui veulent lui faire répondre de ses activités au sein du groupe de gardes rouges rebelles qu’il a dirigé autrefois ; c’est aussi la fuite du réfugié politique en Occident, déclinée en ses stations successives. Comparée au mouvement de repli d’un insecte ou d’une bête sauvage, la fuite est la manifestation d’un instinct animal de survie qui échappe à tout jugement moral. En effet, les individus vivant en régime totalitaire n’ont pas le choix, ils doivent «quitter l’arène» pour préserver en eux-mêmes un «espace non-souillé» (156).(17)
Mais la fuite ne relève pas seulement d’une détermination politique, elle est aussi liée au refus de se laisser enfermer dans une identité figée, de s’identifier à une étiquette, qu’elle soit nationale, idéologique ou artistique : «Tu as écrit ce livre pour toi, un livre sur la fuite. Le Livre d’un homme seul, tu es à la fois ton Seigneur et ton apôtre, tu ne te sacrifies pas pour les autres, et tu ne demandes pas qu’on se sacrifie pour toi, voilà, c’est on ne peut plus équitable.» (257) Si la fuite permet d’échapper à l’oppression politique et à toute forme de détermination extérieure, le prix à payer pour cette liberté est le renoncement absolu : «il n’a plus de patrie, plus de ce que l’on appelle le pays natal, ses parents sont morts tous les deux, il n’a plus de maison de famille, plus de préoccupations, il est seul au monde, beaucoup plus léger, il peut aller où bon lui semble, se déplacer au gré du vent, à condition que personne ne vienne l’importuner ;» (524) Le narrateur jouit de la liberté de celui qui a tout perdu et qui n’a plus rien à perdre, de l’homme sans attaches qui est libre de dériver, c’est-à-dire de sortir des rives établies par l’appartenance culturelle ou nationale. C’est ce que trahit la disparition du pronom personnel JE, encore présent dans le premier roman, quin’existe plus ici que dans l’interstice du IL et du TU. La disparition de la première personne donne à voir le fantasme d’une identité sans territoire exigeant du sujet qu’il se dépouille «couche par couche des choses qu’on [lui] a ajoutées, imposées»(18) pour affirmer sa valeur d’homme singulier. C’est ce que semble confirmer le scénario narratif où est mise en abyme l’origine de l’écriture.
La narration est déclenchée par Marguerite, une jeune Allemande d’origine juive, que IL a connue autrefois à Pékin et que TU retrouve à Hong Kong peu avant la rétrocession à la République Populaire de Chine.(19) Le second chapitre, qui décrit leurs débats amoureux dans une chambre d’hôtel, se termine sur ces mots : «Tu dis que la Chine, pour toi, c’est déjà très loin. Elle dit qu’elle comprend. Tu dis que tu n’as pas de patrie. Elle dit que bien que son père soit allemand, sa mère est juive, elle n’a donc pas de patrie non plus, mais elle ne peut se soustraire au souvenir. Tu lui demandes pourquoi. Elle dit qu’elle n’est pas comme toi, elle est une femme“ (30). Marguerite - est-ce un clin d’œil à Faust ? - rejette son identité allemande en faveur de l’identité juive qu’elle déclare tenir de sa mère et dans laquelle elle cherche à se reterritorialiser. Elle s’y accroche, estime le TU qui, lui, s’enorgueillit de s’être délesté de toute identité : «Mais à la fin de toutes les lettres qu’elle t’écrivait, elle traçait après sa signature une étoile jaune à six branches ; tu ne pouvais oublier qu’elle était juive, mais ce que tu cherchais à effacer, c’étaient justement les empreintes de la souffrance» (201).(20) Contrairement au narrateur, qui cherche à oublier, Marguerite est la gardienne du souvenir, la femme qui va enclencher le travail de la mémoire et de l’écriture : «Tu ne savais pas ce qu’était devenue Marguerite, elle qui t’avait poussé dans ce bourbier pour écrire ce livre de merde». (201)
La relation avec Marguerite a mis en mouvement la narration, qui se nourrit tout au long du roman du papillonnage de «pays en pays» et de «femme en femme», images en miroir d’une même liberté recouvrée. Une liberté trop précieuse et trop fragile pour être sacrifiée à quelque velléité d’intégration ou de sédentarisation : «C’est seulement quand je suis en fuite que je me sens vivant, c’est seulement dans la fuite que je retrouve toute ma liberté… La liberté de me parler, de bien ressentir les choses. Peut-être qu’il n’y a pas d’autre but, dans l’écriture, que de prendre la fuite».(21) La fuite est le moyen d’atteindre cet état insulaire grâce auquel le créateur peut affirmer sa liberté, cette forme de «conscience» qui le prémunit contre les manipulations extérieures mais qui le confronte en même temps au paradoxe d’un enracinement dans le déracinement.
La contrepartie de cette ascèse existentielle est une solitude absolue, lot ordinaire de l’étranger exilé qui, loin d’être ressentie comme privation, est au contraire vécue comme libération des contraintes extérieures, réappropriation de soi loin des dérives idéologiques et des récupérations sociales : «Tu dis que tu ne crains pas la solitude, que c’est justement elle qui t’a empêché de te détruire, c’est la solitude intérieure qui t’a préservé» (131). Dès le début du roman, IL exprimait son besoin d’un «toit qui le protège du vent et de la pluie, et quatre murs qui l’entourent et l’isolent du bruit» (32), d’un «logement pour protéger sa vie privée» (36). En effet, dans la Chine de Mao, la solitude était un bien précieux, un plaisir, voire un luxe, comme le confiait Gao dans un entretien : «L'existence que j'ai menée en Chine me fait juger la solitude extrêmement précieuse. C'est précisément grâce à elle que j'ai pu survivre et garder mon indépendance d'esprit. La solitude est nécessaire à l'artiste et à la maturité de son art». Et il ajoutait : «La solitude est parfois une force. Rechercher la solitude est en fait un état d'esprit, une disponibilité à la création. L'artiste éprouve dans cette solitude une force, un besoin, celui de s'exprimer avant tout à soi-même».(22) La solitude est à la fois un état intérieur forgé dans la résistance à la barbarie et au totalitarisme et un lieu à partir duquel se recomposer sans entrave ni tabou.(23) Car c’est seul, en marge, face à sa propre langue ou, plutôt, «vagabondant seul en elle», que l’écrivain peut habiter son exil.(24)
Le roman se termine sur l’image d’un ultime départ dont l’ambiguïté est de suggérer la possibilité d’un «chez soi» en exil, tout en réactualisant l’image du passage, du déplacement: «Par l’avion de midi passé, tu rentres à Paris». (561) Symptomatiquement, seuls les trois derniers chapitres se déroulent en France, à Toulon puis à Perpignan, comme si le narrateur avait d’abord dû se «purger» du passé pour aborder au présent de l’énonciation, qui peut alors coïncider avec le présent de l’énoncé. Nulle trace de nostalgie à l’issue de ce parcours car le «pays natal» n’existe que dans la «mémoire», «il est une source dans les ténèbres d’où jaillissent des sentiments difficiles à exprimer, c’est une Chine personnelle qui n’appartient qu’à toi, et tu n’as plus aucune relation avec l’autre.» (554)
«Dialoguer-interloquer»(25): reconfigurer
Gao Xingjian a souvent déclaré que l’écriture de son premier roman, La Montagne de l’âme, lui avait permis de «régler ses comptes avec la nostalgie du pays natal». Mais dans un entretien daté de 2000, il indiquait que son complexe chinois avait «resurgi de ses cendres», notamment dans Le Livre d’un homme seul, qui ne traite plus de la nostalgie d’une Chine traditionnelle, mais dénonce la machine à broyer totalitaire de la Révolution culturelle.
La Montagne de l’âme ‑ qui avait été qualifié sur le quatrième de couverture de « roman complet de la “sinitude” retrouvée » ‑ fictionnalisait l’impossible retour à la tradition, à une Chine originaire et mythique, devenue inaccessible parce que la violence de l’histoire n’épargne pas le village natal.(26) Le Livre d’un homme seul est une œuvre à la fois jumelle et antithétique : jumelle par sa structure formelle et par sa quête d’une identité échappant aux déterminants culturels et nationaux; mais antithétique aussi parce que cette quête emprunte d’autres voies, substituant à la pérégrination archéologique et ethnologique du premier roman la fuite existentielle vers un Occident pluriel. Ici et là cependant, c’est un même mouvement de dérive qui mène du centre (du pouvoir, de la corruption) vers la périphérie, de l’ici vers une hétérotopie située tour à tour à l’intérieur (dans une Chine mythique), puis à l’extérieur du pays (en Occident).(27) Or à quoi servent les hétérotopies si ce n’est à bousculer, à défaire les sémantismes familiers pour les remettre à distance et apprendre à voir d’un ailleurs ?
Ici j’emploie le terme «hétérotopie» au sens que lui donnait Foucault dans Les mots et les choses : à savoir, une pensée qui dérange pour pouvoir reconfigurer, qui «secoue [...] toutes les familiarités » afin d’inquiéter à nouveau la pensée.(28) Ce concept a été repris par le sinologue François Jullien qui en a fait une méthode puisqu’il a décidé de s’éloigner le plus possible de son objet – la philosophie occidentale – pour pouvoir le réattaquer de biais, le reconsidérer et le repenser à partir d’un lieu (géographique, linguistique, philosophique) maximalement éloigné : la Chine.(29) L’ailleurs hétérotopique est, pour reprendre ses termes, «ce qui ne s’inscrit pas dans notre cadre initial, ne fait pas partie du paysage (linguistique – notionnel) dans lequel nous avons d’abord grandi et nous trouvons situés, donc aussi au sein duquel nous pouvons d’emblée nous "orienter"».(30) Il s’agit d’un exercice de mise en perspective – ce que Jullien appelle une «ex-optique»(31) - qui permet de rendre visible, du dehors, ce qu’on ne voyait pas du dedans. En même temps, c’est un outil de travail qui permet de dépayser au plus loin l’esprit afin de rendre plus lisible, de ce dehors, par effet de retour, l’expérience européenne de la pensée… Cette «stratégie de détour et de retour» suppose un sujet qui «ne renonce pas à soi, à sa place dans le temps, à sa culture, et n’oublie pas»(32) mais qui est en même temps capable, comme l’écrit Jullien, «simplement en frottant entre elles deux traditions qui ne vont pas ensemble, de "refondre la langue", d’ouvrir et de donner leur chance à d’autres configurations discursives – bref, d’offrir d’autres possibilités de pensée».(33)
On peut, à cette lumière, tenter de reconsidérer ce que Gao appelle son «complexe de la Chine», lequel relève moins d’une «nostalgie du pays natal» que d’une dynamique de recomposition de soi et de la langue dont la fonction n’est pas seulement thérapeutique. En effet, le retour à l’origine est surtout un moyen de dynamiser le processus créateur qui se nourrit de constants allers-retours entre l’ici et l’ailleurs, entre le présent de l’exil et l’autrefois de l’origine. Or l’origine, comme nous le rappelle Daniel Sibony, est moins le lieu d’où l’on vient que celui d’où l’on doit partir, le lieu d’où l’on s’extrait pour ne plus avoir à y revenir compulsivement. C’est, en somme, ce qui interdit de s’identifier avec la place où l’on naît.(34) Voilà pourquoi il faut faire le voyage de l’origine : non pas pour y rester, mais pour prendre un nouveau départ, pour réactualiser la fonction de l’origine «comme source des départs», comme «ensemble des départs possibles».(35) Cette dialectique informe le mouvement de la création chez Gao : s’il retourne à la Chine, c’est pour délivrer, de ses possibles et de ses ressources appropriés, les figures imprévisibles d’une modernité littéraire en langue chinoise.
Gao, en effet, a redécouvert sa propre culture au contact d’une modernité occidentale, qui joue à la fois comme révélateur d’une spécificité chinoise inscrite dans la tradition et comme moteur d’une redéfinition de la création.(36) Dépassant la dichotomie Chine/Occident en même temps que l’opposition manichéenne entre modernité et tradition, son entreprise littéraire tente de frayer un passage entre les deux écueils qui, selon lui, hypothèquent l’émergence d’une modernité authentique en Chine : d’une part, le retour à la langue chinoise classique (à Hongkong et Taï Wan), de l’autre l’occidentalisation à outrance (en Chine continentale). Selon lui en effet, la classe cultivée chinoise a refait dans les dernières décennies au pas de course le chemin parcouru par l’Occident depuis les années 40 dans tous les domaines de la création et des sciences humaines. Ce faisant, elle n’a pas toujours su résister aux modes et aux engouements passagers, conduisant certains écrivains à plaquer artificiellement la grammaire des langues occidentales sur la langue chinoise. Or les «formes nouvelles » que Gao appelle de ses vœux ne sauraient se réduire à des «marchandises d’importation », à de «simples traditions venues de l’Occident» : elles doivent être «des formes développées par la langue chinoise elle-même», aptes à «développer [l]es potentialités d’expression » qui lui sont propres.(37) Loin des modes et des imitations serviles de l’Occident, Gao cherche à repossibiliser la langue chinoise sans la trahir, ce qui implique de jouer sur sa différence avec les langues occidentales : «Au lieu de rechercher un dénominateur commun à la langue chinoise et aux langues occidentales, il vaudrait mieux étudier les divergences, ce serait, pour un écrivain de langue chinoise, une source d’inspiration bien plus grande.»(38)
Gao sait en effet que tout véritable dialogue entre les cultures suppose, en même temps que l’instauration d’un plan commun du logos, le «dia» de l’écart qui permet de construire l’altérité et d’échapper à l’uniformisation, à la standardisation. Dans ses romans, il cherche donc à faire travailler l’écart entre la Chine et l’Occident, les tensions entre tradition et modernité, seul moyen de faire advenir cette «épreuve de dé-rangement» qui, selon Jullien, permet de reconfigurer le langage et la pensée.(39) Cette productivité de l’ailleurs se donne à voir dans une écriture qui mêle des innovations formelles venues d’Occident à des héritages oubliés, ressortis des fonds populaires ou folkloriques chinois (mythes, légendes, dialectes régionaux), ou encore de la tradition zen. Le Livre d’un homme seul met en œuvre nombre de procédés occidentaux modernes, comme l’abandon de l’intrigue linéaire, le monologue intérieur, le «flux de langage»(40) (inspiré du «flux de conscience») ou encore le jeu avec les pronoms personnels, dont l’effet est beaucoup plus fort en chinois où les pronoms sont très peu présents dans la langue parlée.(41) En même temps, il renoue avec un sens de l’errance qui a nourri la culture orientale jusqu’à constituer un des modes privilégiés de la méditation bouddhiste : le mouvement génère sa propre vérité, le chemin est toujours plus loin, la médiation est sans but, le point de fuite inaccessible.
L’écriture est tributaire de ce mouvement. Attestant d’une sensibilité à la dynamique des choses, elle tire sa force d’inventivité d’un dialogue entre sources hétérogènes qui vise, non pas à réaliser la synthèse des cultures, mais à dégager de leur rencontre une dialectique capable de les enrichir, l’une et l’autre, dans leurs différences. Cette écriture se construit, non pas à partir d’une hétérotopie figée, mais d’une dynamique d’entre-deux apte à déployer ce que François Jullien appelle un «auto-réfléchissement de l’humain. C’est-à-dire se réfléchissant entre lui et lui seul, par ce dévisagement mutuel, sans étai et sans abri». Car «il n’est pas seulement vrai que c’est à partir d’écarts que la pensée pense ; sinon elle s’endort ou s’ennuie. Mais toute tension entre cultures trop aisément recouverte, trop hâtivement enfouie, et qu’on ne laisse pas travailler, produira immanquablement son refoulé ».(42)
▲
Remarques:
(1) Réfugié politique depuis 1988, Gao Xingjian a acquis la nationalité française en 1998. Il s’est fait connaître en Occident avec la publication en 1995, en France, de son roman
La Montagne de l’Âme (
Lingshan, paru en 1990 à Taiwan), en même temps que par son théâtre (parfois écrit directement en français) et par son œuvre picturale.
(2) Gao Xingjiang, Le Livre d’un homme seul, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2000.
(3) Yinde Zhang, «Littérature (pan)chinoise et comparatisme : l’exemple de Gao Xingjian», 313, in Littérature et espaces, sous la dir. de J. Vion-Dury, J.-M. Grassin, B. Westphal, Limoges, PULIM, 2000, 310-320. Voir également, du même auteur, «Gao Xingjian et Jorge Semprun : mémoire et fiction identitaire», in L’écriture romanesque et théâtrale de Gao Xingjian, Noël Dutrait dir., Paris, Seuil, 2006, 47-69. Voir enfin l’ouvrage du même auteur : Le monde romanesque chinois au XXème siècle, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2004.
(4) C’est ce que Gao confiait dans un entretien de 1993. Voir «Conversation», préface à Visite à Gao Xingjian et Yang Lian. Préface et traduction de Chantal Chen-Andio, Ed. Caractères, Paris, 2004, 96.
(5) Gao Xingjian, «Ne pas avoir de –isme», in Le témoignage de la littérature, Paris, Seuil, 2004, 34.
(6) Pour Bakhtine, l’exotopie est la condition même de toute compréhension créatrice, laquelle suppose «l’exotopie de celui qui comprend – dans le temps, dans l’espace, dans la culture – par rapport à ce qu’il veut comprendre créativement». Voir «Réponse à la question du comité de rédaction de Novij Mir», in Esthétique de la création verbale, 328-335, Moscou, 1979, 334. Cité par Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtin. Le principe dialogique, Paris, Seuil, 1981, 169.
(7) Ecrit de 1996 à 1998, Le Livre d’un homme seul (Yigeren de shengjing), paraît à Taiwan en 1999 et en 2000 dans sa version française, trad. fr. de Noël et Liliane Dutrait, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2000. La majuscule de «Livre» en français est à respecter soigneusement puisque ce terme est une traduction du mot «Bible» en chinois, ce qui donne une dimension exemplaire, littéralement biblique, au destin singulier du héros.
(8) Comme l’indique son traducteur en français, Noël Dutrait, Gao Xingjian lui avait recommandé de lire Un homme qui dort de Georges Perec.
(9) Selon l’expression de Mabel Lee, «Gao Xingjian : contre une modernité esthétique», in L’écriture romanesque et théâtrale de Gao Xingjian, sous la dir. de Noël Dutrait, Paris, Seuil, 2006, 13-23 ; citation 21.
(10) Mikhail Bakhtine, «Concernant la révision du livre sur Dostoïevski», Esthétique de la création verbale, Moscou, 1979, op. cit., 311-312. Dans La montagne de l’âme, Gao recourt à la métaphore du miroir pour exprimer cette fonction du dédoublement : «Quand j’observe les autres, je les considère comme des miroirs qui me renvoient ma propre image et cette observation dépend entièrement de ma disposition d’esprit du moment. [...] Le problème réside dans la prise de conscience intérieure de mon moi, ce monstre qui me tourmente sans cesse» (213).
(11) Gao Xingjian, «La raison d’être de la littérature», in Le Témoignage de la littérature, op.cit., 113. Cette conception de la littérature comme dialogue avec soi-même peut s’expliquer par le contexte politique qui, à l’époque de Mao, interdisait tout échange libre avec autrui : «si un individu voulait conserver une pensée indépendante, il n’avait que lui-même à qui s’adresser et ne pouvait le faire que dans le plus profond secret», ibid.
(12) Voilà comment Gao résumait son entreprise à l’époque de la rédaction du livre : «Je suis en train d’écrire un roman sur la révolution culturelle en Chine. J’y porte un autre regard qu’à l’époque, et je porte aussi un certain regard sur ma façon de regarder l’époque, et, par contrecoup, je m’observe moi-même m’observant. Et ce processus réflexif m’encourage à vivre, ça me donne de la passion. Si je retrace la vie que j’ai déjà vécue, c’est comme redécouvrir une nouvelle vie». «Au plus près du réel. Dialogues avec Denis Bourgeois», in La raison d’être de la littérature, Paris, L’Aube poche, 2001, 174.
(13) «Le chinois moderne et l’écriture littéraire», in Le témoignage de la littérature, op. cit., 100.
(14) «La raison d’être de la littérature», in Le témoignage de la littérature, ibid., 120.
(15) Gao Xingjian, Pour une autre esthétique, trad. par Noël et Liliane Dutrait, Paris, Flammarion, 46.
(16) La Montagne de l’âme, trad. Noël et Liliane Dutrait, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 1995, 508.
(17) Selon Yinde Zhang, le thème de la fuite doit aussi être référé aux thèses de Henri Laborit (souvent cité par Gao) qui considère la fuite comme l’expression d’une lucidité de l’individu : en choisissant de rester à l’écart de tout mouvement collectif, il préserve son indépendance d’esprit par rapport à la volonté du groupe. La fuite est aussi le titre d’une pièce de Gao Xingjian qui a pour toile de fond les événements de la Place Tian’an men. Voir Le monde romanesque chinois au XXème siècle, op. cit., 304.
(18) Visite à Gao Xingjian et Yang Lian, op. cit., 111.
(19) Comme le fait remarquer Yinde Zhang, le choix de Hong Kong à l‘heure fatidique de la rétrocession à la Chine pour inaugurer le travail du souvenir est pour le moins ambigu : il souligne la fragilité de toute liberté et justifie le choix de la fuite par rapport à toute fixation géographique. Voir Le monde romanesque chinois au XXème siècle, op. cit., 304.
(20) Le refus d’assumer, individuellement, les souffrances collectives du peuple chinois et de solidariser son identité avec l’histoire de son pays, est exprimé à plusieurs reprises à travers l’image du Christ : «Elle veut confirmer son identité, mais toi ? Tu veux justement te débarrasser de ton étiquette chinoise, tu ne joues pas le rôle d’un Jésus-Christ, tu ne veux pas que la croix de cette nation t’écrase» (85)
(21) «Au plus près du réel. Dialogues avec Denis Bourgeois», dans La raison d’être de la littérature, op. cit., 44.
(22) «Littérature et écriture. Entretien de Gao Xingjian avec Jin Siyan & Wang Yipei», in Alliage n° 45-46, 2001. Consulté sur internet : http://www.tribunes.com/tribune/alliage/45/index.htm.
(23) Michel Draquet, Gao Xingjian, Le goût de l’encre, Paris, Hazan, 2002, 50.
(24) Visite à Gao Xingjian et Yang Lian, op. cit., 13.
(25) «Dialoguer, interloquer» est le titre d’une pièce de Gao Xingjian que j’utilise ici comme métaphore pour figurer les rapports que l’auteur instaure entre la tradition chinoise et la modernité occidentale.
(27) Au même titre que l’Occident, la Chine mythique de La montagne de l’âme constitue un ailleurs qui dérange. En effet, Gao Xingjian distingue très nettement deux Chine : d’une part une culture chinoise honnie, celle de la boucle du fleuve Jaune, néo-confucéenne et orthodoxe sur laquelle a reposé le système impérial pendant des siècles et, d’autre part, une culture chinoise révérée, celle du Yangzi, sous influence taoïste, non orthodoxe, plus proche des cultures populaires.
(28) Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, 7.
(29) J’ai été introduite au travail de François Jullien par Noelle Batt. Voir son introduction au n°21 de la revue TLE : Pour un dialogisme des disciplines. Avec Bakhtine, 2003, 5-21. François Jullien a exposé sa méthode et son parcours intellectuel dans Penser d’un dehors (La Chine). Entretiens d’Extrême-Occident, en collaboration avec Thierry Marchaisse, Paris, Seuil, 2000. Voir aussi son dernier ouvrage paru à ce jour, Chemin faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie, Paris, Seuil, 2007.
(30) François Jullien, Chemin faisant, op. cit., 85.
(31) François Jullien, Penser d’un dehors, op. cit., 360.
(32) Mikhail Bakhtine, «Réponse à la question du comité de rédaction de Novij Mir», in Esthétique de la création verbale, 328-335, Moscou, 1979, 334.
(33) François Jullien, Penser d’un dehors, op. cit., 358.
(34) Selon l’expression de Daniel Sibony dans Entre deux. L’origine en partage, Paris, Seuil, 1991.
(35) Daniel Sibony, «Préface» au livre de Juliette Vion-Dury (dir), Entre-deux morts, PULIM, 2000, 3-6. Citation, 5.
(36) Michel Draquet, Gao Xingjian, Le goût de l’encre, op. cit., 23.
(37) Visite à Gao Xingjian et Yang Lian, op. cit., 69.
(39) François Jullien, Chemin faisant, op. cit., 102.
(40) Gao définit le flux de langage dans les termes suivants : «Le flux de conscience, dans la littérature occidentale contemporaine désigne le fait qu’on part du sujet pour suivre et capter ses mouvements psychiques ; ce que l’écrivain réalise n’est cependant autre que le flux de la langue. Je ne vois pas, par conséquent, d’inconvénient à appeler cette langue littéraire le flux de langue. J’estime même aussi qu’on peut enrichir l’expressivité de cette langue, en changeant d’angle de perception, en variant par exemple, l’utilisation des pronoms : remplacer la première personne par la deuxième ou cette dernière par la troisième. Le même sujet, avec des pronoms différents, peut ainsi avoir des perceptions différentes», Gao Xingjian «Littérature et métaphysique» («Wenxue yu xuanxue»), in Sans doctrine (Meiyou zhuyi), Hongkong, Tiandi youxian tushu gongsi, 2000, 73. Cité par Yinde Zhang, «Littérature (pan) chinoise et comparatisme», art. cit., 315.
(41) Comme l’explique l’auteur : «En chinois, on omet fréquemment le sujet, le verbe ne subit pas de flexion selon la personne qui parle, le point de vue narratif est extrêmement souple. De «je» sujet à «je» non sujet, autrement dit, du «c’est moi» au «je» général et au «non-je», on glisse vers «tu», puis vers «il», ce «tu-je» étant l’objectivisation du «je», tandis que le «il-je» peut être vu comme une observation calme du «je», une sorte de pensée qui donne une grande liberté. Cette liberté, je l’ai trouvée en écrivant La montagne de l’âme.». In Le témoignage de la littérature, op. cit., 60. Un peu plus loin, dans le même texte, Gao précise les différentes fonctions de cet usage des pronoms personnels : «Dans la langue narrative de mes romans, et dans mes pièces de théâtre, je change les pronoms ; dans les romans, je le fais pour déplacer l’angle de la narration ; dans les pièces, pour régler les relations entre l’acteur et le personnage qu’il joue», Ibid., 106.
(42) François Jullien, Chemin faisant, op. cit., 115.
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Laurence Dahan-Gaida: «Eloge de la fuite»: la poétique de l’exil de Gao Xingjian -
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_dahan-gaida.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25